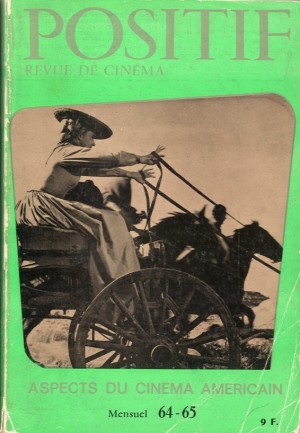17/05/2009
Ōshima : Le retour des trois soûlards
De Nagisa Ōshima, on connaît surtout le réalisateur à l'érotisme provoquant de Ai no corrida (L'empire des sens - 1976) et Max mon amour (1986), le cinéaste classieux de Furyo (1983) ou de Gohatto (Tabou - 1999) son dernier film à ce jour. On connaît encore, quoiqu'un peu moins bien, le réalisateur politiquement engagé et virulent, figure phare de la nouvelle vague japonaise des années 60 avec Seishun zankoku monogatari (Contes cruels de la jeunesse - 1960), Nihon no yoru to kiri (Nuit et brouillard du japon - 1960) ou Koshikei (La pendaison). L'édition DVD de quelques films rares voire inédits en France permet d'ajouter quelques facettes à l'oeuvre riche et complexe de l'un des plus importants cinéastes nippons. Merci, édition DVD. Ainsi, Kaette kita yopparai (Le retour des trois soûlards) réalisé en 1968 (il n'y a pas de hasard) en deux productions plus sombres, dévoile un penchant inattendu pour la comédie burlesque et un goût pour la fantaisie dans le récit comme sur la forme.
Construit autour d'un trio de musiciens pop alors fameux, les Folk Crusaders, Le retour des trois soûlards évoque les films réalisés par Richard Lester avec les Beatles ou un autre classique de la comédie contestataire tourné la même année, If... de Lindsay Anderson. Le film fut un échec, le studio Shochiku effaré par le résultat le retirant au bout de quelques jours de l'affiche. Cet événement consomma la rupture entre Ōshima et son ancien studio, déjà passablement sur les nerfs avec les films précédent. Artistiquement, Ōshima conservera sa virulence, mais délaissera ce style de comédie, ce que l'on peut en découvrant ce film aujourd'hui, regretter.
Le DVD
Sur Asie vision
12:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/05/2009
Programme de la semaine
Pour une bonne semaine, je serais sur le festival de Cannes. Je ne sais pas encore trop ce que je vais aller y voir. Hier soir, en allant chercher mon accréditation, la simple vision des files d'attente m'a sapé le peu d'énergie qui me restait d'une semaine difficile. Deux repères, une soirée Pietro Germi demain soir et jeudi Giù la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) de Sergio Léone, ce qui ne se refuse jamais en copie neuve sur grand écran. Voilà. D'ici là, je ne vous abandonne pas, toute la semaine à partir de demain, je ferais le relais avec les chroniques écrites autour de quatre films de Nagisa Ōshima pour Kinok. Et puis la chronique sur le bouquin de Luc Moullet en bonus. Sur le même site, je vous recommande le texte du bon Docteur sur le livre d'entretiens avec Moullet et le texte de Ludovic Maubreuil de Cinématique sur l'épisode Merde de Léos Carax, découvert l'an dernier à Cannes. Bonjour chez vous.
13:27 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/05/2009
Welcome, un film de Philippe Lioret
Dans les discussions qui reviennent périodiquement sur le cinéma français, mes lecteurs savent que j'ai une admiration particulière pour les films de Philippe Lioret. Welcome m'a tout particulièrement réjouis parce que je le vois comme son œuvre la plus aboutie, confessant au passage que je n'avais pas été complètement conquis par la belle mécanique de Je vais bien, ne t'en fais pas (2006). Welcome réussit à allier les qualités de romanesque de Mademoiselle (2001) et de L'équipier (2004) à une plus grande réussite formelle. Il réussit aussi à s'ancrer dans son époque, à saisir et rendre compte d'une atmosphère sans tomber dans l'anecdotique ni les pièges souriants du film à thèse, de ce cinéma engagé qui hérisse bien des cinéphiles. Pour être franc et ne pas m'appesantir sur le sujet, j'ai savouré à sa juste mesure la réaction outrée du Besson sous-ministre, s'indignant des similitudes soulignées par Lioret entre les ambiances de 1943 autour de la traque des juifs en France et la situation contemporaine autour de celle des clandestins. On se souviendra, à toutes fins utiles, du No pasaran, album souvenir (2003) de Henri François Imbert qui, à partir de quelques cartes postales des camps de réfugiés républicains espagnols en 1939, en France, racontait une histoire de l'Europe à travers ses camps et s'achevait... à Sangatte le fameux « centre d'accueil » de Calais aujourd'hui fermé. Mais il ne s'agit là que d'une réaction de royaliste rancunier et cela n'a rien à voir, ou si peu, avec le film, justement et tant mieux.

Cette réaction sous-ministérielle permet pourtant de dire ce que le film n'est pas (un film de propagande pour embêter monsieur Besson) et ce qu'il réussit à être en profondeur. Welcome est une histoire d'amour triple. De cet amour redoutable et redouté de tous les pouvoirs, l'amour des surréalistes, théorisé par Ado Kyrou et illustré par Luis Bunuel, celui qui brise les chaînes des contraintes sociales, qui, tout à lui-même, n'accepte aucun obstacle, aucune restriction à son accomplissement. C'est littéralement ce qui anime Bilal, jeune réfugié Kurde venu d'Irak, qui a traversé plusieurs pays et nombre de souffrances pour échouer à Calais. Il cherche à rejoindre Mina. Mina est à Londres, au-delà de la Manche, et son père a décidé de la marier à un riche ami. Le temps presse. Bilal croise la route de Simon, maître nageur et ex-champion olympique en plein divorce, joli personnage sur le retour façon Bogart dans Casablanca (1943), Lioret connait ses classiques. C'est la rencontre entre une histoire qui n'arrive pas à se terminer (car comme au premier jour, il est amoureux de sa femme) et une histoire qui n'arrive pas à commencer. D'où naissance d'une troisième histoire, celle de l'amitié entre les deux hommes, substitut d'une relation père-fils dans laquelle Simon peut voir l'enfant que son couple désagrégé n'a pas eu, et moi l'une de ces histoires de transmission (ici via la natation) façon Clint Eastwood récente manière.
Il y aurait à creuser sur les similitudes entre Lioret et le cinéaste américain. L'ouverture de L'équipier devait beaucoup à celle de Bridges of Madison Country (Sur la route de Madison – 1995). Ils ont un goût commun pour la mélancolie du temps passé, les gros plans travaillés qui envisagent les visages comme des paysages, les ambiances nocturnes, le travail discret sur la musique (ici c'est de nouveau Nicola Piovani qui s'y colle avec l'aide de Wojciech Kilar et Armand Amar) et la pratique d'une mise en scène élégante mais subordonnée à l'action, d'un certain classicisme, travaillant par touches subtiles plutôt que flamboyantes. Je note également la même pudeur dans la description des relations amoureuses et l'utilisation symbolique d'objets chargés de sens émotionnel comme la montre dans L'équipier qui cristallise le désir entre les personnages de Bonnaire et Gamblin, ou ici la bague qui finit par devenir le symbole des échecs de Simon.
La réussite de Welcome, c'est selon moi d'être resté avec rigueur sur sa ligne romanesque. De ne pas avoir cédé, avec son arrière-plan, à la tentation du film engagé qui ne convainc finalement que les convertis, bonne vieille quadrature du cercle du cinéma politique. Têtu comme une bourrique, Simon saisit au départ la rencontre avec Bilal comme un moyen de reconquérir sa bientôt ex-femme, Marion (Audrey Dana, très belle), qui elle soutient les réfugiés au quotidien au sein d'une association. Et le film, sans mollir, ne montrera pas l'éveil d'une conscience politique, mais le réveil d'une humanité. Et il s'attache aux conséquences sociales de l'amitié vraie et de l'amour contrarié. En se plaçant sur le plan humain, Lioret élargit son propos à la dimension universelle de la lutte de l'individu contre les forces répressives de la société (tu m'auras pas). J'ai l'air de plaisanter comme ça, mais c'est très bien vu. Les forces répressives ne sont pas seulement la police (français,e anglaise, privée avec le vigile), mais celles de la misère avec les conflits internes aux réfugiés, celles de la famille et de la tradition avec le personnage du père de Mina, celles du conservatisme et de la peur avec les épisodes du magasin et du voisin. Ce voisin, au passage, on peut le rapprocher de la famille de la boxeuse de Million dollar baby (2005), portrait assez gratiné, mais si vous connaissiez le mien (de voisin) ça ne vous semblerait pas si caricatural. Welcome montre un univers redoutable dans lequel tout le monde « a ses raisons », y compris l'étonnant commissaire campé par Olivier Rabourdin dont Lioret travaille l'étrangeté et en fait, non sans paradoxe, celui qui comprend le mieux les mouvements chaotiques de l'âme de Simon.

Cet aspect associé à la dimension tragique du récit rapproche Lioret d'un autre grand cinéaste de notre époque, Robert Guédiguian. Les personnages du marseillais ont certes une forte dimension politique. Ils portent, ou plutôt ont porté un idéal. Avec les années, cet idéal s'est émoussé et ce sont les relations affectives qui ont pris le relais et deviennent le moteur de fictions. Amour mère-fille dans La ville est tranquille (2000), Amour de jeunesse encore vivace dans Mon père est ingénieur ( 2004) et Lady Jane (2008). C'est cet amour qui permet de revenir à l'acte politique débarrassé de l'idéologie, comme il y mène Simon.
On retrouve aussi chez les deux hommes une certaine approche formelle. Ils ont la faculté de filmer avec beauté des paysages industriels tout sauf excitants à priori. Loin de la fascination poétique pour la poutrelle rouillée, le Calais de Lioret est représenté comme un pays terrifiant de conte de fée. Parfois aux limites de l'abstraction comme avec ces larges plans d'échangeurs d'autoroute avec le ballet nocturne des feux de camions, le passage de la douane et ses portes de lumière, l'immense plage battue par les vagues grises et puis, comme dans tout conte qui se respecte, la sombre forêt, la « jungle » comme la nomment les clandestins qui y campent. La ville elle-même garde un côté étrange, un peu comme la ville de Tystnaden (Le silence – 1963) d'Igmar Bergman. Territoire familier mais décalé sur lequel plane une sourde menace. Et puis il y a la mer. Après L'équipier, je n'hésite pas à écrire qu'avec Hayao Miyazaki, Lioret filme la mer comme personne. Aidé par la photographie de Laurent Dailland, chef opérateur classieux d'Est-Ouest (1999 ) et du Goût des autres (2000 ), il rend la puissance et la fascination de son immensité, transformant l'écran est un immense toile mouvante et redoutable.
En détachant souvent Simon du fond par des effets de mise au point et de focale, Lioret accentue ce sentiment d'absence du personnage au monde qui l'entoure avant de le rattacher quand il rencontre Bilal qui entre en quelque sorte « dans sa zone de netteté ». En resserrant les cadres autour d'intérieurs étroits (Le camion des passeurs, l'appartement de Simon, les vestiaires de la piscine), Lioret cerne ses personnages et réduit visuellement leur champ d'action. Et quand ils se retrouvent dans un vaste extérieur, la plage ou l'océan, ils sont tout à coup perdus. L'espace extérieur est un piège. La Manche se révèle un étroit passage traversé de patrouilles maritimes, la « jungle » n'est qu'un faux refuge et dans les rues, il y toujours quelqu'un pour vous voir. Rien ne se perd, tout se retrouve, les médailles volées et les bagues offertes. Nul endroit pour se cacher, ni pour respirer. Les longs gros plans expriment finalement que l'ultime frontière est notre propre corps. Ultime forteresse que l'on cherche à perçer à coups de regards. Un dernier espace de résistance.
Ce sentiment d'oppression dégagé par Welcome ainsi que sa fin assez sombre me semblent donner un portrait assez juste de ce début de siècle plutôt nauséeux. Depuis les attentats de septembre 2001, un mouvent d'ensemble s'est accéléré, un mouvement que rien ne semble pouvoir entraver, et qui tend à établir une version modernisée du village du prisonnier, la fameuse série des années 60. Les incroyables évolutions techniques des dernières décennies sont mises au service de la surveillance généralisée et du contrôle. Vidéo, Internet, biométrie, culture du risque zéro, règne de la norme, censure et autocensure des esprits. Qu'il ne dépasse pas une tête. Deux films essentiels ces dernières années ont su mettre des images justes et claires sur cette angoisse diffuse : Minority report (2004) de Steven Spielberg et aujourd'hui Welcome, un film de Philippe Lioret.

Photographies source Allociné copyright Guy Ferrandis
00:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : philippe lioret | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2009
Django autour du feu
J'ai sauté mon tour le mois dernier, pourtant, il s'agissait du film de Henry King The gunfighter (La cible humaine - 1950) que je n'ai, hélas, toujours pas vu. Bon, ce mois-ci, c'est tout autre chose. La discussion au forum western movies autour du feu est consacrée à Django, Franco Nero et son cercueil, sa mitrailleuse, ses yeux bleus, sa main leste (au révolver), son manteau noir et toutes ces sortes de choses. Django, c'est l'une des oeuvres maîtresses de Sergio Corbucci que plus je vois de ses films, plus je l'aime cet homme là. La discussion est partie sur les chapeaux de roues, alors si le coeur vous en dit, on a même réussi à glisser là-dedans une photographie d'Edwige Fenech.

Photographie : capture DVD Wild Side
23:30 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/05/2009
Le comique en contrebande
Depuis le 17 avril et jusqu'à la fin du joli mois de mai, le Centre Pompidou accueille Luc Moullet, ses oeuvres et ses amis. Si j'étais à Paris, je saurais quoi faire pendant ces belles journées de printemps. En attendant, pour fêter cela, les éditions Capricci ont édité deux livres, Notre alpin quotidien et Piges Choisies. Le premier est un livre d'entretiens avec Emmanuel Burdeau et Jean Narboni. Le second une sélection de textes critiques, depuis ses premiers pas vers 12 ans jusqu'à sa toute récente collaboration avec Positif, lui qui fut un pilier des Cahier du Cinéma. Il y a également une jolie bande annonce.
En bons zélateurs que nous sommes, le Docteur Orlof et votre serviteur ont planché sur les deux livres, deux chroniques à paraître rapidement sur Kinok qui organise au concours sur le sujet. Et pour que la fête soit complète, quelques extraits :
Les balances s'expriment fort bien par le comique : Keaton, Tati, McCarey, Groucho Marx, sont tous nés entre le 2 et le 8 octobre : le deuxième décan. J'en veux beaucoup à ma mère : si au lieu d'accoucher le 14 octobre, elle s'était pressée un peu, je serais du deuxième décan et j'aurais fait des films bien plus drôles. (Les douze façons d'être cinéaste – Cahiers du Cinéma – 1993)
Pourquoi critiquer P.P. (Powell-Pressburger) alors que je défends Une question de vie ou de mort ? On risque de me reprocher cette contradiction. C'est tout simplement que, quand on fait cinquante films dans sa vie, c'est bien le diable si on arrive pas à en réussir un. (Michael Powell n'existe pas – La lettre du cinéma – 1995)
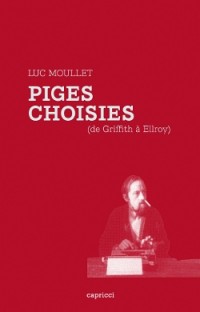
Les espagnols devaient bien se douter qu'ils misaient sur le mauvais cheval en l'allant chercher dans la Mancha, où, c'est logique, ils ne pouvaient tomber que sur une piètre rossinante... (Pédro Almodovar, rien sur ma mère – inédit)
Lorsque Lelouch emprunte le langage de Godard en recopiant les idées stylistiques de Godard, il échoue forcément parce que l'expression stylistique de Godard dépend du fait que Godard est suisse et protestant et qu'il est Godard. Lelouch n'est rien de tout cela, il exprime des thèmes personnels différents de ceux de Godard, ou, le plus souvent, il n'exprime pas de thèmes. (De la nocivité du langage cinématographique, de son inutilité, ainsi que des moyens de lutter contre lui – Table ronde - 1966)
La puissance de Ford réside d'abord dans une dialectique entre la présentation des mythologies et la familiarité, l'absolu et le relatif, le pensé et le vécu, la morale et la truculence, les nuages lourds du destin et la main au cul. (John Ford, le coulé de l'amiral – Cahier du Cinéma spécial Ford - 1990)
22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc moullet | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2009
La chanson d'Hélène
12:30 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : claude sautet, romy schneider, philippe sarde, michel piccoli | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/04/2009
Ponyo, Ponyo, lalalala
Après la pluie qui tombe sur la tête de Totoro, la plage intérieure où se prélasse Porco Rosso, le lac enchanté du Dieu-Cerf et le paysage submergé que traverse l'autorail emprunté par Chihiro, Hayao Miyazaki confirme avec éclat qu'il est le maître de la représentation de l'eau au cinéma dans Gake no Ue no Ponyo (Ponyo sur la falaise – 2008). Le film s'ouvre par une séquence d'une beauté à couper le souffle. Au fond des mers, juché à la proue d'un navire aérien, un homme étrange anime un merveilleux ballet d'animaux marins. Répandant le contenu de fioles élégantes, il diffuse un feu d'artifice de couleurs au milieu de centaines de méduses translucides. Allégorie tout aussi transparente du créateur Miyazaki, déployant toutes les ressources de son art pour faire naître la magie. Le film est animé à l'ancienne, essentiellement à la main, avec de superbes couleurs pastels. Notre personnage se nomme Fujimoto, un homme qui s'est exilé dans le monde marin et est devenu le compagnon de la reine de la mer. Il y est également une sorte de créateur de beauté, reniant le monde des hommes, proche cousin en cela du capitaine Némo de Jules Verne. Verne dont l'imaginaire a nourrit nombre de créations du réalisateur japonais, les machines improbables et baroques qui fendent airs et flots en particulier. Discrètement, Fujimoto est observé par sa fille, un curieux petit personnage, petit poisson rouge tout en rondeur. Miyazaki convoque alors Andersen et la légende de la petite sirène. Partie à l'aventure, prise dans un filet dérivant, la fille-poisson est recueillie par un petit garçon, Sôsuke, qui la baptise Ponyo. Comme dans le conte, les deux enfants tombent amoureux, la fille-poisson devient une véritable petite fille tandis que Fujimoto déchaîne les forces de la mer pour la récupérer. C'est un petit peu plus compliqué parce que, pour devenir petite fille, Ponyo a libéré sans le vouloir la magie de Fujimoto et mis une sacrée pagaille. Mais à ce niveau, il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans les détails.

Une nouvelle fois, Miyazaki brasse différentes influences culturelles pour donner naissance à un univers qui lui est propre et au sein duquel il peut développer ses thèmes de prédilection. L'écologie, l'enfance, l'agression de la Nature par le monde des hommes, la famille, les anciennes divinités merveilleuses, la magie du monde. Cette fois, il revient également sur plusieurs titres clefs de son oeuvre et Gake no Ue no Ponyo m'apparaît comme un film synthèse. Attention, je n'ai pas dit, même pas pensé « testamentaire ». Mais à son âge bientôt vénérable, Miyazaki semble se délecter de revenir sur des motifs, des ambiances, des réflexions qui lui sont chers. Tout le monde a noté que le film apparaît comme un retour à la simplicité de Tonari no Totoro (Mon voisin Totoro – 1988), Joe Hisaishi reprenant même quelques mesures du fameux thème dans sa nouvelle partition. Ce n'est pas faux, mais ça me semble trop limité. On retrouve effectivement le même sens du détail et la délicatesse dans le traitement des scènes du quotidien (l'intérieur de la maison de Sôsuke, la scène du repas, la maison de retraite, la fuite des insectes des rochers qui rappelle celle des « noiraudes »), une attention qui rapproche Miyazaki du cinéma de Yasujiro Ozu (rappelez vous le début de Bakushū (Eté précoce - 1951) et la façon de montrer les enfants dans la scène d'ouverture). Mais dans le même temps, les morceaux de bravoure et le traitement du merveilleux s'éloignent de la sobriété unique de Totoro pour retrouver le foisonnement, le lyrisme des grands moments de Mononoke Hime (Princesse Mononoké – 1998) ou Sen to Chihiro no kamikakushi (Le Voyage de Chihiro – 2001). Et le sommet du film, la course de Ponyo sur les vagues-poissons de l'océan déchaîné au son d'un morceau démarquant La chevauchée des Walkyries de Wagner, retrouve l'enthousiasme grisant du mouvement des ballets aériens de Porco Rosso ou de Majo no takkyūbin (Kiki la petite sorcière – 1989). Voler, courir, planer en équilibre sur le monde. Il n'y a qu'une poignée de réalisateurs dans toute l'histoire du cinéma capables de nous faire ressentir une telle exaltation.

Miyazaki s'est toujours plu à animer les éléments. Vent, terre, feu et eau. L'eau surtout qu'il est capable de représenter avec une pureté sans égale. De ce point de vue, Ponyo est un impressionnant festival dont l'eau est le motif central. Elle prend toutes les formes, toutes les couleurs. Tour à tout nappe sombre aux yeux inquiétants, vaste agglomérat de poissons qui se fondent les uns aux autres, larges étendues translucides révélant les paysages engloutis, divinité au visage féminin sublime et aux cheveux ondulants, simple jet, celui que Ponyo crache, espiègle, celui de la pompe qui permet à Sôsuke de la sauver une première fois.
Variations, disais-je plus haut. L'expérience brutale de Ponyo avec le filet dérivant est traitée de la même manière que la rencontre entre Chihiro et le dieu du fleuve dans l'établissement de bain. Prise dans le filet, Ponyo roule dans un maelström d'immondices soigneusement décrits, nuage roulant boueux et terrifiant, comme Chihiro « vidait » littéralement le dieu du fleuve d'une montagne de déchets qui envahissait le bâtiment, manquant d'engloutir la fillette. Miyazaki se sert de sa fibre écologique et de son sens aigu de l'observation d'objets ordinaires pour construire une séquence fantastique et angoissante, jouant également sur un procédé d'accumulation virtuose des objets, « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ».

De ses oeuvres foisonnantes, Miyazaki reprend le principe de la coexistence de principe entre le « réel » et le « merveilleux ». Le monde de Sôsuke semble immédiatement conscient de celui de Ponyo et la mère du petit garçon ne semble guère surprise de voir débarquer, en pleine tempête, une fillette qui court sur les vagues. Pas plus que Sôsuke n'est véritablement surpris des pouvoir magiques de Ponyo. Le film développe là une décontraction qui désamorce les côtés les plus dramatiques de l'histoire. Le tsunami et ses résultats sont prétexte non à une débauche d'effets de destruction mais à une série de visions élégiaques d'une nature en paix, dans laquelle de grands poissons venus du fond des âges nagent paresseusement au dessus de routes submergées. Face au merveilleux, la réaction des personnages de Miyazaki est rarement la peur mais plutôt la joie, comme ces deux marins remerciant les divinités maritimes. Totoro reste peut être le plus radical de ce point de vue, mais chez Miyazaki, il n'y pas toujours de « méchants ». Et quand il y en a, ils possèdent toujours une facette plus positive. Ils ont leurs raisons et nous sommes à même de les comprendre, sinon de les accepter. Ici, cela pourra désarçonner certains, Fujimoto, ou plutôt le côté obscur de Fujimoto est une piste qui fait rapidement long feu. Il représente plus la voix angoissée d'un père qu'une véritable menace. Et le film se dépouille petit à petit de ses principes antagonistes pour devenir un voyage initiatique, contemplatif, et intérieur, celui de Sôsuke. J'ai lu quelque part que le film pourrait n'être qu'un rêve de petit garçon. L'idée est séduisante, mais il s'agirait alors de la même sorte de rêve que celui de Chihiro. De ces rêves que l'on fait en traversant un tunnel.
Un long article sur Buta connection
Chez Ed sur Nightswiming
Chez le bon Dr Orlof
Photographies © Walt Disney Studios Motion Pictures France
22:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : hayao miyazaki | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
24/04/2009
Le goût d'ma vieill' pipe en bois

Je m'en fous, j'prends pas le métro.
(source : The new black magazine)
Et merci à Charles Tatum pour l'idée de la série
23:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ousmane sembene, jacques tati | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/04/2009
Ceci n'est pas une pipe
22:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orson welles, jacques tati | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
22/04/2009
Smoking

De quoi mon cigare, tu me prends pour Tati ?
John Ford dirigeant John Wayne sur They were expendable (Les sacrifiés - 1946) Source : NYTimes, l'article est bien aussi.
22:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john ford, john wayne, jacques tati | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/04/2009
Films noirs
C'est la saison des listes. Après les années 70 et les années 80, Julien me propose de plancher sur une liste de mes films noirs préférés. Déjà, ce n'est pas facile de définir le genre. Il est plus mouvant que, disons, le western. Il pose pas mal de questions comme celle ci : l'oeuvre de Hitchcock relève-t'elle du film noir ? Vertigo (1958) ou Rear window (Fenêtre sur cour - 1954) incitent à dire oui, mais quelque chose me souffle que c'est un peu à part. On pourrait s'en tenir à l'âge d'or américain du genre entre Underworld (Les nuit de Chicago - 1928) de Joseph Von Sternberg et Touch of evil (La soif du mal - 1958) de Orson Welles, mais ça me semble réducteur. La peinture sociale d'une société, l'ambiance urbaine moderne, le crime, le brouillard, les flics verreux, la femme fatale, le détective, les bas fonds, tout ceci irrigue un courant important du cinéma français. On ne finit plus de découvrir le film noir asiatique qui a influencé radicalement le genre. Et puis les italiens qui ont exploité toutes les pistes tout en inventant un genre à part entière, le giallo. Si l'on veut ouvrir, ça va se compliquer, mais je peux essayer de définir ce que représente le film noir pour moi avec ces titres :
Les canoniques
Laura (1944) Otto Preminger
The big sleep (Le grand sommeil -1946) Howard Hawks
The killing (L'ultime Razzia - 1956) Stanley Kubrick
Underworld USA (Les bas fonds de New-York - 1961) Samuel Fuller
The Asphalt Jungle (Quand la ville dort – 1950) John Huston
Kiss me deadly (En quatrième vitesse - 1955) Robert Aldrich
The roaring twenties (Les fantastiques années 20 – 1939) Raoul Walsh
Gun crazy (1950) Joseph H. Lewis
DOA (1950) Rudolph Maté
The big heat (Règlement de comptes – 1953) Fritz Lang

Les modernes
Bring me the head of Alfredo Garcia (Apportez moi la tête d'Alfredo Garcia – 1974) Sam Peckinpah
Gloria (1980) John Cassavetes
Scarface (1983) Brian De Palma
The Cotton club (1984) Francis Ford Coppola
Year of the dragon (L'année du Dragon – 1985) Michael Cimino
Reservoir dogs (1992) Quentin Tarantino
Miller's crossing (1991) Frères Coen
The funeral (Nos funérailles – 1996) Abel Ferrara
Goodfellas (Les affranchis – 1990) Martin Scorcese
Q & A (Contre-enquête - 1990) Sidney Lumet

Source : filmbug
Du monde entier
Once upon a time in America (Il était une fois en Amérique – 1984) Sergio Leone
Panique (1946) Julien Duvivier
La sirène du Mississipi (1968) François Truffaut
Time and tide (2001) Tsui Hark
Bande à part (1964) Jean Luc Godard
Quai des orfèvres (1947) H. G. Clouzot
Tengoku to jigoku (Entre le ciel et l'enfer - 1963) Akira Kurosawa
Koroshi No Rakuin (La marque du tueur – 1963) Seijun Suzuki
Hana-Bi (1997) Takeshi Kitano
Arrivederci amore ciao (2006) Michele Soavi
23:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : film noir | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/04/2009
Pour Pierre Etaix
"Deux fois dans ma vie j'ai connu le sens du mot génie. La première fois en regardant dans le dictionnaire, la seconde fois en rencontrant Pierre Etaix » Jerry Lewis.
Dans la série « le monde merveilleux des droits d'auteur », il y a l'histoire de Pierre Etaix. Si son nom parle encore à nombre de cinéphiles, ses films tendent à devenir un simple souvenir prestigieux parce que, tout simplement, il n'est plus possible de voir ses films. Etaix n'y est pour rien. A quatre-vingt ans, il n'a plus le droit de montrer ses propres films. Ses cinq longs métrages (dont quatre co-écrits avec Jean-Claude Carrière) sont aujourd'hui totalement invisibles, victimes d'un imbroglio juridique scandaleux qui prive les auteurs de leurs droits et interdit toute diffusion (même gratuite) de leurs films. Pour avoir les détails, vous pouvez regarder ce joli petit film :
Il y a quelques temps que circule une pétition, notamment sur Kinok. En juin 2008, 16 000 signatures (dont la mienne) ont été remises aux avocats de Pierre Etaix et Jean-Claude Carrière. Visiblement, ce n'était pas assez. Le 28 novembre 2008, les auteurs se sont vu refuser le droit de procéder à la restauration de leurs films (une restauration pourtant jugée urgente et dont le financement était assuré). On pourrait appeler cela non assistance à oeuvre en danger. Mais bon, les amis du cinéaste n'ont pas désarmé et lancent un nouvel appel. L'objectif est d'atteindre 50 000 signatures et de remettre la pétition à madame Albanel, la hum-ministre de la hum-culture pour l'ouverture du festival de Cannes. Je ne suis pas d'assez bonne humeur pour être optimiste, mais on ne sait jamais.
Alors si vous avez envie de revoir ou de découvrir les films de Pierre Etaix correctement, si vous estimez comme moi que ce genre de situation est inadmissible par principe, si vous estimez qu'il serait lamentable que la seule façon à l'avenir de voir ces films serait de passer par des copies approximatives issus de réseaux que hadopi réprouve, il vous reste à signer la pétition. C'est par là.
21:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pierre etaix | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
11/04/2009
Un moment springsteenien
Il y a une scène que j'aime vraiment bien dans The wrestler de Darren Aronofsky. C'est celle où le personnage du catcheur déchu, Randy "The Ram" Robinson joué par Mickey Rourke (dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le Stanley White de Michael Cimino), tente de renouer avec sa fille jouée par Evan Rachel Wood. Passé un moment, il la convainc d'aller se balader sur la promenade d'Asbury Park, entre le Convention Hall et le casino. C'était l'endroit où il la menait quand elle était petite fille. Le couple déambule sur le front de mer, de grands espaces désertés, une ancienne salle en ruine. Les plans sont larges et respirent la grandeur passée. Les couleurs sont désaturées, comme passées par le temps. Au cœur de la grande salle, dans le souvenir d'un orchestre fantôme, père et fille esquissent quelques pas de danse. Un moment apaisé dans un film tout en mouvement et au montage acharné. Un temps de mystère qui m'a ramené au décor final de Carnival of the souls de Herk Harvey.
Mais bon, pour moi, c'est surtout l'ambiance de quelques-unes des plus belles chansons de Bruce Springsteen qui se déroulent autour d'Asbury Park comme Sandy (4th of july, Asbury Park)
And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers along the shore
Chasin' all them silly New York girls
Ou la fameuse Born to run
The amusement park rises bold and stark
Kids are huddled on the beach in a mist
C'est de retrouver cette qualité d'émotion qui m'a séduit, tout comme ma récente sensibilité aux histoires de pères et de filles. On retrouve cette mélancolie dans le morceau final écrit par Springsteen par amitié pour Mickey Rourke. Mais pourquoi, bon sang, sur le générique quand tout le monde se précipite hors de la salle ! Étonnant par ailleurs l'allure du Boss dans le clip du morceau, reprenant des extraits du film tandis qu'il chante sur un ring déserté. Springsteen, tel un caméléon, s'est fait le corps de Rourke. En habitant ainsi sa chanson, en investissant le personnage (la chanson est à la première personne), on pourrait dire que Springsteen joue plus que Rourke, puisque l'on nous a tellement souligné que Randy « The Ram » était Mickey Rourke. Si cela peut passer pour un compliment envers le boxeur, c'est assez vache pour l'acteur.
Have you ever seen a one-legged dog making its way down the street?
If you've ever seen a one-legged dog then you've seen me
Pour le reste, je ne suis pas trop amateur du cinéma de Darren Aronofsky. Sa mise en scène est voyante, même si elle est très maîtrisée, et convient mal me semble-t'il à une histoire somme toute classique, comme on en a vu pas mal depuis The set-up (Nous avons gagné ce soir - 1949) de Robert Wise. Du coup, ce sont quand même les acteurs qui font la valeur de ce film, donnant parfois même l'impression de batailler contre les effets de la réalisation.
23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : darren aronofsky, bruce springsteen | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/04/2009
Rumba
Le plus difficile pour aborder Rumba, la délicate comédie signée à trois mains par Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy, c'est de ne pas commencer par empiler les références. Difficile parce que le film s'inscrit résolument dans une prestigieuse lignée qui va de Buster Keaton à Aki Kaurismaki en passant par Jerry Lewis et Jacques Tati. Et oui quand même. Pourtant, il faut bien vous situer la chose puisque le brillant trio ne reste connu que d'une poignée d'admirateurs au franc sourire que je viens de rejoindre sur le champ. Et mon but, lecteurs chéris, c'est d'élargir leur audience, partager le plaisir du rire qui est le propre de l'homme au lieu de vous abandonner à la 187e rediffusion télévisée de Bienvenue chez les bronzés. De quoi ? Non, je ne me résous point à discourir de ce film avec trop de sérieux. J'ai essayé, je vous jure, mais je m'ennuie moi-même. Alors, vous, vous pensez bien...
(La suite sur Kinok)

Le site du film
Le DVD
Un entretien avec les auteurs
Photographie : © MK2 Diffusion
22:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dominique abel, fiona gordon, bruno romy | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
06/04/2009
Bon point
22:51 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blog, john ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/04/2009
5 x 13
Ah, un questionnaire ! Plutôt originale, cette variation en titres proposée par Joachim de 365 jours ouvrable (qui fête ses deux ans, soit dit en passant et en lui souhaitant un bon anniversaire) :
5 films dont la deuxième vision est meilleure que la première, puis la troisième meilleure que la deuxième puis la quatrième meilleure que la troisième puis la cinquième... : Rio Bravo (Hawks), The quiet man (Ford), Lawrence d'Arabie (Lean), Heaven's gate (Cimino), Mon voisin Totoro (Miyazaki)
5 films que j’ai dû voir trois, quatre, cinq, six fois et plus, mais je n’aimerais pas trop que ça se sache : On l'appelle Trinita (Barboni), Cul et chemise (Zingarelli), L'aile ou la cuisse (Zidi), La grande évasion (Sturges), Le maître du kung-fu attaque (Wang-Yu)
5 réussites incontestables (qui plus est, signées de grands cinéastes) mais qui ne me touchent pas trop : Persona (Bergman), Stalker (Tarkovski), Théorème (Pasolini), La ligne rouge (Malik), Elephant (Van Sant)
5 films qui m’ont laissé de mauvais souvenirs, mais vu le calibre de leurs auteurs, j’ose à peine le dire : Hook (Spielberg), Dieu est mort (Ford), Les communiants (Bergman), L'avventura (Antonioni), Eraserhead (Lynch)

Saint questionnaire, priez pour nous
5 films réputés mineurs ou oublié, signés par des cinéastes reconnus, mais qui m’ont davantage impressionné que certains de leurs titres emblématiques : Always (Spielberg), Peggy Sue got married (Coppola), Madadayo (Kurosawa), La montée au ciel (Bunuel), The trouble with Harry (Hitchcock)
5 grands chocs cinématographiques malgré les conditions déplorables de leur découverte : Casino (Scorcese) malade comme un chien, Crash (Connenberg) séance houleuse à Cannes, 8 1/2 (Fellini) vu d'abord une demi-heure dans le cadre d'un concours, L'idiot (Kurosawa) inversion de bobines, Lawrence d'Arabie (Lean) première vision à la télévision, en français et noir et blanc (!)
5 films dont j’ai eu une vision totalement différente selon la période de la vie à laquelle je les ai vus : La prisonnière du désert (Ford), Rio Bravo (Hawks), King Kong (Schoedsack et Cooper), 2001 (Kubrick), Il était une fois la révolution (Léone)
5 films dont j’ai dit à tout le monde que je les avais vus, alors que ce n’était que par fragments, parfois espacés de plusieurs années, au hasard des diffusions télé, de la disponibilité du magnétoscope ou du DVD : Le seul qui s'approche de cette définition, en tant que spectateur, c'est L'avventura d'Antonioni. je crois bien que je me suis endormi avant la fin. Mais dans mon travail associatif, il m'arrive d'interrompre un film avant la fin quand je le trouve très mauvais et de rester diplomatique avec son auteur.
5 films que tout le monde aime, mais moi j’y arrive pas : L'aldilà (Fulci), Coeurs (Resnais), Cendrillon (Disney), Les dames du bois de Boulogne (Bresson), L'avventura (Antonioni)

Notre héros réfléchit aux réponses
5 films où j’ai d’abord souffert / été déçu au début de la projection puis au bout d’un moment, whaoooaaaaah : Le retour de Ringo (Tessari), Rosetta (Les frères Dardenne), Pierrot le fou (Godard), Flowers of Shanghai ( Hsiao Hsien), Alamo (Wayne)
5 films que je continue à défendre bien que signés de cinéastes qu’on adore détester : Schindler's list (Spielberg), Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil (Yanne), Katyn (Wajda), Sudden impact (Eastwood), Le syndrome de Stendhal (Argento)
5 films d’abord aimés puis ensuite rejetés : Midnight express (Parker), High Noon (Zinnemann), Le gaucher (Penn), The Killer (Woo), Le gendarme de St Tropez (Girault)
5 films d’abord incompris ou rejetés puis ensuite aimés voire adorés : Roma (Fellini), Les deux cavaliers (Ford), Un condé (Boisset), Je t'aime, je t'aime (Resnais), Annie Hall (Allen)
Pour la question subsidiaire, je me souviens surtout d'avoir vu La rage du tigre de Chang Cheh en séance spéciale à Cannes avec Tsui Hark et David Carradine (c'était l'année Tarantino).
17:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/04/2009
Hommage au compositeur
Tilaaa tilalalalala tilaaaa mhmmmmmouou ouou tilalalala
Il m'est impossible, depuis des années, de monter sur le moindre tas de sable, sur un dromadaire ou un chameau, sans me sentir instantanément envahi par les accords divinement lyriques de Maurice Jarre. Rien que de fredonner je me vois vêtu de blanc, dans le vent du désert, marchand à grands pas sur les toits du train tandis que des dizaines de guerriers arabes m'acclament. Tel sont les ravages des compositions de Jarre sur mon impressionable personne.
J'ai appris qu'il avait une formation de timbalier. Cela se sent dans ce qu'il a apporté de neuf dans la musique de film à partir des années 60. Un son plus moderne souvent basé sur une utilisation créative des percussions. Ce qui ne l'empêchait pas d'écrire avec beaucoup de délicatesse. On a beaucoup cité les musiques à succès et à oscars sur lesquelles je me garderais bien de faire la fine bouche. Mais Jarre a également composé, comme Ennio Morricone et Jerry Goldsmith, ses contemporains, pour des films qui ne le méritaient pas toujours et auxquels ses accents épiques donnent un minimum de tenue. Je pense à ses westerns, Villa rides (Pancho Villa – 1968) de Buzz Kulik, El Condor (1970) de John Guillermin ou encore Red Sun (Soleil rouge – 1971) de Terence Young. Il n'est pas étonnant qu'il se soit si bien entendu avec David Lean, qui concevait le cinéma comme plus grand que nature. Épique oui.
Ce souffle de l'aventure, il l'a donné à John Huston pour The man who would be king (L'homme qui voulut être roi – 1976), à Robert Stevenson pour un film de mon enfance estampillé Disney, The island on the top of the world (L'île sur le toit du monde – 1974), à Richard Brooks pour The professionals (Les professionnels – 1966). Je suis moins fan de ses compositions à partir des années 80, quand il découvre les instruments électroniques, notamment dans sa collaboration avec Peter Weir. Mais le morceau qui accompagne la scène ou Lawrence ramène Gassim au camp d'Ali, quand il apparaît comme un point loin, très loin à l'horizon du désert, et puis avance tandis que la mélodie prend son essor, c'est tout en haut de mon panthéon personnel.
23:08 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : maurice jarre | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/03/2009
Les pirates du rail
Je suis toujours étonné de la façon dont les premiers films que j'ai vus sont restés en moi au-delà de ce que j'ai pu voir ou apprendre depuis. Prenons Christian-Jaque par exemple. Pas tout à fait le type du metteur en scène que l'on va chercher à réhabiliter. Le type « chefs d'œuvres méconnus ». Plutôt du genre de ceux qui se sont fait piétiner allègrement par la Nouvelle Vague, non parfois sans raisons. Plutôt du genre populaire, à succès et récompenses, sans grande ambition formelle apparente, progressivement dépassé par l'évolution du cinéma français dans les années 50 puis 60. Pourtant, pourtant, si je prends le temps de la réflexion, certains films de Christian-Jaque sont liés à mes premiers souvenirs de cinéma, des souvenirs que je lie avec mes lectures d'enfance, de Jules Verne à Conan Doyle en passant par Enid Blyton et Mark Twain. Ce sont le squelette Martin et la société secrète des Chiche-Capons (Les disparus de St Agil – 1938), le bondissant Fanfan la Tulipe (1952) avec Gérard Philippe (Le décolleté de Gina Lollobrigida, ça sera pour plus tard), les bolides improbables de Raphaël le tatoué (1938), la chèvre et le Larousse de Fernandel dans François 1er (1937). Quand je retombe sur l'un de ces films aujourd'hui, je trouve que certains ont plutôt bien tenu le coup. J'ai même été surpris de découvrir une œuvre comme Le repas des fauves (1964) un huis clos dans lequel, pendant l'occupation, un groupe d'amis est obligé de désigner l'un d'entre eux comme otage par les allemands. Un film amer et d'une rigueur de mise en scène irréprochable. Pour peu que l'on s'y attache, on trouve dans le cinéma de Christian-Jaque de bien belles choses : sa façon de filmer les couloirs déserts dans le pensionnat de St Agil, son sens du rythme, ses effets de montage et ses scènes à suspense, des gros plans saisissants. Et puis il possède une certaine fraicheur du cinéma des origines, un souffle pour l'aventure et une décontraction non feinte qui se perdront, il est vrai dans les dernières années d'une longue carrière.
Parmi tout ces films qui m'ont marqué, l'un de mes tout premiers souvenirs est lié aux Pirates du rail, un film réalisé en 1937. Ça se passe en Chine sur une ligne de chemin de fer construite et gérée par des français, en butte aux raids de seigneurs de la guerre pour lesquels elle est devenue un enjeu. La compagnie est dirigée par la main de fer de l'ingénieur Pierson, joué par Charles Vanel qui va se retrouver au cœur d'un conflit entre deux généraux, Tchou King et Tsai (Erich Von Stroheim et Lucas Gridoux) et un chef de bande, Wang (Valéry Inkijinoff), dont il est frère de sang.
Dès les premières scènes, nous sommes plongés dans une sorte de western à l'Est avec bandes de cavaliers cavalcadant dans les montagnes, attaque de ville, messages alarmants transmis par télégraphe et téléphone sur la situation de la ligne. Deux trains sont engagés, arriveront-ils à temps ? Il y a très peu de dialogues, surtout des noms exotiques qui aident au dépaysement. Cette première partie est très réussie. Après un superbe panoramique sur une cité chinoise, Christian-Jaque filme une première attaque avec un montage très vif, brisant allègrement la règle des 180°, traduisant le mouvement frénétique de l'assaut. Ce montage lui permet aussi de ne pas s'attarder sur la figuration. J'ai appris bien plus tard que ce film avait été tourné dans les Alpes-Maritimes, dans les studios de la Victorine et sur les lignes de chemin de fer de Cannes-Grasse et de Nice-Digne. Pour qui connait la région, c'est assez amusant. Les gares typiques sont ornées de jolis panneaux en chinois et l'on a fait appel à tous les extras asiatiques du département. Cela n'a sans doute pas suffit puisque l'on peut sans peine reconnaître des physionomies bien méridionales dans les fameux pirates. Mais ce n'est pas pire que bien des indiens dans les westerns d'outre Atlantique.
Mon ancien souvenir est lié à une scène qui a conservé son potentiel de beauté macabre. Le second train est attaqué, de nuit sous l'orage, et mitraillé sans pitié. Un peu plus tard, il arrive en gare, lentement sous une pluie battante. Pierson et ses hommes, déjà bien angoissés, voient s'avancer le convoi sombre, sifflant lugubrement (bande son impeccable sans recours à une musique pléonastique). Le train s'arrête doucement, défilant devant les hommes sur le quai et révélant les cadavres qui pendent aux portières. Le chauffeur blessé s'écroule dans un ultime effort. J'en ai rêvé pendant des années.
Un autre passage m'avait marqué par son étrangeté. La femme de l'ingénieur se rend chez un général pour demander son aide. Elle est introduite dans un palais par un officier étrangement souriant. Elle passe devant des sentinelles raides comme des statues, dans un silence de mausolée. Dans une vaste pièce, elle s'avance vers le général en question, assis à son bureau. Celui-ci s'affaisse d'un coup, mort. Entre derrière elle la silhouette raide et massive d'Erich Von Stroheim. En revoyant cette scène admirable de tension silencieuse et d'esprit feuilletonesque, je me disais que l'on était proche de l'esthétique d'un Von Stenberg. Proche seulement.

Aujourd'hui, Les pirates du rail garde pour moi un charme entêtant. Il alterne les scènes fortes (celles déjà citées, l'attaque d'un couple sur la ligne et la femme qui devient progressivement folle, les moments avec Von Stroheim), avec des passages plus faibles qui doivent surtout à un scenario mal ficelé et à une certaine désinvolture quand à la crédibilité de certains personnages. Si la première partie est rigoureusement construite, la fin enchaîne les invraisemblances (Tchou King perd d'un coup son armée) et nous transporte dans un monastère certes esthétique mais complètement incongru. Reste que Von Stroheim, tout à fait savoureux en émule asiatique de son personnage de La grande illusion, ressemble autant à un seigneur de la guerre chinois que moi à Bruce Willis. Enfin le film dégage une bonne conscience coloniale bien de son époque, entre Tintin au Congo, les Tarzan MGM et les aventures de Buck Danny. Avec un minimum de recul, ça passe tout seul. Cela peut même prendre un tour exceptionnel avec le duo Doumel (Les rois du Sport, César, Ignace) et Maupi (inoubliable visage pagnolesque, c'est lui le chauffeur de la trilogie). Le premier est Morganti un marseillais sans nuance qui a sa propre méthode de « civilisation ». Maupi joue un indigène surnommé Titin, premier résultat de cette méthode. Résultat : il sert le pastis, rêve d'un bateau sur le port de Marseille, peste contre ses compatriotes et s'exprime avec l'accent du vieux port. A un français admiratif « Il a même l'accent ! », Morganti répond « Qué accent ? ». Si ce n'est pas de la comédie.
Au crédit du film, la musique de Henri Verdun tranche agréablement avec les partitions ronflantes et stridentes de l'époque. Utilisée judicieusement, elle développe quelques thèmes héroïques tout à fait acceptables. La photographie signé de Marcel Lucien, André Germain et Pierre Lebon est souvent réussie, plus dans les séquences d'intérieur et de nuit (l'arrivée du train encore) que dans les extérieurs qui manquent un peu de puissance. Mais certains gros plans (Stroheim, Suzy Prim) sont expressionnistes à souhait et frappent l'imagination. Le film possède enfin une belle distribution. Charles Vanel est un peu raide, comme le veut son rôle mais sans trop de nuance. Simone Renan joue sa femme avec élégance, Suzy Prim y devient folle de façon convaincante. Von Stroheim, Inkijinoff et Lucas Gridoux s'amusent avec leurs personnages chinois. En support, on retrouve avec plaisir Dalio, Maupi, Doumel et le visage inquiétant de Héléna Manson (Le corbeau de H.G. Clouzot).
Les pirates du rail auraient pu être une sorte de Only angels have wings (Seuls les anges ont des ailes – 1939) de Howard Hawks, version ferroviaire. S'il vaut la peine d'être découvert, il n'en est malheureusement pas du même niveau. Il reste le témoin d'un cinéma d'aventure naïf et mouvementé et de la fantaisie de son auteur.
Photographie : Première.fr
Affiche : Moviecovers.com
17:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : christian-jaque | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/03/2009
Ariane
De l'amour entre une très jeune femme et un homme d'âge mûr, le cinéma européen fait volontiers un drame : Tristana (1970) de Luis Bunuel, Noces Blanches (1989) de Jean-Claude Brisseau, La peau douce (1964) de François Truffaut. Le cinéma américain pencherait plutôt pour la comédie et a constitué quelques couples mythiques sur la base d'une différence d'âge conséquente : Lauren Bacall et Humphrey Bogart ou Angie Dickinson et John Wayne. Au coeur des années 50, entre maccarthysme et regain ultime de la censure du code Hays, apparaît la fine silhouette et le visage angélique d'Audrey Hepburn qui aura comme partenaires quelques acteurs qui étaient déjà des stars quand elle portait encore des couches. Le rude Bogart dans Sabrina de Billy Wilder en 1954, l'aérien Fred Astaire dans Funny face de Stanley Donen en 1957 et, la même année, le viril Gary Cooper dans Love in the afternoon « Ariane », toujours de Wilder et qui nous occupe ici.
(La suite sur Kinok)
le DVD
08:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : billy wilder | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
24/03/2009
Films de vacances
Je suis donc parti passer une semaine à la montagne histoire de prendre l'air et de monter à ma fille comment on fait de la luge et comment on monte un bonhomme de neige. Et puis j'ai emmené quelques films aussi. Pour commencer, je suis tombé à la télévision sur Gentlemen Prefer Blondes (Les hommes préfèrent les blondes - 1953), le film de Howard Hawks avec La Monroe et La Russel. Hélas, c'était La version française dans laquelle même les chansons sont doublées. C'est irregardable, enfin inécoutable. J'ai tenu malgré mon amour pour ce film, une vingtaine de minutes. Je me suis consolé avec The Life and Death of Colonel Blimp (Colonel Blimp - 1943) de Michael Powell et d'Emeric Pressburger film fleuve aussi drôle qu'émouvant et fondamentalement beau. Comme je l'ai dit chez Christophe, je me sens assez incapable d'écrire sur un tel film. Je trouve difficile d'exprimer l'enchantement constant que me procure la mise en scène virtuose, le panache de certaines scènes et le visage de Deborah Kerr.
Devoir de vacances avec Love in the afternoon « Ariane », l'excellente comédie de Billy Wilder avec Audrey Hepburn, Gary Cooper et Maurice Chevalier. Je voulais monter ce film à ma compagne, et ça me permet de le voir une seconde fois pour travailler ma chronique pour Kinok. Contrairement au souvenir que j'avais du film, c'est véritablement une très belle oeuvre placée sous le signe de Lubitsch et il me faudra plusieurs jours pour accoucher de mon texte.
Comme là nous avions le temps, nous en avons profité pour montrer de nouvelles choses à notre fille. Je lui ai dégoté Le chien, le général et les oiseaux (2003) un dessin animé de Francis Nielsen. C'est l'histoire d'un général de l'armée russe qui ne se remet pas d'avoir sacrifié les oiseaux de Moscou pour brûler la ville envahie par l'armée de Napoléon. Devenu vieux, il ne peut se déplacer sans un parapluie car les oiseaux rancuniers lui fientent dessus. Il trouvera la rédemption et le pardon grâce à un chien pas banal. Le conte est joli et le graphisme original. Mais si ma fille a été captivée, le grand air a provoqué rapidement ma somnolence et je vais devoir revoir la chose avant de vous en dire plus.
Un soir un peu tard, seul dans le silence des montagnes sublimes, je me suis regardé Bowfinger, une comédie signée Franck Oz de 1999. Écrit et joué par Steve Martin dont l'humour n'est jamais bien passé chez nous, le film est une ode pleine de bons sentiments au plaisir de faire des films. Martin joue un réalisateur-producteur minable mais sincère qui décide de faire un film avec une grande star qu'il va filmer à son insu. La star, c'est Eddie Murphy qui, comme à son habitude, joue plusieurs rôles dont celui de son jumeau pas célèbre du tout. C'est assez drôle, un cran au dessous du Ed Wood de Burton où du récent Be kind rewind de Gondry. La mise en scène de Oz est assez plate mais respecte les numéros de comédiens qui se régalent visiblement comme Murphy en Star paranoïaque, Terence Stamp en gourou ou Heather Graham en starlette nymphomane.
Madagascar de Tom McGrath et Éric Darnell est une grosse production Dreamworks d'animation en images de synthèse. Ça pète dans tous les sens, c'est très coloré, c'est d'un rythme très rapide, c'est bourré d'idées et ça brosse le spectateur dans le sens du poil. Pour une enfant de trois ans, je pense que c'est un peu trop intense et un peu trop référencé. Cette fois, c'est ma fille qui a décroché. La parodie plutôt amusante du plan final de Planet of the apes (version 1968) avec Charlton Heston désespéré au pied de la statue de la liberté, ça ne lui a pas dit grand chose. Côté esthétique, je ne suis pas très fan du genre mais ici, je reconnais que j'aime beaucoup le commando des quatre pingouins.

Le suivant, c'était une séance de rattrapage pour ma compagne. Et puis c'est bien tombé, avec toutes ces discussions sur Gran Torino. J'appréhendais un peu de revoir Million dollar baby. C'est le premier film de Clint Eastwood dans sa dernière période que je revois. Je suis resté sous le charme, plus attentif à sa mise en scène qui est quand même l'une de ses plus travaillées. Dans les compositions très sombres, notamment dans la salle de boxe, il y a une beauté qui évite le côté ostentatoire de films plus « prestigieux » (disons Mystic river) mais franchement affirmée contrairement à son dernier opus qui travaille plus dans la discrétion. J'ai bien sûr été tout particulièrement attentif au traitement de la famille de Maggie. Eastwood ne les ménage pas, mais en même temps, ils sont les briseurs de rêve. Je ne crois pourtant pas qu'il faille y voir un équivalent aux « salauds de pauvres » d'Autant Lara. Après tout, tous les personnages de ce film sont des gens durement touchés par la vie, comme Scrap, le personnage de Morgan Freeman ou le jeune Danger. Ce qui les différentie, c'est leur attitude en tant qu'individus. Et c'est de façon profondément individuelle qu'agit, in fine, Frankie.
Retour à un peu de légèreté avec Anastasia, le dessin animé réalisé par Don Bluth et Gary Goldman en 1997. C'était le premier dessin animé produit alors par la 20th Century Fox et j'en avait gardé un souvenir assez fort. Somptueux, le film mêle adroitement les techniques classiques d'animation avec des effets numériques (la séquence du train). Il y a des plans de toute beauté, vastes fresques minutieusement animées : les scènes de bal, la chorégraphie dans les enfers, la séquence de la tempête en mer. Le couple Anastasia / Dimitri fonctionne sur les ressorts les plus classiques de la comédie des années 30/40 avec des dialogues brillants illustrant les disputes des amants en devenir. C'est du travail d'orfèvre. Visiblement, le film fonctionne à ses différents niveaux et si je suis resté sensible au spectacle et à son humour jamais niais, ma fille est restée bouche bée par cette histoire de princesse orpheline, appréciant les nombreuses séquences musicales et le méchant Raspoutine aux morceaux amovibles. La délicieuse chauve-souris Bartok permet en outre de désamorcer les moments les plus terrifiants.
Soirée classique avec le Otto e mezzo (8 ½ - 1963) de Federico Fellini. Je voulais, là encore le montrer à ma compagne qui ne le connaît pas encore. Cette fois, c'est elle qui a piqué du nez à mon grand désappointement. Il faut dire que j'ai récupéré l'édition Criterion, de toute beauté et bourrée de bonus, mais sans sous titrage français. Comme ma compagne ne maîtrise pas l'italien, ce n'était pas évident de suivre avec les sous titres anglais. J'ajouterais que j'ai dû moi-même m'y reprendre à deux fois avant d'apprécier le film. Aujourd'hui, je dois en être à ma huitième vision, et je commence à bien circuler dans les méandres de ce film labyrinthe. J'ai désormais tout le temps de m'attarder sur les plans sublimes baignés de la lumière en noir et blanc de Gianni Di Venanzo (que son nom soit loué), et sur les visages de Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Barbara Steele, Sandra Milo, Caterina Boratto et Rosella Falk. Assez, c'est trop, mon regard chavire...

Conclusion de la semaine avec un ultime dessin animé, mais des meilleurs : La prophétie des grenouilles (2003) de Jacques-Rémy Gired, auquel on doit L'enfant au grelot et le récent Mia et le Migou. Conte humaniste et écologique, variation sur l'histoire de l'Arche de Noé, le film possède un graphisme simple et original. Un brusque déluge amène de nombreux animaux à se réfugier dans une grange montée sur une chambre à air (!) en compagnie d'une famille « recomposée », sous la direction d'un sympathique capitaine-fermier joueur de guitare. Herbivores et carnivores vont de voir se supporter et survivre grâce à une imposante réserve de pommes de terre. Il est amusant de constater que ce film aborde avec franchise le sujet que l'américain Madagascar élude hypocritement. Il s'agit dans les deux cas de l'improbable coexistence entre chasseur et proie. Gired montre, non sans humour mais avec franchise, les renards, lions et tigres plumer et embrocher des poulets dans une crise de violence dont ils seront, quand même, honteux plus tard. Ma fille a adoré (elle l'a déjà vu plusieurs fois) et semble bien comprendre les ressorts du film. J'avoue que pour ma part, j'ai un faible pour le couple d'éléphants auxquels Michel Galabru et Annie Girardot prêtent leurs voix. Le reste de la distribution n'est pas mal non plus avec Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Jacques Higelin, Thomas Fersen et quelques autres.
Les meilleurs choses ont une fin, les vacances aussi. J'ai aussi vu Welcome en salle et il va falloir que je travaille là-dessus.
Photographies : capture DVD Criterion
23:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : howard hawks, michael powell, emeric pressburger, clint eastwood, billy wilder, franck oz, francis nielsen, jacques-rémy gired, tom mcgrath, Éric darnell | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |