16/06/2009
Diana Rigg aux mille visages





22:56 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : diana rigg | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/06/2009
Hawks
Deux articles en anglais autour de l'oeuvre de Howard Hawks que tous ceux qui l'ont vue disent hallucinante comme chante le poète. Tout d'abord Howard Hawks: A man for all genres de Luke Baynes sur le site Examiner.com. Un article qui se place d'emblée sous le patronage de la French auteur theory et qui cite Jean-Luc Godard pour faire bonne mesure. Rapide tour d'horizon d'une oeuvre aux multiples facettes, aux multiples richesses. Avec en prime deux extraits vidéo dont le fameuse scène dite de la bière sanglante dans Rio Bravo (1959).
59? Et oui bon sang mais c'est bien sûr ! Rio Bravo fête cette année ses 50 ans. Le film des films a un demi-siècle et pas une ride. Je sens les idées qui se bousculent, mais sois sage o ma joie et tiens-toi plus tranquille. Et pour patienter, voici un texte de Leo Grin sur Big Hollywood : Haunted by the Memory of Her Song: Fifty Years of Rio Bravo qui s'ouvre sur l'immortelle ballade :
The sun is sinking in the west
The cattle go down to the stream
The redwing settles in her nest
It’s time for a cowboy to dream….
13:26 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : howard hawks | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/06/2009
Broken arrow au coin du feu
Sur le forum western movies la discussion « autour du feu » du mois de juin roule autour de Broken arrow (La flèche brisée – 1950), le film de Delmer Daves avec James Stewart. Stewart y incarne Thomas Jeffords, personnage réel dans une version romancée, forcément, de ses efforts pour ramener la paix entre blancs et apaches dirigés par le chef Cochise. Dans le film, Cochise est incarné par Jeff Chandler, beau et digne mais assez moyennement crédible. Jeffords y tombe amoureux d'une belle indienne, jouée par une habituée de ce type de rôles, Debra Paget. Je n'ai pas encore eu le temps de revoir ce film qui fait partie des oeuvres qui ont marqué mon enfance. Pour être franc, je ne m'en sens pas trop l'envie, peut être pour préserver le souvenir de ce film qui a façonné pour des années une vision simpliste de l'histoire de l'ouest.

Daves, non sans mérite à l'époque, fait un des premiers films « progressistes » vis à vis des indiens. Il développe l'idée que la compréhension entre les deux communautés était possible, qu'entre gens d'honneur et sensés, une juste paix est possible, que la justice peut triompher et l'Amérique en sortie grandie. C'est un voeux pieux mais un joli mensonge. Avec le temps et la compréhension des oeuvres de Ford, de Fuller ou d'Aldrich, Broken arrow tient très mal la route sur le fond, plus mal encore que d'autres westerns du même tonneau qui ont eu l'habileté de décaler le problème comme Devil's Doorway (La Porte du diable) d'Anthony Mann tourné la même année, Across the wide Missouri (Au-delà du Missouri – 1951) de William Wellman ou l'élégiaque The big Sky (La captive aux yeux clairs – 1952) de Howard Hawks. Reste l'élégance de la mise en scène de Daves, qui ne cessera de s'affirmer tout au long des années 50, une mise en scène au beau classicisme, et surtout la prestation de James Stewart qui apporte au film l'idéalisme des films de Franck Capra et cette dose d'humanité qui transcende les clichés. Si je me décide, ça sera pour lui.
Pour prolonger la réflexion, je vous invite aussi à lire le texte rude mais bien vu de Tepepa qui aborde les problèmes que le film peut poser aujourd'hui. Et rappelle au passage quelques évidences que la nostalgie tente de nous faire oublier.
Affiche source Ciné.CH
22:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : delmer daves, james stewart | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/06/2009
Claude Chabrol blog-a-thon
Claude Chabrol fêtera ses 79 ans le 24 juin prochain. Pour l'occasion, nos amis américains proposent à l'initiative de Flickhead un blog-a-thon du 21 au 30 juin autour du metteur en scène du Boucher (1970). Ray Young, l'animateur de Flickhead qui par ailleurs a créé le Claude Chabrol Project, nous annonce « Ten Days’ Wonder ». Je serais ravi de participer, j'ai même déjà reçu de quoi travailler avec Les biches (1968), Juste avant la nuit (1971) et Marie-Chantal contre Dr Kha (1965). Si certains de mes camarades blogueurs sont tentés, je vous rappele qu'il suffit, entre les dates proposées, d'écrire un ou plusieurs articles sur Chabrol et de le signaler à l'organisateur qui centralise l'ensemble des contributions. D'ici là pour patienter, vous pouvez passer lire le beau texte de Griffe sur le tout récent Bellamy.

13:23 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : claude chabrol, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
09/06/2009
Maestro

Sergio Corbucci pensif devant Franco Nero décontracté sur le tournage de Il mercenario (Le mercenaire - 1968). Source Tout le ciné (© DR).
07:18 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : sergio corbucci, franco nero | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/06/2009
David Carradine (so long)
Ça serait dommage de limiter David Carradine à Bill mais quand même. Moi aussi, j'ai regardé "petit scarabée" à la télévision assis sur la moquette quand j'avais 12 ans. Il a une fimographie impressionante en volume, avec un nombre incroyable de mauvaises choses. Il faut pourtant se souvenir qu'il a été Woody Guthrie pour Hal Ashby, le coureur automobile vêtu de noir appelé Frankenstein pour Paul Bartel, syndicaliste pour Martin Scorcese aux côtés de son père John éminente figure fordienne, frère James en compagnie de ses frères Keith et Robert pour Walter Hill, qu'il a joué pour Jean Yanne et Ingmar Bergman mais ce n'étaient pas leurs meilleurs films, qu'il levait bien la jambe contre Chuck Norris et qu'après tout mourir au cinéma sur « How do i look ? « / « You look ready », c'était la grande classe.
23:06 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : david carradine | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/06/2009
Cannes 2009 - jour 9
Audiard pour l'extinction des feux
Ça se termine. Les tentes sur la plage se replient, le marché est fermé, quelques centaines de privilégiés se préparent pour la soirée de clôture. L'air bruit de rumeurs, de spéculations, parfois d'informations plus fiables. Reste un long marathon de reprises des films de la compétition qui permet dès 8h30 de combler quelques lacunes. Un ensemble de paramètres et la sortie prochaine d'Antichist m'ont amené à terminer cette édition par le film de Jacques Audiard, Un prophète. Je me méfie toujours des éloges qui peuvent entourer un film français parce qu'après tout, notre cinéma national est le local de l'étape. Sur ce plan, le festival n'échappe pas à une sorte d'effet football. Et puis l'an passé, la palme avait déjà été à un français, alors, point trop n'en faut. Bref, il fallait faire un choix, j'ai vu Un prophète puis je suis rentré chez moi pour décompresser et suivre la cérémonie sur une télévision.

Le film de Jacques Audiard a une force indéniable mais je n'ai pas trouvé qu'il ait vraiment été plus loin (ou ailleurs) que le déjà très fort De battre mon coeur s'est arrêté (2005). Pour peu que l'on s'y arrête un moment, les deux films se ressemblent beaucoup. Audiard réinvestit les formes du polar classique, tant américain que français entre José Giovanni et l'inévitable Jean-Pierre Melville. Il explore des relations père-fils marquées par le désir d'émancipation du second et la violence du premier qui peine à transmettre par dureté et prend conscience un peu tard de son erreur. L'analogie est renforcée par une nouvelle composition convaincante de Niels Arestrup qui joue ici César Luciani, un truand corse emprisonné, prenant sous son aile le petit délinquant arabe Malik, joué lui par le débutant Tahar Rahim. A la base, Luciani pense manipuler Malik pour ses propres intérêts. Mal dégrossi, le jeune homme apprendra vite après un premier meurtre à valeur initiatique. Le film est le récit de son apprentissage, de la construction subtile de son propre empire et de sa réussite à la façon d'un Scarface d'aujourd'hui. Le film dégage une morale tant ambiguë qu'ironique puisque l'accomplissement du personnage passe par la prison. La taule comme école de vie et des valeurs du libéralisme. Il y a un côté anarchiste chez Audiard qui renvoie dos à dos truands à l'ancienne, petits voyous, gangs ethniques et mouvance islamiste, leurs codes, leurs croyances, leurs coutumes, leur sens de « l'honneur », tout un bric à brac qui ne tient pas devant la formule lapidaire de Malik : « Je travaille pour ma gueule ».
Ici encore, je note l'analogie entre ce parcours et celui du personnage joué par Romain Duris dans le film précédent qui finissait par se sortir d'une situation risquée pour réussir là où l'on ne l'attendait pas, manager et compagnon de la pianiste chinoise. L'introduction d'une dimension fantastique donne une originalité supplémentaire à cette histoire somme toute classique et en justifie le titre à priori énigmatique. Malik est accompagné dans sa vie quotidienne à la prison par le fantôme de l'homme qu'il a tué pour Luciani. Rêves, prémonitions, ouverture des sens, c'est ce qui vaudra son surnom de prophète et le respect, teinté comme souvent chez les truands de superstition, du chef d'une bande rivale qui deviendra une pièce maîtresse du jeu de Malik.
La mise en scène d'Audiard poursuit l'utilisation de formes utilisées depuis Sur mes lèvres (2001). Une caméra très mobile, proche des acteurs, partit pris ici justifié pleinement par le milieu carcéral, les espaces confinés des cellules, des salles de visite, du cachot d'isolement. Collant au corps de Malik, elle donne la sensation physique d'avoir perdu tout repère. Au début du film, quand il est dans le fourgon cellulaire qui l'emmène en prison, de brefs plans, comme des flashes, montrent les dernières images du dehors qu'il aura avant longtemps. Instable, le cadre traduit la tension permanente dans laquelle vivent ces hommes et le risque de la violence à tout moment. Il y a un très beau travail de direction artistique puisque les décors sont tous construits en studio. Tout ce que l'on voit est illusion. J'ai également apprécié le travail sur les voix. Les arabes parlent arabe, les corses corses et, comme dans tout récit d'apprentissage, la connaissance passe par la maîtrise de la langue. C'est en se mettant à parler le corse que Malik franchit un cap décisif et commence inconsciemment à mettre Luciani sous sa coupe. Indéniablement, question cinéma, Un prophète est plusieurs coudées au-dessus des ombreux polars actuels qu'il est inutile de nommer.
Ainsi s'achèvent mes aventures cannoises pour cette année. Vous m'accorderez quelques jours pour souffler, et puis pour rattraper mon retard sur Kinok. A tout bientôt.
Photographie : Roger Arpajou, soucre Allociné
08:22 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2009, jacques audiard | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/06/2009
Cannes 2009 - jour 8
La subversion du silence
C'est un peu par paresse que j'avais manqué à l'époque Yadon ilaheyya (Intervention divine - 2002) le précédent film d'Elia Suleiman dont j'avais entendu tant de bien. J'étais donc assez tenté par The time that remains présenté cette année en compétition officielle. Un ami dont je respecte profondément les avis m'a dit après la projection officielle, « C'est palmable ». J'ai donc mobilisé mon énergie sur cette journée pour le voir et, de fait en ressortant, je me disais aussi que ce film ferait une jolie palme de consensus. Ce dernier mot ayant été banni sans doute du vocabulaire du jury, vous savez ce qu'il en advint. C'est bien dommage parce que le film de Suleiman est impeccable, équilibré comme une belle lame, brassant l'intime et l'Histoire, le tragique et le dérisoire, et en plus c'est souvent très drôle.
Le film commence en 1948 quand la Haganah, l'armée du futur état d'Israël, investit la petite ville de Nazareth pour en prendre le contrôle. C'est la première guerre israëlo-arabe et le début du drame pour le peuple palestinien. La famille Suleiman vit à Nazareth et le père du réalisateur fait partie de la résistance. Une partie de la famille fuit en Jordanie comme des milliers d'autres palestiniens, tandis que les parents du réalisateur choisissent de rester (si l'on peut parler de choix) et deviennent des arabes israéliens à leur corps défendant. Il faut dire que le père est capturé par les soldats de la Haganah et sévèrement passé à tabac puis laissé pour mort.
En fait le film ne commence pas tout à fait là. Il commence aujourd'hui, par un trajet en taxi, un chauffeur bavard, un orage et une route qu'ils ne trouvent pas. Derrière, dans l'ombre, c'est E.S. Lui-même qui rentre chez lui. Si le chauffeur est perdu, le réalisateur voit se réveiller en lui les souvenirs et l'évocation de l'historie mêlée de sa famille et cette terre si convoitée, si compliquée, peut commencer. Quatre épisodes, quatre périodes, le temps qui passe, les hommes qui passent et des questions qui demeurent. Il y a un indéniable côté proustien à The time that remains, ne serait-ce que le titre, mais d'un Proust nourrit à l'art du burlesque.

Il y a un plan marquant, d'une terrible violence, dans la première partie. Une colonne de la Haganah s'avance de dos, sur la gauche de l'écran, ils sont vainqueurs et paradent. Sur la droite déboule une jeune femme qui les insulte copieusement. D'un mouvement vif, un soldat israélien sort un revolver et tire une balle dans la tête de la jeune femme. C'est glaçant. C'est aussi le seul plan de ce type dans tout le film. C'est habile. La violence dégagée dans ce plan suffit à créer une tension qui perdurera, même inconsciemment dans toutes les autres scènes du film. Y compris dans la scène de la torture du père, traitée par de violents contrastes entre la brutalité de l'action, le calme impressionnant du lieu (une oliveraie avec son de cigales), l'étrange détachement des soldats, l'humour noir de la mise en scène (la façon dont les soldats regardent tomber le corps qu'ils ont lancé par dessus un parapet a un fort côté dessin animé) et le silence. Du coup, on est à peine étonné que le père soit toujours vivant deux plans plus loin et d'ailleurs aucune explication ne sera donnée. Plus tard, d'autres scènes mettant en jeu des situations tendues, d'affrontement, seront traitées par l'humour. Les irruptions des policiers au domicile des Suleiman, la bataille dans la rue interrompue par le passage d'une femme avec une poussette qui dit aux soldats « Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous ? », la patrouille qui vient faire respecter le couvre feu lors d'une soirée branchée et dont les membres se mettent à danser dans leur véhicule, et puis le moment hilarant où la tourelle d'un tank suit sans faiblir un palestinien qui sort sa poubelle. Mais toujours, on garde le souvenir de ce coup de feu du début.
Burlesque donc, le burlesque de Tati, de Keaton, de Kaurismaki ou d'Abel et Gordon. Un burlesque avec tout ce que cela implique de précision dans la mise en scène, d'inventivité dans l'utilisation du cadre et de la profondeur de champ, de jeu avec le son, pour produire des images non seulement fortes mais encore chargées de sens. Et puis claires. Les affrontements entre Elia enfant et le directeur israélien de son école, deux attitudes, une phrase, le mutisme de l'enfant, suffisent à traduire le destin absurde des arabes-israéliens comme leur esprit de résistance. Chaque cadre est précisément composé, ménageant les possibilités de surprise et ses propres hors champs pour créer des effets comiques. Par exemple un gant de ménage rose qui sort de derrière une cloison pour payer un enfant qui vient de faire une course. Par exemple un ami qui saisit Elia de retour à Nazareth, par surprise de derrière un pilier. Tout ceci est si bien calculé que la caméra n'a pas besoin de bouger. De mémoire, il n'y a de tout le film qu'un seul travelling latéral sur Elia à l'école. Le mouvement est toujours interne au plan. Au niveau des compositions, le film est bien du sud, méditerranéen. Les couleurs sont vives, la lumière baignée de soleil. Il y a d'ailleurs un jeu sophistiqué entre les couleurs chaudes qui appartiennent au passé (les oliviers, les murs, les boiseries du vieux café, les meubles de la maison familiale) et les couleurs pétantes de tout ce qui est moderne, symbole aussi d'un temps sans passé qui est celui d'un peuple auquel on a volé les racines. Suleiman a parfois des compositions étonnantes qui semblent venir d'autres formes artistiques, je pense à un plan où une voiture arrive au sommet d'une pente, sur une colline arrondie. L'image semble sortie d'une bande dessinée ou d'un film de Tex Avery.
L'autre aspect marquant du film est son utilisation du silence. C'est de lui que naît l'émotion. C'est par lui que passe la force de résistance des palestiniens qui s'opposent souvent par une indifférence résolue exprimée par la dignité de leur silence. Une grande partie de The time that remains est consacré aux rapports entre Elia et sa mère. Dans la dernière partie où elle est âgée et malade, leur rapport passe sans quasiment aucune parole. De mémoire là encore, il me semble d'Elia Suleiman ne prononce quasiment pas un mot de tout le film. Cela donne une force que je n'hésite pas à qualifier de fordienne à certains passages comme le coup de la tasse sur le balcon. Mais basta, je me rends compte que j'ai envie de vous raconter les mille et un détails de ce film, tous ces moments précieux, ces morceaux de temps qui constituent The time that remains. Un film qui confirme la naissance d'un très grand cinéaste.
Un dernier détail. Il y a un passage dans lequel Suleiman-dans-le-film croise un policier qui fait la circulation avec des gestes de danseur. Je me suis demandé si Suleiman-réalisateur s'était inspiré de cette vidéo que l'on trouvait sur Internet il y a trois, quatre ans, qui montrait (pris sur le vif ou caméra cachée ?) un policier de Ramallah dans le même genre de délire poétique.
Photographie : Festival de Cannes
(à suivre)
07:20 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elia suleiman, cannes 2009 | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
31/05/2009
Cannes 2009 - jour 7
Moullet et cerise sur le gâteau
Je ne lis jamais assez bien le programme des projections à Cannes. Avec le temps, j'aime assez me laisser porter par le hasard, les rencontres et les décisions de dernière minute. Je n'avais donc pas fait attention à la programmation du nouveau film de Luc Moullet, La terre de la folie, présenté à la Quinzaine des réalisateurs. Je l'ai attrapé in-extremis en séance du lendemain, près une heure de queue, il fallait bien cela. Le film se présente comme un documentaire dans la lignée de Genèse d'un repas ou d'Anatomie d'un rapport, un documentaire personnel tout à fait typique de son auteur. Je me serais désolé d'avoir manqué cette œuvre qui réjouira tous les admirateurs du grand homme. On y retrouve ce mélange de sérieux et d'humour pince sans rire, la tranquillité de ses cadres, son art du coq à l'âne, sa figure d'enquêteur tenace, son érudition, sa cinéphilie, son sens de l'absurde et son amour pour sa région natale, les Alpes du sud. C'est là en effet que se situe La terre de la folie. C'est elle, faudrait-il écrire. Le point de départ du film est un souvenir de famille assez peu banal puisqu'il s'agit d'un triple meurtre commis à la pioche et au début du siècle pour une histoire de chèvre. Moullet se lance sur la piste de l'atavisme, notant qu'il est lui-même un maniaque du cinéma, de la collection (de films), qu'il déteste les réunions de plus trois personnes (comme dans la chanson de Brassens), et qu'il se plait dans les caves et greniers, loin du tumulte du monde.

Il collectionne ainsi, tout au long du film des faits, des actes de folie conduisant le plus souvent au meurtre, tous ayant eu lieu dans un pentagone au cœur de la région qui comprend Digne et Manosque. Une région peu peuplée, assez isolée et frappée durement par le nuage de Tchernobyl. Le plus célèbre de ces faits divers est sans doute l'affaire Dominici, le triple meurtre de touristes anglais dans la commune de Lurs, dans les Alpes de Haute Provence. Ceux qui se souviennent des articles critiques de Moullet basés sur le déterminisme s'amuseront beaucoup. Les autres aussi tant la façon qu'il a de conter des histoires horribles est pleine de fantaisie. Moullet se met en scène, fait intervenir des membres de sa famille ou des proches et fait se télescoper ces témoignages avec les interventions de personnes plus spécialisées, médecins ou policiers. Une pique envers la politique de Sarkozy en matière de psychiatrie, une pirouette finale avec sa femme (n'oubliez pas de rester jusqu'au bout du générique de fin), un élastique récalcitrant, La terre de la folie est un film plein de santé et nous rassure sur celle de son auteur, en attendant son prochain meurtre à la hache.
Quand on arrive en fin de festival, les derniers jours, à partir du vendredi, dégagent une atmosphère étrange. Les stands se démontent déjà, les projections se font plus rares, les contrôles se décrispent, les festivaliers pensent déjà au proche départ. Je me demandais quoi aller voir quand je me suis rendu compte d'une ultime séance de la Quinzaine qui présentait le nouveau moyen métrage de Mikhaël Hers dont je vous déjà beaucoup parlé avec son précédent opus, Primrose Hill. Celui-ci s'appelle Montparnasse et on y retrouve trois des acteurs du film précédent dont Thibault Vinçon qui tient un rôle de premier plan. Montparnasse est composé de trois histoires sans lien entre elles sauf leur localisation dans le quartier (Montparnasse évidemment) et, sans que ce soit forcément explicite, durant la même nuit. La première est le portrait de deux sœurs très différentes de tempérament qui se retrouvent pour une sortie, la seconde est la soirée de deux hommes unis par la mémoire d'une jeune femme disparue, l'un était son compagnon, l'autre son père. Le troisième segment est l'histoire d'un premier baiser entre un musicien immobile et une jeune femme qui a beaucoup voyagé. Trois histoires ténues reliées par une atmosphère qui constituent une œuvre plus fragile que Primrose Hill.

On retrouve dans ce nouveau film les mêmes qualités plastiques, le même goût pour de longs plans en travelling arrière sur les personnages qui discutent en marchant, le même sens du suspense sentimental, la même pudeur dans l'expression de l'émotion et la même faculté à faire ressentir ce qui se passe entre les gens, entre les phrases dont ils ne sont pas avares. La musique tient toujours beaucoup de place, le troisième segment mettant en scène un groupe en concert. Question ambiance, il y a une belle photographie nocturne et, on a beau avoir vu Paris la nuit sous toutes les coutures, le regard porté par Mikhaël Hers sur le quartier séduit, il en capte la mélancolie de l'ambiance comme il le faisait du parc de St Cloud. Hers fait également partie de ceux qui savent filmer les femmes et ce n'est le moindre mérite de son film de mette en avant de remarquables actrices, Adélaïde Leroux, Lolita Chammah qui ressemble à sa mère, Aurore Soudieux et la superbe Sandrine Blancke. Et puis cette fois, il n'ya pas d'équivalent à la scène déshabillée que j'avais eu un peu de mal à accepter. Donc en ce qui me concerne, ce film, c'était le bonheur. Le baiser final de la troisième histoire, sur une terasse au coeur de la nuit est un très beau baiser de cinéma. Comme Primrose Hill, Montparnasse explore des moments où l'on passe, inconsciemment ou non, un cap. On surmonte une deuil, on accepte de se livrer, on commence une histoire. Le film évoque parfois une série de gammes musicales ou les esquisses préparatoire d'un peintre en vue d'un tableau important. Hers peaufine ici ses thématiques, sa direction impeccable d'acteur, une mise en scène qui cherche et souvent trouve une musique personnelle. Dégagé d'une trop grande contrainte dans le récit, le film distille un charme plus libre et plus léger. En ce qui me concerne, il peut continuer de faire ce genre de films pendant quelques temps, mais il paraît qu'il prépare son premier long métrage. On peut imaginer qu'il a hâte et vous pouvez imaginer que c'est quelque chose que je suis impatient de découvrir.
Il semble que je ne sois pas le seul et je trouve amusant d'avoir réuni pour cette journée et dans cette note les deux cinéastes. Luc Moullet a en effet dit de Mikhaël Hers qu'il était "plus grand cinéaste français de demain ". Cochon qui s'en dédit !
(à suivre)
00:17 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cannes 2009, luc moullet, mikhael hers | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/05/2009
Cannes 2009 - jour 6
Ne me parle pas de révolution
D'entrée, je savais que ce serait le meilleur film du festival. Une nouvelle fois, Giù la testa (Il était une fois...la révolution), réalisé par Sergio Leone en 1971 a été à la hauteur. C'est un film que j'ai découvert vers 10 ans dans la salle du quartier où j'habitais à Paris et j'ai été marqué à vie. Les nombreuses scènes d'exécution par fusillade m'avaient, et continuent de m'impressionner. Je me rends compte aujourd'hui qu'elles sont traitées par Leone comme les scènes de duel dans ses films précédent, un rituel mis en scène avec force détails et où le temps est comme suspendu. Que Leone leur ait donné cette place dans ce film là en dit assez long sur son état d'esprit du moment. C'est un film au destin chaotique. Au départ, Leone devait seulement le produire. Il envisage comme réalisateur Peter Bogdanovich mais ça se passe mal. Il rêve de Sam Peckinpah. Il y a finalement complot et il se retrouve aux commandes du film une semaine avant le début du tournage. C'est pourtant le film dans lequel il semble avoir mis le plus de lui-même, loin des jeux de la trilogie du dollar et de la superbe mécanique lyrique de C'éra une volta il west (Il était une fois dans l'ouest - 1968), loin du rêve étrange et pénétrant de C'era una volta in America (Il était une fois en Amérique - 1984).

Leone sur le tournage (*) source : festival de Cannes
Giù la testa s'ouvre sur le jet d'urine du péon-bandido Juan qui pisse contre un tronc d'arbre sur une colonie de fourmis. Vision assez rare si l'on y pense. Le repas dans la diligence, le sandwich de Juan, la tranche de citron de John, l'œuf gobé par Gunther Reza, c'est aussi un film de grande bouffe, ancré dans l'humain, dans ce qu'il a de plus animal. Mais aussi dans ce qu'il porte de rêves et d'espoirs brisés, tout ce que l'on peut lire dans le regard de John, les yeux magnifiques de James Coburn. Politique, épique, poétique, violent, drôle, déchirant, nostalgique, picaresque, sarcastique, c'est un film où Leone remplace pour une fois les citations cinéphiles par des notations personnelles comme les souvenirs de l'époque fasciste (Gunther Reza et les fosses Ardéatines) où son sentiment politique en pleines années de plomb avec la fameuse tirade de Juan à John.
Comme l'a écrit Giré dans son livre somme sur le western européen, Giù la testa est comme un bon vin, il vieillit bien. Chaque vision supplémentaire révèle de nouvelles saveurs. La version proposée ici était une restauration de la cinémathèque de Bologne, présentée par son directeur Gian Luca Farinelli accompagné des deux filles du maître dont on commémore, faut-il le rappeler le vingtième anniversaire de la disparition. Ses filles aussi sont très réussies. Quand j'étais jeune, les films de Leone étaient souvent repris en salle l'été. Ceux qui pensent le connaître parce qu'ils ont vu la belle édition DVD, même sur un joli home cinéma, ceux-là doivent absolument faire l'expérience de la salle. Il n'y a que là que se déploie toute la beauté de l'œuvre portée par les « Sean, Sean, Sean... » d'Ennio Morricone que vous fredonnerez toute la soirée et sans doute au delà. C'est Carlotta qui devrait assurer en France la ressortie salle du film et peut être une nouvelle édition DVD. Quien sabe ?
Le soir, j'ai diné avec des amis dont un journaliste à La Marseillaise. La conversation a roulé sur deux noms : Tarantino et Michael Haneke qui présentait ce jeudi Das Weisse Band (Le ruban blanc). C'est là que j'ai creusé l'idée que Cannes cette année avait organisé la confrontation brillante de deux conceptions opposées du cinéma. Comme je m'enflammait pour la scène où Mélanie Laurent se prépare pour la soirée dans Inglorious Basterds, je fis perfidement remarquer que Haneke ne savait pas filmer les femmes. « Il s'en moque, ce n'est pas son problème » me rétorqua le journaliste. C'est juste, mais c'est le mien. Haneke a fait jouer Huppert, Binoche, Noémie Watts, Aissa Maiga et Nathalie Richard, mais vous pouvez courir pour trouver un plan où elle sont belles. Je veux dire par là où l'on trouve de la beauté dans le regard du metteur en scène, de l'empathie, de l'amour pour son personnage. On cite souvent Bergman à propos du cinéaste autrichien, mais si dur que soit, disons Viskningar och rop (Cris et chuchotements - 1972), on trouve toujours cette beauté, cette sensibilité, cette sensualité dans la façon dont Bergman filme Harriet Andersson ou Liv Ullmann. Il est piquant de remarquer que l'une des scènes emblématiques d 'Antichrist de Lars von Trier est une auto-mutilation vaginale opérée par le personnage joué par Charlotte Gainsbourg, à rapprocher de celle effectuée, jute avant de diner, par le personnage joué par Isabelle Huppert dans La pianiste, film de Haneke. Faut-il voir dans le prix d'interprétation l'expression d'une solidarité ? Von Trier n'est pas un tendre non plus. Il a fait d'Emily Watson, Bjork et Nicole Kidman des figures de martyre et n'oublions jamais qu'il est celui qui fit aboyer Deneuve. Il y a un monde entre sa Kidman et celle de Kubrick, pourtant pas réputé comme émotif. Que mes lecteurs et surtout mes lectrices ne se méprennent pas. « Savoir filmer les femmes » n'est pas à prendre au pied de la lettre, où l'on voit le maçon, mais comme expression sensible. Il n'y à (presque) pas de femme dans Giù la testa, mais une telle façon de filmer le regard de James Coburn.
(à suivre)
(*) : Un éminent membre du Forum western movie confirme mes soupçons. Il s'agit en fait d'une photographie de tournage de C'éra una volta il west (Il était une fois dans l'ouest - 1968). Je vous revaudrais ça dès que j'ai le temps de scanner un peu.
07:22 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cannes 2009, sergio leone | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/05/2009
Cannes 2009 - jour 5
La saint Quentin
Vous vous doutez que Inglourious Basterds de Quentin Tarantino était de l'étoffe cinématographique dont je me sentais à priori le plus proche. A postériori, Tarantino a eu l'art de m'introduire dans ce nouveau film avec quelques arguments implacables. Écran noir. Le générique se déroule sur The green leaves of summer, le thème d'Alamo composé par Dimitri Tiomkin pour la version réalisée par John Wayne en 1960. Déjà, mes yeux sont humides. La première scène est l'une des plus belles qu'il ait jamais tournée jusqu'ici. Il était une fois en France occupée par les nazis... une ouverture qui cite C'era una volta il west (Il était une fois dans l'ouest - 1969) de Sergio Leone, « Tu vas me chercher de l'eau », et The searchers (La prisonnière du désert - 1956) de John Ford avec le cadrage à travers la porte. Une ouverture qui est un duel psychologique de vingt minutes avec deux comédiens étonnants et complémentaires, Christoph Waltz en colonel SS Landa et Denis Menochet en paysan français nommé Perrier Lapadite (si, c'est bien son nom), avec un travelling vertical le long de la jambe du paysan qui traverse le plancher pour révéler la famille Dreyfus tapie dans la cave, avec un brusque éclair de violence aux accents d'un morceau d'Ennio Morricone composé pour Il ritorno di Ringo (Le retour de Ringo - 1965) de Duccio Tessari, le morceau aux violons furieux quand Ringo découvre l'existence de sa fille pour être tout à fait précis. Vous imaginez l'état dans lequel j'étais au bout de ces vingt minutes.

La fine équipe
Mais nous n'allons pas jouer au jeu des citations. Comme tout le cinéma de Tarantino, Inglourious Basterds est bourré de références jusqu'à la gueule. Comme tous ses autres films, c'est un acte d'amour envers le cinéma, une sorte de chant mystique à sa puissance et à sa beauté. Pour le spectateur, c'est une invitation à la jouissance et au jeu. Soyons clairs, Tarantino est absolument l'anti-Haneke, et j'irais jusqu'à dire que c'est la grandeur de cette édition cannoise de 2009 d'avoir réuni côte à côte le plaisir extrême de faire du cinéma et la douleur extrême de faire du cinéma. Et même s'il a fallu, in fine, que madame la présidente choisisse son camp.
Il y a eu un problème avec le film de Tarantino. J'ai senti dans la salle combien le public était désarçonné par ce film qui ne ressemble à rien de connu et surtout, surtout, à rien de ce qui était attendu. Ou si peu. C'est peut être le seul reproche que je lui ferai, de se vendre sur l'idée d'un démarquage ludique et violent de Dirty dozen (Les douze salopards - 1967) de Robert Aldrich, ou de ce film d'Enzo G. Castellari qui l'a si lointainement inspiré. Certes vous aurez des scalps, Brad Pitt et la batte de base-ball dans la tête du nazi. Mais le film n'est pas là. Il est tellement pas là que certains en sont venus à se demander où il était. Dès le lendemain, le chroniqueur de la revue Technikart pondait un édito rageur d'amoureux déçu, allant chercher Robert Lamoureux et le bidasses de Claude Zidi pour mieux cracher son dépit. Je peux comprendre que le spectateur ordinaire ait pu se sentir désemparé. Moi même, à une ou deux reprises, j'ai senti le doute me frôler de son aile. C'est que le jeu de Tarantino est exigeant cette fois, loin de l'exubérance physique de Kill Bill comme de la linéarité de Death Proof. Mais qu'un critique, un professionnel de la vision des films, n'arrive pas à saisir, ne cherche pas à comprendre ce qui a été tenté, ne voit pas la nature de l'audace du réalisateur, alors les bras, les yeux et les poils du dos m'en tombent. L'impression que cela m'a laissé, c'est que pour certains, il y a eu l'occasion de se payer Quentin et qu'il fallait le faire vite et le plus fort possible. C'est ridicule.
Difficile d'entrer dans la luxuriante richesse d'Inglourious Basterds sans en dévoiler les multiples et subtils ressorts. Une scène quand même pour approcher la bête, un autre sommet du film. Ça se passe dans une auberge française. Quelques soldats allemands fêtent la paternité récente de l'un d'eux en compagnie dune actrice allemande elle aussi, Bridget von Hammersmark jouée par la superbe Diane Kruger. Moment de détente avec citations diverses (Winnetou, Edgard Wallace...). Entrent deux des Basterds accompagnés d'un agent anglais, tous déguisés en officiers allemands. Leur contact c'est l'actrice. La tension monte d'un cran et s'installe. Au moment ou la scène semble s'épuiser, un changement de cadre et une voix off révèlent une pièce supplémentaire et un officier SS jusqu'ici invisible. Il a des doutes sur les accents des faux officiers. La tension remonte brusquement, Tarantino change de braquet et nous mène jusqu'à un nouveau sommet. L'issue de cette scène (vous apprécierez les efforts que je fais pour rester évasif) remet en cause tout ce que l'on a pu imaginer depuis 20 minutes. Nouveau cadrage qui révèle cette fois un escalier, nouvelle voix off. Il y avait encore des gens que l'on avait pas vu. On repart sur une nouvelle situation, tendue à nouveau jusqu'à l'ultime résolution. Jeu avec l'espace, suspense basé sur le cadre et le hors champ, art de la tension, interprétation savoureuse, ruptures de ton, violence sèche entre Hawks et Corbucci organisée géométriquement, cette scène donne le vertige.

Après, il faut dire la transgression de Tarantino dans ce film. Il a fait là quelque chose qui ne se fait pas, que je ne crois avoir vu au cinéma que chez Chaplin ou Tex Avery. En fait, je ne peux rapprocher l'idée finale que de celle du film de Corbucci, Il grande silenzio (Le grand silence - 1968). Pour ceux qui le connaissent, ça vous donnera une piste, mais il faut inverser. Tarantino pousse la logique d'un genre à son extrémité en allant au bout du principe de fiction, de la cohérence interne du conte. Il était une fois... Quand on embrasse une grenouille, elle devient un prince. Cela n'a rien à voir avec les images provoquantes qui séduisent ou font hurler, celles de Haneke ou de Von Trier qui peuvent aller très loin dans ce qui est montré. C'est plus gonflé, plus radical, c'est amener le spectateur au bout de la logique de son désir relativement au film. C'est l'illustration littérale de la fameuse et belle formule d'Alfred Hitchcock, « Mon amour du cinéma est plus fort que n'importe quelle morale ».
Alors un homme capable de filmer le gros plan sur la cheville de Diane Kruger interrogée par le colonel SS, un homme capable de filmer les larmes qui envahissent les yeux de Lapadite quand il se rend compte qu'il craque et va trahir, un homme capable de filmer Mélanie Laurent dans sa robe rouge d'une façon qui devrait faire rougir de honte tous ceux qui l'ont filmée avant, Lioret compris, un homme capable d'un film de studio américain parlé à 60% en français, allemand et italien, un homme qui donne comme nom de code à un personnage « Antonio Margheriti », un homme capable d'interrompre son film pour nous donner une leçon sur le film nitrate, un homme capable de filmer son cinéma parisien comme François Truffaut filmait son théâtre dans Le dernier métro (1980), Un homme qui filme ce cinéma comme un temple avec la réplique « Il est beau votre cinéma, on dirait une église » et qui retourne la symbolique du Mal contre lui même (les nazis avaient pour habitude d'enfermer les populations civiles dans les église et les synagogues avant d'y mettre le feu), un homme capable de terminer son film sur cette réplique de Brad Pitt « Je crois que je viens de faire mon chef d'oeuvre », cet homme est fou. Et nous avons besoin des fous. Cet homme dis-je, ne doit avoir droit qu'à notre plus profonde admiration. Vous ferez bien ce que voulez, la mienne lui est acquise.
Photographies : © Universal Pictures International France
(à suivre)
07:15 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : cannes 2009, quentin tarantino | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/05/2009
Cannes 2009 - jour 4
Deux maîtres
Côté compétition officielle, les choses sérieuses commencent. Je connais mal le cinéma de Marco Bellocchio. Vincere me semble pourtant éloigné des oeuvres virulentes des années 60 comme Pugni in tasca (Les Poings dans les poches - 1965) ou provocatrices façon Il diavolo in corpo (Le Diable au corps -1986). Ainsi donc Benito Mussolini aurait eu une famille cachée. Ida Dassler, éperdue de passion pour le syndicaliste socialiste et ténébreux des années 10, l'aurait légalement épousé alors qu'il était marié par ailleurs, et lui aurait donné un fils. Devenu fasciste après la grande guerre et monté à la conquête du pouvoir, Mussolini aurait tout fait pour étouffer le scandale possible, séquestrant, intimidant, séparant la mère de l'enfant avant de la faire interner dans un asile. Ida y mourra en 1937. Bénito junior finira lui aussi à l'asile et meut en 1942.
De cette histoire, Marco Bellocchio tire un film lyrique et puissant, furieux et convaincu, opératique. Impression accentuée par la partition aux accents verdiens de Riccardo Giagni. Bellocchio privilégie les plans d'ensemble mettant en valeur la qualité de la reconstitution historique et le magnifique travail sur les décors, sans y étouffer ses personnages. Très maîtrisé, Vincere enchaîne sur un rythme soutenu les morceaux de bravoure cinématographiques (au sens de Moullet), nous entraînant dans cette vaste fresque dramatique. La réunion syndicale au moment de la déclaration de guerre par exemple, est un jeu superbe sur le son et le hors champ. Ida cherche à pénétrer dans la grande salle où s'affrontent les hommes pour rejoindre Mussolini. Elle se heurte, comme un papillon affolé, à une multitude de portes vitrées opaques. Avec elle, à travers une caméra virevoltante, nous ne percevons que les éclats de voix et les ombres déformées des participants. La mise en scène exprime à la fois l'urgence du moment, sa violence, et aussi la détermination de cette femme résolue à pénétrer un monde masculin.

Évidente illustration du fascisme et de ses méthodes d'écrasement de l'individu (oui, un peu comme le film de Haneke), Vincere est construit par Bellocchio autour de la figure d'Ida, jouée avec une force de conviction impressionnante par la superbe Giovanna Mezzogiorno. Figure de femme, d'amante, de mère et figure de résistance. Le titre peut être pris de ce point de vue tant comme un commentaire tragiquement ironique que comme l'expression d'une victoire morale. Sans cesse, on cherche à la briser, sans cesse, elle arrive à se rebeller, à s'enfuir, à lutter et, de manière obsessionnelle, à affirmer qui elle est. La femme du Duce et la mère de son fils. Les scènes d'affrontement opposent plastiquement Ida avec les représentants du régime, policiers ou médecins. Cette approche est la plus belle réussite du film, Giovanna Mezzogiorno est magnifiée par la photographie de Daniele Ciprì. Elle cultive les zones d'ombres d'Ida, cette passion dévastatrice pour un homme au coeur si sec, cette obstination butée, cette fermeture aux convulsions de l'époque qui ne la rendent pas toujours aimable. Lors de la premiere rencontre avec Mussolini, elle découvre du sang sur la main qu'elle a passé autour du cou de l'homme. Elle reste interdite et cette stupeur, cette incompréhension de la violence liée à son amant restera longtemps sa ligne de conduite. C'est ce qui la poussera à se réfugier dans la folie qu'on lui propose plutôt que d'accepter l'évidence, malgré les conseils du docteur qui a cette belle réplique : « Nous devons apprendre à devenir de bons acteurs ».
Je dois dire que je suis gré à Bellocchio et Mezzogiorno d'avoir traité tout ce qui touche à la folie, à l'asile, avec pudeur et sobriété. Il aurait été facile de multiplier les scènes d'hystérie, les yeux révulsés et la bave aux lèvres. Vincere s'attache plutôt à la dimension humaine de personnages comme la danseuse ou la bonne soeur qui fait passer les lettres, et toujours, à la dignité qui émane d'Ida. Bellocchio et son actrice trouvent des façons originales de rendre les douleurs traversées. Dans une très belle scène, Ida assiste à une projection du Kid de Chaplin, en plein air pour les pensionnaires de l'asile, sur un écran tendu devant la lagune, avec les lumières de Venise au-delà. Les larmes qui naissent dans ses yeux nous sont d'autant plus proches qu'elles se mêlent à celles provoquées chez nous par la force d'émotion du film projeté. Le cinéma tient ici une place dramatique de premier plan. C'est lui qui se pose en témoin de l'Histoire, dernière fenêtre sur le monde quand on en est séparé. C'est au cinéma que Ida prend des nouvelles de son époux secret et de son irrésistible ascension. C'est aussi le cinéma vecteur de mémoire, Bellocchio substituant, au temps de la gloire du Duce, l'acteur Filippo Timi par des images d'archives. Belle idée qui en rappelle d'autres du film Katyn de Wajda (qui travaille les mêmes thèmes) et des formes proches : figures centrales féminines, esprit de résistance, mécanismes d'oppression, utilisation et interrogation d'images d'époque, d'un pays de son histoire et de ses mensonges.
J'aime beaucoup le cinéma de Pedro Almodovar, même si je ne suis pas aussi enthousiaste que certains sur ses dernières oeuvres tant célébrées. Avec Los abrazos rotos (Étreintes brisées), je pouvais craindre le syndrome du film de plus. De fait, cela commence un peu comme cela : Un cinéaste-écrivain aveugle, la quarantaine séductrice, a ramené chez lui une très belle jeune femme blonde pour lui lire le journal, tu parles ! Il la séduit et ils s'étreignent sur le canapé. Érotisme, humour, photographie lumineuse et couleurs pétantes, personnages tirés à quatre épingles, c'est griffé Almodovar. Un rapide travelling le long du dossier du canapé (nous ne voyons pas les corps) vient cadrer un joli pied aux ongles délicatement manucurés de rouge. C'est partit pour un tour.
Et bien non. Cette introduction leste et plaisante sonne comme une mise à l'écart de la manière branchée du réalisateur. Elle contraste avec les images du générique, un essai lumière sur un tournage, images sans couleur ni relief, format carré sur un moniteur vidéo. Et puis le visage de Pénélope Cruz, et se dégage tout à coup une gravité, une impression de distance, le sentiment du temps. Los abrazos rotos est un film complexe, l'un de ces films à rapprocher des récents Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen ou Gran Torino de Clint Eastwood qui, sous les dehors du « film de plus », brassent et affinent l'univers de leur auteur, convoquent ses formes et ses thèmes de prédilection et reviennent sur la pratique de son art, sur le cinéma qu'il fait et sur celui qu'il aime et qui l'inspire. Un film somme de toute beauté.

Jadis Matéo, le réalisateur aveugle a aimé une très belle femme, Lena, qui rêvait d'être actrice. Elle était la compagne d'un homme très riche, Ernesto qui en était fou. L'homme très riche a produit un film pour elle et le réalisateur l'a dirigé. Et ils se sont aimés. L'homme très riche a mutilé le film. Il y a eu un accident, le réalisateur a perdu la vue et la très belle femme est morte. Tout ce passé resurgit après 14 années et Pénélope Cruz interprète sous le regard de la caméra d'Almodovar cette femme qui est la plus belle et la plus émouvante de toutes les figures féminines qui traversent son oeuvre. Pour cela, le réalisateur est venu à un style classique, inspiré de celui des grands mélodrames qui l'on toujours inspiré. Ce n'est pas un hasard si un extrait de Viaggio in Italia (Voyage en Italie - 1954) de Roberto Rossellini est choisi en contrechamp de la scène la plus tendre du film, celle où Matéo se prend en photo avec Lena, dans un simple moment d'intimité, assis sur le canapé. C'est cette photographie que récupère et recolle symboliquement Diego, le fils retrouvé de Matéo, à la fin du film.
A côté de cette approche posée et maîtrisée, Almodovar revisite également son oeuvre. Il y a le film dans le film, une comédie qui retrouve le piquant de Mujeres al borde de un ataque de nervios (Femmes au bord de la crise de nerfs - 1988). De ce film, il reprend aussi la très belle scène du doublage de Johnny Guitar. Cette fois, elle gagne en intensité pour devenir un moment inoubliable. Ernesto fait espionner Lena par son fils qui la filme à son insu. Comme les films sont inaudibles, Ernesto se les fait projeter en compagnie d'une femme qui lit sur les lèvres. La caméra glisse pour découvrir Lena sur le pas de l'entrée et c'est elle qui se double, disant enfin les mots qu'elle refoule et la font souffrir. Elle aime Mateo et va quitter Ernesto.
Il faut avoir un bloc de béton à la place du coeur pour ne pas être bouleversé par cette vertigineuse mise en abyme. Pouvoir et beauté du cinéma, mensonge des images incomplètes. Los abrazos rotos est aussi un grand film sur l'acte de faire du cinéma. On y voit le travail du scénario, du tournage, des essais, du doublage et du montage, la vidéo et la pellicule. Et chacune de ces étapes est insérée dramatiquement dans le récit. Ernesto frappe les amants en dépossédant le réalisateur de son film et en montant les mauvaises prises. L'intrigue se dénouera autour du travail de restauration de ce film que l'on croyait perdu et qui permet d'affirmer le talent de Lena au-delà de la mort. Et dans un autre plan particulièrement émouvant, on verra l'aveugle caresser l'écran de télévision où se diffusent les ultimes images de Lena quelques secondes avant l'accident. Après une dernière étreinte. Pénélope, Pénélope, il faudrait dire tous les plans de ce film dans lequel vous êtes, en perruque blanche, en robe noire et d'or devant votre miroir, les cheveux dans le vent devant la plage sauvage de Lanzarote. Los abrazos rotos est l'un des plus beaux films d'Almodovar, les plus achevés, le point culminant d'une vie et d'une oeuvre vouées à la passion du cinéma.
Photographies : source Allociné
(à suivre)
07:39 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cannes 2009, pedro almodovar, marco bellocchio | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/05/2009
Cannes 2009 - jour 3
Football, chirurgie et rendez-vous manqué
Looking for Éric, le film proposé cette année par Ken Loach, est désarmant. Il se suit sans ennui ni passion et j'y ai ris plus d'une fois (la séance de "détente mentale" est irrésistible). Sur le fond, c'est la même histoire que Play it again, Sam, le film de 1972 réalisé par Herbert Ross avec Woody Allen, séducteur timide qui trouvait de l'aide auprès du fantôme d'Humphrey Bogart. Ici, c'est un postier anglais, Éric, la quarantaine sur le retour, qui reconquiert son ex-femme, ses fils et l'estime de lui-même avec le concours de l'ectoplasme d'Éric Cantona. Pourquoi pas ? Le problème est que Loach se contente de refaire des choses déjà vues en mieux au sein même de sa carrière. C'est la même histoire que My name is Joe (1998) ou Raining stones (1993), les aphorismes en plus. Pire, toute cette histoire autour du gang dans lequel est entré l'un des fils et qui finit par terroriser la petite famille fonctionne très mal. J'ai pensé pas mal au Gran Torino de Clint Eastwood, mais là où l'américain en fait le moteur de sa fiction, l'anglais et son scénariste fétiche Paul Laverty plaquent péniblement une intrigue-prétexte, artificielle, comme s'ils n'avaient pas assez confiance en leurs propres personnages. Et puis Cantona... Il faut dire que je suis totalement hermétique à la chose footbalistique. On rit beaucoup avec lui. Il a beau avoir commandité le film, on se demande constamment si c'est du lard ou du cochon et si l'on est pas en train de rire de lui. L'autodérision, les mouettes et les sardines et toutes ces sortes de choses, trouvent leurs limites et tournent au répétitif. Dommage.

Loach et Cantona : source site du film
Question mise en scène, Loach en reste aussi au service minimum, sur un style rôdé. La caméra est assez mobile, toujours très près des personnages, une photographie sans relief donne à l'ensemble un aspect un peu terne. Rien de saillant sauf quelques effets brutaux comme l'irruption de la police lors du repas de famille. J'en suis venu à penser que Loach est plus doué quand il fait se télescoper ce style avec des sujets historiques, créant alors des formes inédites et exaltantes comme l'attaque du village et la réunion politique dans Land and freedom (1995) ou les embuscades de The Wind that Shakes the Barley (Le Vent se lève - 2006). La rencontre du travail intimiste de la caméra et des exigences de l'action épique est nettement plus excitante. De ce que j'ai pu voir, Loach est finalement le seul à avoir donné cette année une oeuvre de routine, assez loin de ses plus belles réussites.
L'après midi, j'ai revu avec plaisir l'ami Joachim qui vous raconte plus à chaud sa semaine sur 365 jours ouvrables. Nous avions décidé de découvrir ensemble le nouvel opus d'Alain Guiraudie, Le roi de l'évasion, mais nous n'avons pu accéder à la séance de la Quinzaine des réalisateurs. Rendez vous manqué, frustrant quand on pense aux difficultés qu'il y a à voir les films de cet auteur en temps normal.

Les yeux sans visage : source Electric sheep
Pour me consoler, j'ai lâchement abandonné mon camarade pour revoir Les yeux sans visage de Georges Franju, l'un des deux ou trois plus beaux films fantastiques français. Réalisé en 1960, ce film est resté sans véritable descendance, même s'il a acquit le statut de classique. La poésie d'Edith Scob, de son masque blanc et de son long cou gracile fascine toujours, comme l'opération du visage continue d'arracher des cris horrifiés au public. Alida Valli est toujours aussi émouvante avec son amour refoulé pour le terrible chirurgien Pierre Brasseur dont le fils, Claude, est à jamais un juvénile inspecteur. Ce qui est amusant aussi, ce sont les divers appareils chirurgicaux, notamment un appareil pour les encéphalogrammes, qui resurgissent pour nous rappeler un passé qui semble si lointain. C'est comme les voitures dans les films de Godard et de Truffaut, elles ajoutent aujourd'hui un charme supplémentaire. La copie a été restaurée par Gaumont et c'est du beau travail qui rend toute la profondeur de la photographie en noir et blanc de Eugen Schüfftan qui avait travaillé avec Fritz Lang. Les noirs sont particulièrement intenses. Je ne me souvenais plus que c'était Maurice Jarre qui avait composé la partition. C'est l'une de ses premières grandes oeuvres pour le cinéma dans laquelle s'affirme déjà un style plutôt moderne (percussions, accents jazz), singulier, bien en phase avec ce conte macabre et intemporel qui n'a rien perdu de son charme ni de son éclat.
(à suivre)
07:48 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : ken loach, georges franju, cannes 2009 | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/05/2009
Cannes 2009 - jour 2
Tsar et soirée Pietro Germi
De Pavel Lounguine, j'étais resté sur l'impression délicieuse de Svadba (La noce - 2000), brillante comédie illuminée par le visage blond de Mariya Mironova. Tsar, présenté à Un Certain Regard, est très différent, un drame historique aux accents de tragédie classique, Shakespearien étant le mot qui vient rapidement à l'esprit. Le tsar en question, c'est Ivan IV dit le terrible joué par Pyotr Mamonov. En fin de règne, le despote est une sorte de Caligula vieillit, aigri, cruel et paranoïaque. Il a a créé une garde spéciale qui porte comme signe de reconnaissance une tête de chien au pommeau de la selle. Comme il voit des conspirations partout, Ivan envoie ses sujets, même loyaux, dans un sombre donjon où ils subissent des tortures qui nous rappellent les grandes heures du peplum italien des années 60. Mystique, cela va ensemble, il prie abondamment Dieu et envoie chercher un ami d'enfance, Philippe, religieux d'une grande autorité morale, pour devenir métropolite de Moscou, l'équivalent du pape pour les orthodoxes. Celui-ci, joué avec beaucoup de noblesse par Oleg Iankovski, s'emploie à ramener le tsar à la raison et s'oppose ainsi à son pouvoir absolu. Je ne sais pas s'il faut lire entre les images de Tsar un portrait de la Russie actuelle, mais il est difficile de ne pas y penser. Tout comme il est difficile de ne pas évoquer les images du dernier film d'Eseinstein, Ivan Groznyy (Ivan le terrible - 1944) métaphore en creux du pouvoir de Staline en son temps. L'ombre du maître soviétique plane sur certaines scènes, notamment dans les compositions sophistiquées des cérémonies religieuses avec les jeux d'ombres et de lumière, les gros plans expressionnistes et les visages aux traits puissants.

Source : dossier de presse
Visuellement, le film est superbe et Lounguine s'est attaché le chef opérateur de Clint Eastwood, Tom Stern, pour éclairer Ivan priant à la lueur de bougies ou les sombres ambiances du donjon. Des cavaliers galopent au ralentit dans la neige, Ivan vêtu d'or traverse un verger en fleur, Une bataille entre russes et polonais autour d'un pont est traitée en plans rapides quasi abstraits. La puissance des images est renforcée par l'impression d'authenticité dégagée par les décors et les costumes. Le film a eu les moyens. Il y a de belles idées de mise en scène également. Un long mouvement suit Ivan, de face, que ses serviteurs revêtent un à un des nombreux éléments qui composent son costume de tsar. Partit de sa chapelle en chemise de nuit, il devient petit à petit le monarque au regard impitoyable et couvert d'or au moment de rencontrer son peuple.
J'ai été aussi sensible à la trouvaille du personnage de la petite fille qui est enlevée, qui se sauve, est découverte, prise sous la protection de Philippe, s'enfuit, avant de devenir la mascotte d'Ivan et dont on se demande si l'innocence saura toucher le coeur du tsar. Elle apporte une touche de magie, de féerie au sein d'une histoire plutôt sombre. Elle aide aussi à pénétrer un film qui n'est pas d'un abord facile si, comme moi, l'on est guère versé en histoire russe ni en rite orthodoxe. Pouvoir absolu contre force morale, bien contre mal, manipulation politique de la religion contre intégrité, corruption contre désir de rédemption, le film est d'abord la lutte spirituelle de deux hommes. Elle rappelle celle de Thomas More et du roi Henry VIII illustrée dans A Man for All Seasons (Un homme pour l'éternité - 1966) réalisé par Fred Zinnemann, analogie plus proche de nous pour mieux saisir les enjeux de cette histoire complexe que Loungine enlève sans temps morts avec une grande maîtrise de ses effets. Il y a dans ce projet quelque chose des films à grands spectacles actuellement produits en Chine et qui explorent eux aussi une histoire prestigieuse, mouvementée et violente, avec les rapports complexes au pouvoir et au pays.
Retour à une certaine légèreté avec la soirée consacrée au réalisateur Pietro Germi. Acteur et réalisateur disparu en 1974, il débute dans la veine néo-réaliste après la guerre puis devient un réalisateur emblématique de la comédie italienne avec Un maledetto imbroglio (Meurtre à l'italienne -1959) dans lequel il joue aux côtés de Claudia Cardinale, Divorzio all'italiana (Divorce à l'italienne - 1961) avec Mastroianni, Sedotta e abbandonata (Séduite et abandonnée - 1964) avec Stéfania Sandrelli et le film repris cette année, Signore e signori (Ces messieurs-dames - 1966) qui remportera la grand prix à Cannes aux côtés du film de Claude Lelouch. Le documentaire de Claudio Bondi, Pietro Germi, il bravo, il bello, il cattivo, retrace les grande étapes de sa carrière avec le bon goût de se focaliser sur les films, respectant l'intimité d'un homme assez secret. Le film est composé de nombreux entretiens avec ses acteurs et ses actrices, ainsi que d'émissions télévisées avec Germi et de reportages sur les tournages. Côté actrices, il y a quelques perles d'époque où l'on retrouve Virna Lisi, Claudia Cardinale et Stéfania Sandrelli. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a des essais avec la belle Nicoletta Machiavelli, ce qui aurait suffit à illuminer ma soirée.

Mais ce n'était rien à côté du film. Signore e signori est un fleuron virtuose de la comédie all'italiana. Cela se passe dans une petite ville de province, à Trévise en Vénétie. Le film suit un groupe de notables (un médecin, un comptable, un pharmacien...) et leurs épouses, dans le train train de leur vie quotidienne et leurs relations amoureuses. Celles-ci sont basées sur le mensonge, l'hypocrisie, la domination des hommes sur les femmes et l'oppression sociale sur les sentiments. Germi l'illustre en trois actes, trois petites histoires très drôles et très cruelles comme il se doit. La première est centrée sur le docteur, marié à une femme bien plus jeune et qui pense se moquer d'un ami qui lui a confié son impuissance avant de se rendre compte que ce n'est qu'une ruse pour se rapprocher de l'épouse peu farouche. Le second segment, plus long, met en scène Osvaldo Bisigato, formidablement joué par Gastone Moschin, pâle comptable tyrannisé par sa femme et ses enfants, qui tombe amoureux de Milena, la serveuse d'un café campé par la bellissime Virna Lisi. Cette histoire, c'est le coeur du film et l'unique tentative de l'un des personnages pour briser le carcan social. Bisigato, fou d'amour et on le comprend, quitte femme et enfants, crie le nom de sa maîtresse dans la nuit et veut affirmer haut et fort la force et la pureté de son amour. Mais dans l'Italie de 1965, pas de divorce possible et famille comme amis pèsent de tout leur poids pour briser le couple. Lors de la plus belle scène du film, Bisigato entraîne Milena à travers la place bondée de monde, au milieu des pigeons s'envolant, aux yeux de tous. Cet homme est un archétype de la comédie italienne, modeste, pas terriblement séduisant, un peu pitoyable, il révèle de grandes qualités de coeur et de courage, comme le faisait Alberto Sordi à la fin de Una vita difficile. Un peu pathétique, il est très émouvant. La troisième partie est assez retorse, puisqu'elle montre nos bons bourgeois manipulés habilement par une jeune fille de la campagne qui passe de l'un à l'autre mais se révèle mineure. Après avoir fustigé le conformisme de façade de ses héros, Germi révèle leur hypocrisie profonde tout en mettant en scène le même type de comportement chez la famille paysanne. Le père exploite sans honte la vertu de sa fille puisqu'il achètera le retrait de sa plainte. Une façon de se moquer du culte de l'argent dans l'italie de l'époque. Au passage, Germi qui a souligné la domination masculine et ses ravages, s'amuse à monter la véritable force de la femme puisque c'est l'une des épouses (jouée par la belle Olga Villi, je crois) qui résout le problème à coup de millions de lires et payera de son corps la sauvegarde des apparences et le retour à une vie « normale », où les hommes sortent leurs femmes légitimes sur la place, au milieu du vol des pigeons.
A ces histoires de coucheries qui peuvent sembler triviales, Pietro Germi donne une forme d'une grande élégance, que ce soit la photographie en noir et blanc d'Aiace Parolin, la musique entêtante et légère de Carlo Rustichelli et la virtuosité du travail de la caméra, valsant au sein des groupes avec une sûreté, une précision d'horloger. La première partie, avec la présentation des couples et leur départ pour la fête, est placée sous le signe d'un rythme effréné. La seconde, l'histoire du comptable, délaisse un temps les larges plans de groupe pour un portrait plus délicats des deux héros, laissant les scènes durer pour faire naître l'émotion, comme lors du dialogue auprès du canal. La troisième partie, un peu plus sombre, est plus découpée, Germi s'employant à faire monter la tension pour mieux enfermer son groupe dans sa bassesse avant de résoudre son récit par une pirouette plutôt leste. Mais toujours élégante.
(à suivre)
08:05 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cannes 2009, pietro germi, pavel lounguine | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2009
Cannes 2009 - jour 1
Et voilà, c'est fini. Je les ai vus enrouler les tapis rouges et vider à la benne, quel gaspillage, les kilos de papier des dossiers de presse inutilisés. Comme moi, je pense, vous avez pris connaissance du palmarès. Je n'ai pas grand chose à en dire. Mes lecteurs savent que je ne goûte pas le cinéma de Michael Haneke. Maintenant, c'est le choix du jury et palme ou pas je continuerais à me tenir soigneusement à l'écart de ses films. Ceci posé, ça n'était sans doute pas facile pour le jury cette année. Contrairement à ce que l'on craignait, l'alignement de grands habitués a finalement donné une belle édition. De ce que j'ai vu (je suis loin d'avoir vu toute la compétition) et de ce que j'ai entendu, il me semble que, sauf peut être Ken Loach, tous les auteurs ont proposé des films importants dans leur oeuvre, qu'ils aient tenté de nouvelles choses (Von Trier, Tarantino, Noé, Haneke) ou qu'ils aient affirmé, affiné leur façon de faire (Audiard, Bellocchio, Almodovar, Suleiman, Campion). 2009, ça me semble un bon cru et de ce point de vue, le jury mené par Isabelle Huppert à fait une proposition équilibrée.
J'ai toujours trouvé redoutable les notes « à chaud » sur un tel festival. A Cannes, la nuit porte souvent conseil et les films du lendemain amènent fréquemment à repositionner ceux d'hier. Et puis Cannes, c'est crevant. La fatigue, ça n'aide pas. Maintenant que l'hystérie va retomber, que toutes les images vont se décanter, je vais pouvoir vous raconter ma longue semaine. Retour samedi dernier, en milieu d'après midi.
Martin Scorcese et un jeune flamand
J'ai mis un peu de temps à me mettre en route. Après quelques hésitations, suivant mon instinct toujours très sûr, je suis partit découvrir Al-momia (La momie où La nuit où l'on compte les années), un film égyptien de Shadi Abdel Salam tourné en 1969 dans la sélection Cannes Classic. Au moins là, on sait où l'on met les pieds et il ne faut pas attendre une heure en plein soleil. En l'occurrence, j'ai eu le nez fin et Cannes m'a offert l'une de ces surprises dont il a le secret. C'est Martin Scorcese lui-même en personne qui est venu présenter le film. Il faut dire que Al-momia a été restauré dans le cadre de la World Cinéma Fondation créée par Scorcese en 2007 avec une quinzaine de réalisateurs prestigieux. Leur noble objectif est de préserver le patrimoine cinématographique mondial, notamment celui de pays qui n'ont guère de moyens pour le faire, en Afrique et en Amérique du Sud surtout. C'était assez émouvant de voir Scorcese nous parler de ce film, l'unique long métrage de Shadi Abdel Salam qui fut décorateur et costumier, travaillant notamment sur le superbe Pharaoh du polonais Jerzy Kawalerowicz en 1965. Le film, nous a-t'il dit, était admiré de Michael Powell. A le découvrir, on comprend vite pourquoi. Al-momia raconte la découverte, à la fin du XIXe siècle, de nombreuses momies dans un site gardé par une tribu, les Horrabat. Cette tribu faisait le trafic d'antiquités et les trésors pillés sur ce patrimoine inestimable étaient sa seule source de revenu. A la mort du chef de la tribu, ses deux fils refusent de poursuivre le trafic et, après la mort de l'aîné, le cadet livrera le secret aux autorités, incarnées ici par un envoyé du service des antiquités du Caire.

Al-momia : source The auteurs
Porté par une partition aux accents modernes de Mario Nascimbene (qui a composé pour nombre de peplums, les films de dinosaures de la Hammer et les inoubliables Vikings de Richard Feischer en 1958), le film déploie de superbes plans très travaillés, avec une photographie de Abdel Aziz Fahmi qui rend à merveille les ocres du désert et des monuments, souvent filmés de nuit, sur lesquels contrastent, comme des fantômes, les tenues noires des membres de la tribu. La première scène nous montre une réunion des archéologues égyptiens, savants en costumes sombres dans une pièce noyée de pénombre et de fumée de cigares, éclairés comme les chirurgiens de Rembrandt. Plus tard, la découverte des sarcophages à la lueur de faibles lampes puis la procession des soldats les emportant dans le désert est saisissante. C'est très graphique. Le film manque un petit peu de légèreté, les acteurs sont parfois assez raides, assez théâtraux, à la notable exception de celui qui joue le chef de l'expédition. Médiation sur l'histoire de l'Égypte et son identité, sa colonisation rampante et le pillage de son patrimoine, Al-momia est un contrechamp indispensable (comme l'était à sa façon le film de Kawalerowicz) à toutes les aventures racontées par les yeux occidentaux.

Source : Le site du film
Soirée à la semaine de la critique avec un premier film, La merditude des choses du flamand Félix Van Groeningen. Plutôt sympathique, c'est typiquement le faux film provocateur. Nous y découvrons la famille Strobbe à travers le regard de l'adolescent Gunther qui vit avec son père, ses trois oncles et la grand mère. Milieu très modeste, Famille haute en couleur avec sens de l'honneur du nom, séjours en prison, grandes gueules et bon coeur, beuveries et coucheries, huissiers et courses de vélo à poil, ainsi va la vie, difficile mais formatrice. Gunther écrit et à force d'obstination, il deviendra un écrivain reconnu en racontant cette adolescence bourrée de clichés. Il y a même des nains. Cinématographiquement parlant, c'est ce que l'on peut imaginer, caméra à l'épaule, le plus souvent en mouvement sans trop savoir où elle va, une photographie assez terne, des ambiances plus ou moins sordides de bars, maisons délabrées, banlieue tristounette et un ciel si gris qu'il faut lui pardonner. Même si Gunther devenu adulte aura quelques mots assez durs avec sa première compagne (« Il y a deux personnes que je hais. Deux femmes. La première m'a donné le jour, la seconde est en train de me faire un gosse.»), tout le monde est finalement plutôt sympathique, sauf les huissiers. Van Groeningen a néanmoins de l'énergie et une certaine faculté à faire vivre son petit monde. Les scènes de groupe sont vivantes et parfois assez drôles comme lorsqu'ils emmènent la nièce de dix ans dans un bar et lui font chanter des chansons paillardes. Il se débrouille aussi pas mal avec un récit éclaté entre quatre époques, le montage est assez enlevé. On passe donc un bon moment, mais le film ne résiste pas aux réflexions qui naissent dès que l'on a passé la porte de sortie.
(à suivre)
08:36 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cannes 2009, félix van groeningen, martin scorcese, shadi abdel salam | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
24/05/2009
La séléction du patron
Cannes tire à sa fin et je vous raconte tout cela à partir de lundi (si tout va bien et que Dieu, dans son infinie sagesse, me prête vie). J'en termine avec mes chroniques pour Kinok avec quelques mots sur le livre de Luc Moullet Piges Choisies. Une fois n'est pas coutume, je vous livre l'article en entier, c'est que vous devez absolument vous le procurer. Vraiment.
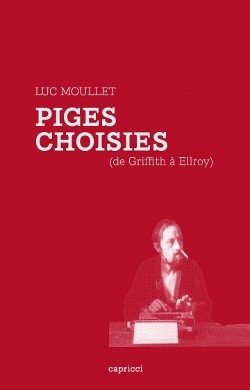
Peu d'ouvrages critiques sur le cinéma m'ont autant marqué que La théorie des acteurs de Luc Moullet. Originalité de l'approche, érudition, clarté, ouverture vers de nouvelles lectures pour des films pourtant bien connus, le tout enrobé dans un style vif et, surtout, surtout, plein d'humour. J'en ai développé une admiration tant pour le critique qui débuta en 1956 aux Cahiers du Cinéma période mythique que pour le cinéaste atypique à l'oeuvre très (trop) discrète mais conséquente avec une quarantaine de courts et longs métrages.
Je me suis donc jeté sans retenue ni pudeur sur Piges choisies (de Griffith à Ellroy), recueil de bons morceaux sélectionnés et présentés par le maître, édité par Capricci éditions et le Centre Georges Pompidou à l'occasion de la rétrospective Luc Moullet, le comique en contrebande que ces veinards de parisiens peuvent découvrir depuis le 17 avril et jusqu'au 30 mai. Au Centre Georges Pompidou comme il se doit.
Même s'il n'est pas un recueil exhaustif, l'ouvrage est très complet. Il couvre tout le parcours critique de Moullet depuis quelques lignes écrites à 12 ans (Exécution sommaire d'un film de Jean-Paul le Chanois en 1949 dans L'écran français) à un inédit de 2009 autour de l'oeuvre de James Ellroy, l'écrivain de Black Dalhia, Moullet décrétant qu'il préfère désormais lire les romans des américains plutôt que voir leurs films. C'est un choix.
Le livre permet de retrouver un texte écrit pour le John Ford collectif des Cahiers : Le coulé de l'amiral. Moullet se pose visiblement beaucoup de questions sur Ford dont il estime, c'est étonnant, Tobacco road, adaptation du roman d'Erskine Caldwell, datant de 1941 et généralement peu apprécié. J'ai quand même tendance à préférer quand Moullet parle de Ford en écrivant sur John Wayne ou James Stewart. Le lecteur trouvera également le texte assez long et assez remarquable sur Le morceau de bravoure écrit pour Positif en 2006, un essai sur Samuel Fuller qui lui valu les compliments de Rivette, ses admirations pour Truffaut, Godard et Sadoul, quelques textes théoriques comme De la nocivité du langage cinématographique, de son inutilité, intervention revigorante qui se conclut par ce cri du coeur « A bas le langage cinématographique pour que vive le cinéma ! ». Mais comme il le déclare, Moullet écrit peu de textes théoriques. « C'est dangereux. Metz, Deleuze, Benjamin, Debord se sont suicidés. Peut être avaient-ils découvert que la théorie de mène à rien, et le choc a été trop rude ». Ceci ne l'empêche pas de nous donner ses propres règles de critique : toujours faire rire le lecteur, pas de grille de lecture, ne jamais partir du Général et surtout ne pas s'y cantonner. « Avant d'écrire un texte, j'établissais la liste des calembours possibles. Pour faciliter mon inspiration, Rohmer m'avait offert le dernier almanach Vermot. »
Au fil des pages, on croisera quelques figures de son panthéon personnel. Don Luis Bunuel (« Je me rappelle cette saillie de Rohmer : « Moullet, je sais pourquoi vous adorez Bunuel, c'est parce que vous êtes tous les deux des fumistes ». Le plus beau compliment de toute ma vie »), Cecil B. DeMille, Kenji Mizoguchi, Edgard G. Ulmer ou plus récemment, Alain Guiraudie. Moullet s'y révèle précis, original dans ses approches souvent, et curieux toujours, révélant un amour du cinéma aussi large qu'on puisse l'imaginer. Ce qui me comble.
Dans un autre registre, Les maoïstes du centre du cinéma est une approche passionnante et très documentée sur les coulisses financières du cinéma français, écrit en 1999 pour un ouvrage sur le cinéma et l'argent. Moullet nous y révèle entre autre qu'il a faillit mourir de rire devant le devis d'un film de Pialat. Ce qui n'est pas rien, pensez-y deux secondes.
Pour ceux qui auraient envie de s'amuser autrement, éventuellement de s'énerver un peu, il y a deux textes assez raides. Le premier sur Michael Powell, « Michael Powell n'existe pas » écrit pour la défunte Lettre du cinéma. Moullet tend à mettre le crédit des oeuvres aux collaborateurs du cinéaste anglais, du comparse Emerich Pressburger, du monteur David Lean, du directeur de la photographie Jack Cardiff,et des producteurs comme Korda, faisant de Powell une sorte de réalisateur - ectoplasme. On sent pas mal ici cette méfiance de la tendance Cahiers envers le cinéma anglais. Ça se discute et c'est sans doute fait pour cela.
L'autre texte est un bel inédit puisqu'il a été refusé de partout. Avec entrain, Moullet s'attaque à l'une de nos modernes icônes, l'hispanique homme de la Mancha, Pedro Almodovar. « Russ Meyer soft », « John Waters du pauvre », le réalisateur de Volver est habillé pour l'hiver. L'humour du texte et le pertinence de certaines remarques, même s'il y aurait à dire là aussi pour la défense de l'accusé, atténuent la fougue radicale de la charge. Mais le positionnement un brin iconoclaste est réjouissant.
Moullet déplore en introduisant de dernier article les temps plus rudes mais plus stimulants (Le travelling de Kapo par Rivette si vous voyez ce que je veux dire) qui permettaient finalement d'approfondir les réflexions sur tel ou tel réalisateur. Le trop grand consensus actuel est sans doute ce qui ôte à la critique son utilité avec sa crédibilité. Moullet, lui poursuit dans la même veine son travail critique comme son activité de cinéaste, à sa façon, sans concessions aux modes ni à l'air du temps. Tout à ses passions. Piges choisies est aussi drôle que stimulant intellectuellement. Un ouvrage indispensable aux bibliothèques des cinéphiles de bon goût, à ranger à côté des chroniques de Jean-Patrick Manchette, Les yeux de la momie, histoire de voir comment ces deux là se supportent. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite mais regardez bien la photographie de l'auteur qui illustre la couverture. L'air inspiré devant la bonne vieille machine à écrire mécanique, il a la cigarette dans la narine.
11:55 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : luc moullet, cinéphilie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/05/2009
Ōshima : Eté japonais, double suicide
Si Muri shinju: Nihon no natsu (Eté japonais, double suicide) tourné en 1967 par Nagisa Ōshima emprunte à l'univers des yakuzas (truands japonais), c'est principalement un masque porté par le film avec désinvolture. De même, il ne faut se fier qu'à moitié au double couple du titre. C'est bien l'été au Japon, mais la majeure partie du film se déroule dans un intérieur sombre et de nuit. En fait de double suicide, figure ô combien importante du cinéma d'Ōshima, il s'agit surtout du désir de mourir d'un seul homme, Otoko (qui signifie l'Homme, justement) joué par l'acteur fétiche Kei Sato. L'héroïne, Nejiko, jouée par la potelée et délicieusement vulgaire Keiko Sakurai est plutôt animée d'une intense pulsion de vie matérialisée par la double envie de pisser et de baiser, alternant l'ordre selon les circonstances.

Le premier quart d'heure est du Ōshima pur jus. Noir et blanc en Scope ouvragé par Yasuhiro Yoshioka, rythme sautillant de comédie rock and roll, esprit pop art entre body painting et tag, montage coq à l'âne. Nejiko a donc envie d'aller uriner. Hélas, les toilettes publiques sont envahies d'escadrons de jeunes hommes occupés à tout repeindre en blanc. Nejiko change son fusil d'épaule (quelle expression !) et comme Jane Russel chez Howard Hawks, demande s'il y a là quelqu'un pour l'amour. La pauvre semble transparente aux goujats qui la repeignent comme le vulgaire carrelage. Vexée, Najiko part assouvir ses besoins de deux ordres ailleurs. Sur un pont désert comme dans un film d'après la bombe, elle se met à l'aise et commence par envoyer par dessus le parapet petite culotte et soutien-gorge. Les délicats dessous sont recueillis par un nageur bientôt suivi par une procession nautique portant un drapeau japonais. Étonnant ballet nautique et nationaliste filmé de haut. Nous sommes bien chez Oshima, les corps constitués défilent avec cérémonie. Najiko n'aura pas plus de chance avec la fanfare des jolis militaires, puis tombe sur une procession de moines au milieu desquels elle rencontre, enfin, Otoko.
Le DVD
Photographie : capture DVD Carlotta
11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/05/2009
Ōshima : L'obsédé en plein jour
C'est à une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine que nous convie Nagisa Ōshima avec Hakuchu no torima (L'obsédé en plein jour) en 1966. Narrativement et visuellement, le film est ambitieux et complexe. Mais au fur et à mesure que l'on découvre l'oeuvre du cinéaste nippon, l'on en est de moins en moins surpris, simplement toujours admiratif. Ce film nécessita, nous dit-on, quelques 2000 plans, ce qui le rapproche en la matière des oeuvres d'Eiseinstein. Par comparaison, un film standard, si tant est que ce qualificatif ait un sens, en compte quatre fois moins. Ce chiffre est révélateur du travail sur le montage, Ōshima explorant cette fois d'autres voies que le plan séquence ou la théâtralité revendiquée. Montage virtuose donc, quasi expérimental, découpant les scènes en toutes petites fractions de temps, morceaux de décors, fragments de personnages. La narration enchevêtre le passé et le présent, avec une pointe d'onirisme lorsque l'institutrice Jinbo discute avec le fantôme de Genji. L'unité de l'ensemble est assurée par la photographie inspirée, en noir et blanc, d'Akira Takeda collaborateur d'Ōshima sur quatre films entre 1965 et 1967. Aux limites parfois de la surexposition, l'image multiplie les effets solaires et renforce l'aspect irréel de l'ensemble, tout comme le son qui fait ressortir violemment tel ou tel bruit comme le craquement de la corde d'un pendu.

Ces partis-pris artistiques forts et parfaitement maîtrisés nous font pénétrer en profondeur dans l'intériorité des personnages et dans leur désir, moteur de leurs actions. Hakuchu no torima prend l'aspect d'un film criminel, basé sur un livre de Tsutomu Tamura abordant un fait divers réel. « L'obsédé en plein jour » est le surnom donné à un homme qui, à la fin des années 50, agressait, violait et tuait éventuellement des jeunes femmes. Un point de départ en or pour un réalisateur qui s'est toujours passionné pour les rapports entre sexe, amour, violence et mort. Ōshima en tire une oeuvre-puzzle fascinante quelque part entre les constructions mentales d'Alain Resnais (le temps et l'espace) et les explorations formelles d'un Sergio Léone (rapports entre gros plans et plans larges, visages et paysages).
Le DVD
Photographie : capture DVD Carlotta
10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2009
La maîtresse du professeur
00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2009
Ōshima : A propos des chansons paillardes au Japon
Et hop ! En voilà une et hop ! Hop !
Le cinémascope utilisé avec talent, hop !
Est d'une beauté incomparable, hop ! Hop !
Et hop ! En voilà deux et hop ! Hop !
Les pensées des étudiants après leurs examens, hop !
Vont à la fille de la place 469, hop ! Hop !
Et hop ! En voilà trois et hop ! Hop !
Pour baiser la femme de son professeur, hop !
Mieux vaut le faire sur son cercueil, hop ! Hop !
Et hop ! En voilà quatre et hop ! Hop !
Pour tout savoir du japon des années 60, hop !
Mieux vaut partir de ses chansons paillardes, hop ! Hop !

Et hop, c'est le postulat de départ de Nagisa Oshima pour Nihon Shunka-kô (A propos des chansons paillardes au Japon) tourné en 1967, au coeur d'une intense période créatrice. Le premier plan annonce la couleur. Quelques gouttes d'encre noire sur un rectangle rouge vif dessinent un cercle, parodie du drapeau au soleil levant. La tâche roussit puis s'enflamme. Le film sera brûlot, cocktail molotov embrasant le pays, frappant au coeur de ses symboles. Mais avec élégance. Ce qui frappe d'emblée dans le film, c'est la beauté de ses cadres. Oshima est un maître de l'écran large comme Sergio Léone, David Lean ou Jean-Luc Godard un temps. Les premières scènes suivent les déambulations de quatre étudiants à l'issue de leurs examens. Leurs corps sanglés dans leurs uniformes scolaires s'inscrivent dans les architectures grandioses et futuristes de l'université, un vaste terrain de sport, le parapet d'un pont sous la neige. Lorsqu'ils croisent une procession (Celle du « jour de la fondation de l'Empire », il faut le savoir), la foule vêtue de sombre, portant des oriflammes noirs et blancs arrive à angle droit avec une file d'écoliers en imperméables jaunes.
Le choc des générations est celui des couleurs et des lignes. Comme dans Lawrence of Arabia (1962), le film de David Lean qui revient comme un leitmotiv ironique tout au long du film, il n'y a pas de plan anodin dans Nihon Shunka-ko. Le chef-opérateur Akira Takada n'a qu'une courte carrière mais il s'y entend ici pour jouer des ambiances et de la profondeur du champ large. Plus tard, après avoir couché avec la maîtresse de son professeur devant son cercueil, Nakamura, l'un des étudiants, se promène longuement avec la jeune femme en surplombant la ville au crépuscule. Oshima sait rendre l'étrange beauté de ce japon urbanisé, moderne et tourmenté, comme Yasujirō Ozu se plaisait aux dessins des lignes électriques sur le ciel.
Le DVD
Photographie : capture DVD Carlotta
11:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
























