18/03/2009
Interlude musical (Une semaine de vacances)
22:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jerry goldsmith, howard hawks | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2009
Chez le bouquiniste
12:06 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : revue, jean renoir | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/03/2009
Le genou de Claire
Le genou de Claire c'est d'abord la belle barbe de Jean-Claude Brialy dans le rôle de Jérôme qui me fait toujours irrésistiblement penser à celle que portait mon père dans les années 70. Ce sont les chaussettes blanches de collégienne que porte Béatrice Romand quand elle entre dans le cinéma de Rohmer. C'est la blondeur de Fabrice Lucchini au début de sa carrière, qui fait lui aussi sa première apparition chez le maître. C'est le teint pain d'épice et les courbes délicates de Laurence de Monaghan au genou tentateur et si parfait. C'est l'accent roumain de Aurora Cornu, sa démarche posée et ses mains délicates.

Capture DVD Opening
Le genou de Claire est l'une des plus éclatantes réussites d'Eric Rohmer. Il suit immédiatement Ma nuit chez Maud et peu se voir comme un contre-pied. A la neige de Clermont-Ferrand, au noir et blanc de Nestor Almendros, aux dialogues en profondeur sur la foi, Pascal et l'amour, au visage un rien sévère de Jean-Louis Trintignant se substituent le soleil d'été sur le lac d'Annecy, les cerisiers sous la brise, les couleurs de montagne du même chef opérateur, un marivaudage (le terme est particulièrement bien adapté ici) brillant et la décontraction barbue de Jean Claude Brialy. Le film a la grâce et la légèreté des jeunes filles en fleur. Le rose est sa couleur, comme celle de ses intertitres.
(La suite sur Kinok)
Le DVD
Sur Critikat
Sur Cinéastes.net
11:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : eric rohmer | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/03/2009
Gran Torino pour les nuls
J'avoue que ça me réjouis assez de voir, face à l'unanimité louangeuse de la critique officielle, que c'est sur la blogosphère que les avis sont plus tranchés et que les esprits s'échauffent autour du Gran Torino de Clint Eastwood. Je suis plus sceptique sur les empoignades autour du présupposé racisme d'Eastwood et de son film, qui tournent vite au dialogue de sourd. Les échanges autour du texte de Jean-Baptiste Morain sur le site des Inrocks sont exemplaires (façon de parler). Cette histoire de racisme me semble passer à côté de ce qu'est le film mais de cela, j'en ai déjà parlé. Ce qui se joue dans le texte de Morain, et qui fait que ça tourne en rond, c'est que son attaque du film l'amène à attaquer ceux qui l'ont aimé, ses lecteurs au passage, puisque le film selon lui permet à ses admirateurs « d'exprimer sans remords ni conséquence leur racisme larvé ». Morain a regretté cette phrase dans l'un de ses commentaires et je lui en sais gré, mais c'est révélateur de cette manie que l'on a de vous sommer de choisir votre camp. Chose que je déteste entre toutes. Holà, camarade ! Es-tu Val ou Siné ? Royal ou Aubry ? Fromage ou dessert ? Critique dialectique ou poétique ? Misère...
Ceci posé, j'avais envie de revenir sur film par un autre angle : celui de sa mise en scène. Ses détracteurs l'ont souvent attaqué là-dessus sur l'air de la platitude tandis que les louangeurs en restaient souvent à la performance de l'acteur sans entrer dans le détail. Cela tient je crois à la pratique d'une forme classique de cinéma par Eastwood qui ne se prête pas facilement à l'analyse à l'opposé de celles, pour reprendre les exemples de Ed sur Nightswimming, de David Lynch ou Gus Van Sant. J'ai donc eu envie de voir un peu comment était faite une scène du film, celle qui m'a servi de déclencheur et qui circule sur Internet. Histoire de voir ce qu'il y a sous le capot de la Gran Torino. D'ou le titre de la note, que personne ne se sente visé. Voici :
Le premier plan est un élégant mouvement de grue descendant qui nous approche de Sue et son ami marchant dans une rue vers nous. Ce qui frappe, c'est que le plan démarre sur la clôture barbelée qui entoure un pavillon. On note que le plan englobe toute une partie de la rue, une de ces rues de banlieues typiques des États-Unis, et que la maison du premier plan est la seule à être clôturée ainsi. Gran Torino est un film construit largement sur la notion de territoire. Dans l'univers du western, la clôture c'est le conflit, le danger, c'est Kirk Douglas empêtré dans les barbelés. La porte ruinée devant laquelle ils passent est comme le symbole mis à bas de l'accueil et de la propriété, valeurs américaines basiques. Il est ainsi clairement signifié que le couple pénètre dans une zone dangereuse et ces signes de danger contrastent avec leur attitude nonchalante et leur dialogue insignifiant. Bingo. La caméra les suit dans le virage et le cadre les coince entre la clôture et le groupe des trois jeunes noirs. Jolie maîtrise de l'espace.
Confrontation entre les trois noirs et le couple, c'est le jeune homme qui tente de faire croire qu'il n'ont pas transgressé le territoire parce qu'ils en font partie. Il tente des signes de reconnaissance, : gestes et paroles. Ça tombe à plat. La mise en scène enchaîne des plans moyens animés d'un léger mouvement qui s'oppose au mouvement tournant des trois jeunes noirs. Le cadre encercle littéralement le couple et le coince contre la clôture. Ce qui m'avait frappé à la première vision, c'est ce mouvement de la caméra, qui donne une impression de porté mais reste maîtrisé, sans doute à la steadycam. Il se superpose à une sorte de balancement qui redouble l'effet de balancement des corps et les souligne ironiquement. On est loin d'une banale caméra à l'épaule.
Dans l'étape suivante, les trois jeunes noirs s'en prennent directement au jeune homme et l'éjectent littéralement du cadre à plusieurs reprises. La sensation de violence suspendue est accentuée par le resserrement du cadre qui rend le danger moins visible, témoin l'irruption de la main qui renverse la casquette sans que l'on voit l'agresseur.
Arrivée du héros dans sa camionnette. Une sorte de mini ellipse dans l'espace dont la continuité est assurée par le son. C'est un très beau plan large, peut être un peu trop court, suivi d'un mouvement en avant sur le visage de Kowalski. Eastwood va convoquer ici deux figures mythiques, L'homme sans nom et l'inspecteur Harry. Le brusque changement de point de vue et l'élargissement du cadre donnent une aura immédiate au véhicule puis à celui qui le conduit. Tout à coup, il est là. Pas de raison particulière. C'est ainsi qu'Eastwood apparaît dans nombre de ses westerns et dans le fondateur Per un pugno di dollari. Dans les films avec l'inspecteur Harry, il est toujours là où ça se passe, mais il est généralement déjà en scène (il vient prendre son café ou manger un morceau). C'est un plan qui a un côté très années 70, comme en on a vu de superbes dans Assaut ou Halloween de John Carpenter.
Le saut dans l'espace qui suit accentue la violence fait au jeune homme coincé contre la clôture. Il est mis hors du coup et la scène reprend avec une variante. Cette fois, c'est Sue qui s'oppose au groupe mais elle a choisi de se défendre et tente de rompre l'encerclement tout en insultant copieusement ses agresseurs. Kowalski amène alors sa camionnette en bordure du « territoire » des jeunes noirs et ceux-ci se disposent en triangle, selon une géométrie classique pour les admirateurs de Sergio Léone.
La descente d'Eastwood est un grand moment. D'abord, il est là, même de dos, dans la camionnette, le visage se reflétant discrètement dans le rétroviseur. A de nombreuses reprises, Kowalski sera ainsi filmé en un reflet, face à un miroir. Quand il sort, il est dans un premier temps sur la chaussée et donc apparaît plus petit que ses antagonistes. Puis il fait un pas en avant et monte sur le trottoir tandis que la caméra s'avance un petit peu. Cela donne l'impression qu'il domine tout à coup, qu'il s'étire sur la hauteur du cadre. C'est un procédé que John Ford utilisait avec Henry Fonda, façon d'accentuer sa domination morale. C'est assez subtil et c'est le genre de trouvaille qui me met en joie, comme un coup de crayon bien placé dans un dessin de Franquin. Et puis il crache mais on ne va pas revenir là-dessus.
Lors de la confrontation qui suit, on retrouve le même mouvement oscillant de la caméra mais cette fois, il épouse les mouvements de Kowalski qui vise les jeunes avec son doigt. Le danger, cette fois, c'est lui. « L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme ». Il s'agit pour Kowalski d'envahir le territoire des jeunes noirs et de s'y affirmer pour « exfiltrer » Sue. Son entrée sur le territoire se fait par ses irruptions dans le cadre, d'abord le doigt, puis, comme cela ne suffit pas, il dégaine son arme, convoquant cette fois un geste (et un cadre) vingt fois vu chez Harry Callahan, qui traverse le plan comme l'a fait tout à l'heure le bras qui retire la casquette. La symétrie jusqu'au bout, c'est à cela que l'on reconnaît une belle mise en scène classique. La sortie de l'arme correspond aussi au début d'une musique façon Lalo Schiffrin, assez martiale avec roulement de tambour. On est en plein dans le retour du mythe.
La jeune fille dans la camionnette, reste le jeune homme. On peut dire que Eastwood manifeste le mépris de Kowalski pour son attitude conciliante en les séparant nettement des plans. On entend la voix du jeune homme sur un plan de Kowalski puis celui-ci, tout en l'insultant, le pointe de son arme comme il l'a fait avec les trois jeunes noirs. Mais alors que l'un des deniers plans montre Kowalski de profil dans le même cadre que les trois jeunes noirs, il n'apparait jamais dans le même plan que le jeune homme. Il lui refuse cet « honneur ». Malheur aux vaincus. On peut presque sentir une sorte de sympathie entre le polonais et les trois noirs, ils s'acceptent comme adversaires. Ce qui est accentuée par le plan large sur le dialogue qui détend la toute fin de la séquence.
Voilà, nous sommes bien avancés. C'est pour moi une façon de faire très maîtrisée mais très peu ostentatoire. La forme se coule dans l'action et la mise en place de celle-ci sait prendre son temps. Nous sommes dans un style que je trouve proche des classiques des années 60 et 70, Don Siegel en tête, mais aussi Franklin J. Schaffner, Richard C. Sarafian ou même Peter Yates. Éloignée quand même de celui d'un John Ford dont les plans ont une force poétique indéniablement plus grande, ou d'un Howard Hawks ou d'un Sergio Léone qui ont des dispositifs bien plus sophistiqués. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sortez en rang et que le grand Cric ne vous croque pas.
A lire également :
JL sur le Ciné-Club de Caen
Chez Balloontic, très beau texte critique
Frédérique l'admiratrice
Julien le passionné
23:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/03/2009
Pirater, c'est mal
L'esprit des Monty Pythons n'est pas mort...
22:10 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : piratage, humour anglais | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
09/03/2009
Cent fusils
100 rifles (Les cent fusils), tourné en 1969 par Tom Gries, est de ces films qui me faisaient grimper aux rideaux quand j'étais petit. Tout en me doutant de la réponse, je me demandais comment il avait passé toutes ces années dans un coin de mon souvenir. Pas de surprise, il reste un spectacle agréable et enlevé tout en se révélant un film bien médiocre. 100 rifles est de ces westerns d'aventures situés au Mexique, au début du 20e siècle traversé de secousses révolutionnaires. C'est aussi l'un de ces westerns hollywoodiens qui pillèrent à l'époque les formes du western italien, ses trucs et ses tics, espérant bénéficier de son succès. Il faut se rendre à l'évidence, le western américain entre 1964 et 1969, à quelques exceptions brillantes, quelques derniers feux de grands maîtres, est au fond du trou tandis que son confrère italien livre ses plus beaux fleurons. Donc on imite et Tom Gries, par ailleurs réalisateur d'un estimable Will Penny (1968), déballe la panoplie : Il y a un train, des mitrailleuses, une armée mexicaine impitoyable dirigée par un général sadique (Fernando Lamas), un conseiller militaire allemand, des péons opprimés en tuniques blanches et sales (ici des indiens Yaquis, mais c'est du pareil au même), les étendues désertiques d'Alméria, de la dynamite, des exécutions capitales et un passage à tabac. Et puis aussi un héros gringo qui fera sa prise de conscience en faveur des révolutionnaires, un héros paysan un peu truand mais grand coeur et une passionnaria habile à la gâchette.

L'originalité, c'est qu'ici le gringo est un noir, joué par Jim Brown au charisme certain. Lyedecker est un shérif lancé sur les traces du voleur de banque Yaqui Joe (Burt Reynolds, moustache flamboyante et sombrero) comme Lee van Cleef se lançait à la poursuite de Tomas Milian dans le Colorado de Sergio Sollima. Bon, Yaqui Joe a volé une banque américaine pour payer des armes (les cent fusils) à la guérilla indienne menée par la belle Sarita, très belle Raquel Welch. Curieusement, et malgré quelques allusions, le film n'exploite pas tant la thématique du racisme. D'une façon générale, le film annonce la couleur avec sa phrase publicitaire : « Ce film a un message : faites gaffe ! ». Avec ça... Peut être que les actes se suffisaient d'eux-même. L'étreinte vigoureuse entre Brown et Raquel Welch, une première dans le cinéma grand public, reste une date dans la représentation des noirs dans le cinéma hollywoodien. La scène est plutôt jolie et le choc de ces deux beautés est l'un des sommets du film. Entre les deux, Reynolds fait le guignol, déjà très loin de son personnage de Navajoe Joe (1966) de Sergio Corbucci. Il est également assez loin des compositions équivalentes données par Tomas Milian, Eli Wallach ou Tony Musante. Il reste le faire-valoir du héros américain, quand bien même celui-ci est noir. On ne lutte pas contre sa nature.
L'héroïne de la révolution, c'est donc Raquel Welch. Ah ! Raquel... Elle est magnifique, pur fantasme adolescent. Mais elle est aussi crédible en indienne yaqui qu'au milieu des dinosaures de la Hammer films. Elle se situe dans la ligne des beautés terriblement anachroniques du western américain de l'époque : Bibi Andersson, Candice Bergen, Senta Berger... On se dit que le sous prolétariat mexicain a bien de la chance de compter de si belles femmes dans ses rangs. Je me demande ce qui attirait les réalisateurs de l'époque vers ces types plutôt européens, plutôt nordiques. Seul Sam Peckinpah a fait l'effort de trouver un prétexte. On pourra préférer les belles brunes Giovanna Ralli, Martine Beswick, Chelo Alonzo ou Nicoletta Machiavelli un peu plus adaptées à ce genre d'histoires.
Reste que c'est dans ce film que Raquel Welch arrête un train de l'armée en prenant une douche sous un réservoir d'eau. En chemise, hein, mais ce n'en est que plus excitant. La séquence est d'anthologie. L'eau était peut être froide, mais Raquel a une façon de bouger très nature, qui tranche avec son jeu corporel pendant le reste du film. Elle dégage, durant ces quelques instants, une vitalité exceptionnelle.

Pour le reste, la mise en scène est plate, sans aucune de ces inventions de cadre ou de montage qui me ravissent chez les italiens. Peu d'emploi de la profondeur de champ, la caméra est à l'endroit de l'action mais se contente de l'enregistrer sans chercher à la sublimer. Absente. Le montage est pépère, accélérant doucement lors des scènes d'action. L'arrivée du train dans la ville, par exemple, n'est spectaculaire que pour ses effets pyrotechniques. On est loin de l'attaque du train turc chez David Lean. La photographie de l'espagnol Cecilio Paniagua est à l'avenant, sans relief, ne faisant ressentir ni la sueur des visages, ni la poussière du désert. Soyons juste, les très gros plans sur le visage de Raquel Welch lors de l'étreinte, légèrement voilés, dégagent quelque chose de sensuel et violent. C'est déjà ça.
Au crédit du film, la partition de Jerry Goldsmith. Dans les années 60, ce grand compositeur a donné quelques belles musiques à des westerns moyens, contribuant à les garder en mémoire : Bandolero, Rio Conchos, le remake de Stagecoach, le Rio Lobo de Hawks. Goldsmith y renouvelle le genre, arrivant à se dégager des canons des grands anciens sans tomber dans la parodie du style d'Ennio Morricone. Ses partitions sont rythmées, basées sur une thème principal fort, du genre que l'on peut fredonner en sortant de la salle (très important, ça). Tempo vif, accents jazz et pop, guitare folk (l'ouverture de Rio Lobo est superbe), c'est enthousiasmant et, avec Raquel Welch, la trop courte apparition de Soledad Miranda, égérie de Jesus Franco, et le torse de Jim Brown, les raisons essentielles du plaisir pris à 100 rifles.

Photographies : captures DVD 20th Century Fox (en zone 1 hélas).
11:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : tom gries | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
06/03/2009
Le convoi sauvage (au coin du feu)
Le western du mois, sur le forum Western Movie, c'est Man in the wilderness (Le convoi sauvage) réalisé en 1971 par Richard C. Sarafian. C'est un film qui n'a cessé de me fasciner. Quand j'étais adolescent, je l'ai vu deux ou trois fois à la télévision, et à chaque fois, je l'oubliais. Et à chaque fois je le retrouvais avec bonheur. Depuis je l'ai revu en salle (la photographie du grand Gerry Fischer est une splendeur) et je n'ai cessé d'en garder en moi les images. Ce film fait partie de ces westerns qui ont renouvelé le genre entre la fin des années 60 et le début des années 70. Nouveau ton, nouvelle esthétique, se dégageant de l'influence de la révolution des westerns italiens tout en retrouvant quelque chose des grands classiques.

Man in the wilderness raconte l'histoire d'un trappeur accompagnant une expédition et laissé pour mort après avoir été attaqué par un ours. Il survit et, comme dans Red River (1946)de Hawks ou Bend of the river (Les affameurs - 1952) de Mann, il se lance à la poursuite de ceux qui l'ont abandonné. Habité par la présence de l'acteur Richard Harris, le film est un poème élégiaque et un conte écologique assez proche du Jérémiah Johnson de Sidney Pollack. L'homme et la nature, toutes ces sortes de choses. Impossible d'oublier ces images épiques du bateau traîné à travers plaines et montagnes par l'expédition menée d'une main de fer par le personnage joué par John Huston, variation du capitaine Achab de Moby Dick. Impossible d'oublier la partition enlevée de Johnny Harris. C'est un film remarquable, à découvrir ou redécouvrir, comme l'oeuvre étrange et attachante de Sarafian auquel on doit The man who loved Cat Dancing (Le fantôme de Cat Dancing - 1973) ou Vanishing point (Point limite zéro - 1971).
11:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : richard c. sarafian | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/02/2009
Les petites choses qu'on laisse derrière soi (Gran Torino)
Your world
Is nothing more
Than all
The tiny things
You've left
Behind
Si ce doit être sa dernière apparition à l'écran, Clint Eastwood s'est offert une sortie de style avec Gran Torino. J'ai immédiatement eu envie de voir le film quand je suis tombé sur l'extrait que l'on trouve sur Internet. Trois voyous, noirs, provoquent un jeune couple, un blanc et une asiatique. La jeune femme tient tête mais ça se passe mal. Arrive Eastwood dans un pick-up. Il stoppe et sort, lentement, comme un vieux chat qui a encore ses griffes. Il a sa tête des mauvais jours, la grimace dont je parlais il n'y a pas si longtemps. Ce visage un peu décalé et qui ne comprend pas bien. Mais en même temps déterminé. Et puis il crache. Oui, il crache, comme il le faisait dans Josey Wales. Dans tout l'histoire du cinéma, personne ne crache comme Eastwood quand il est en colère. Immédiatement, cette scène m'a ramené à sa première véritable apparition, en 1964, dans Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars) le film de Sergio Léone qui est à l'origine de la légende. Très exactement, c'est le même homme, la même tête, la même scène que celle où il va vers les quatre hommes des Baxter pour leur demander de s'excuser de s'être moqué de son mulet. Les hommes rigolent, l'étranger relève la tête et c'est la même grimace. 45 ans plus tard, les voyous ricanent encore et, de la même façon, ça ne dure pas longtemps. C'est cette même scène qu'il nous a souvent jouée en inspecteur Harry, quand il essaye de prendre un café tranquille et que... « Les temps ont changé » / « Pas moi », ça ne vous rappelle rien ?

Bon, alors j'y suis allé, je me suis débrouillé, moi qui ai manqué les trois précédents. Et finalement, ça se tient puisque quatre films avant, c'était Million dollar baby et que Gran Torino ressemble beaucoup à Million dollar baby. C'est une histoire de filiation, c'est une histoire de transmission, c'est le portrait d'un homme qui arrive au moment du bilan. C'est une image de l'Amérique et une réflexion sur ses valeurs, sur leur évolution et comment on se débrouille avec cela. C'est aussi un film sur « les petites choses qu'on laisse derrière soi » et c'est peut être l'aspect de Gran Torino qui me le rend le plus touchant. Il y a là-dedans quelque chose qui rattache le film à Tōkyō monogatari (Voyage à Tokyo – 1953) de Yasujirō Ozu (le fossé entre parents et enfants), Seven women (Frontière chinoise - 1966) de John Ford (le sacrifice d'un personnage pour un groupe qui lui est étranger), ou encore Madadayo (1993) le dernier film d'Akira Kurosawa (sur la transmission et le bilan d'une vie).
Je ne suis pas sûr que Clint Eastwood soit du genre à « répondre » par film interposé, mais Gran Torino semble souvent comme une réponse aux critiques émises à l'époque de Million Dollar Baby. Il est sans doute plus juste de dire qu'il en reprend les lignes de force pour les peaufiner tant au niveau de la forme que du fond. On retrouve une nouvelle fois ce personnage de type fort en gueule, ici appelé Walt Kowalski (Tiens, comme le personnage de Franco Nero dans le film Il mercenario de Sergio Corbucci), « laid fort et digne » comme il y a écrit sur la tombe de John Wayne, avec un sale caractère et une façon de penser qui s'est arrêtée aux années 50. Maintenant, je sais que la fille de l'extrait du début, c'est celle de ses voisins, une famille de Hmongs, peuple asiatique ayant combattu avec les américains au Vietnam. Kowalski, d'origine polonaise et qui a fait la guerre de Corée, est presque le dernier blanc du quartier et il déteste tout le monde sauf son chien et son coiffeur italien. Le fils de ces voisins a des problèmes avec un gang local qui le pousse à voler la superbe Gran Torino (une Ford année 1972, symbole d'une Amérique alors triomphante) de Kowalski, ce qui déclenche un mécanisme complexe amenant le jeune garçon a devenir le fils spirituel de Kowalski.

Dans Million dollar baby, c'était la jeune boxeuse qui était affublée d'une famille bas du plafond. Cette fois, Eastwood donne à son propre personnage deux fils incarnant quelques uns des pire côtés de l'Amérique contemporaine. Ils sont des quadragénaires bedonnants travaillant dans le commerce, n'ayant rien conservé des valeurs paternelles (ils roulent dans des voitures étrangères alors que lui travaillait chez Ford), ne pensent qu'à leur confort et essayent de le mettre en maison de retraite. Les petits enfants ne valent pas mieux, entre la fille collée à son portable (horreur absolue) et les garçons qui fouillent dans la malle du grand père et sont incultes (Où c'est la Corée ?). Si dans Million dollar baby, il s'agissait avant tout de respecter les codes du mélodrame, la description sans nuance des fils Kowalski est d'abord un constat d'échec de la génération de leur père. A l'approche de la mort, l'angoisse profonde de n'avoir rien passé de soi-même à ses enfants taraude Kowalski. Et l'on sait combien cette idée de transmission est au coeur du cinéma de Clint Eastwood. Le jeune Thao donne sans le savoir une seconde chance à Kowalski qui, en se sacrifiant pour lui, se sauve lui-même. Ça sonne un peu chrétien, c'est sans doute le cas. On retrouve d'ailleurs un personnage de prêtre dont les relations conflictuelles avec Kowalski illustrent les questionnements d'Eastwood sur la religion.
La mise en scène travaille donc cette idée de transmission qui se fait par l'interpénétration entre Kowalski et ses voisins. La première très belle scène montre la réception qui suit l'enterrement de la femme de Kowalski. Celui-ci se sent comme un étranger dans sa propre maison. Passé sur son porche pour prendre l'air, il remarque de l'activité chez ses voisins. Suit une scène qui montre chez eux une cérémonie en l'honneur d'un nouveau né. Le film montre que ce que Kowalski a perdu dans son milieu est juste à deux pas de chez lui : un véritable esprit communautaire. Et une valeur perdue de l'Amérique. Pour l'atteindre, la retrouver, il lui faudra sortir de son territoire et accepter que l'on pénètre dans le sien. Le territoire, voilà encore une notion fondamentale du cinéma américain. De nombreuses scènes sont construites sur ces mouvements : la tentative de vol, l'invitation au repas, les cadeaux apportés par les femmes, l'intrusion du gang... il y a aussi quelques rounds d'observation assez savoureux, comme la relation délicatement décrite entre Kowalski et la grand-mère Hmong. La scène que je préfère, évidemment, c'est celle où Kowalski assis devant chez lui crache par terre en signe de mépris et que la vieille femme agit de même avec le même aplomb. Un tel personnage devrait (mais j'en doute) ouvrir les yeux de ceux qui pensent qu'Eastwood ne sait pas « filmer l'autre » si tant est que cette expression ait un sens. Par moment, je pensais à Chief Dan George, le vieil indien de Josey Wales et c'est là que j'aime le mieux notre homme Clint.

Mais assez d'expectorations, tout ceci est mis en scène avec beaucoup de simplicité et de finesse, évitant les effets parfois un peu pesant de certains autres films. L'humour est très présent et aide à fluidifier l'ensemble, sachant s'effacer avec délicatesse lors des séquences jouant sur l'émotion. Le film fonctionne comme un morceau de blues (une nouvelle fois, oui), subtiles variations sur un thème basique, rauque, chaleureux et mélancolique. Je suis toujours aussi amateur de la photographie de Tom Stern avec ses ambiances parfois très sombres et un travail sur les couleurs qui élimine les teintes vives et donne une impression de noir et blanc sur lequel tranche le rouge et bleu du drapeau qui orne la façade de la maison de Kowalski. La musique de Eastwood fils est un peu trop discrète à mon goût mais ce n'est pas nouveau.
C'est un premier texte un peu à chaud. J'ai véritablement eu le sentiment d'assister à un Eastwood majeur, un de ces films que font les réalisateurs passé un certain âge, dans lesquels il essayent de rassembler tout ce qui leur est cher et que, moi aussi prenant de la bouteille, j'apprécie de plus en plus. Je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser par la surface de Gran Torino et les sublimes crachats de Clint Eastwood. Ce film a la classe d'une voiture racée et on est loin d'en avoir épuisé les beautés.
A lire également chez Ed de Nightswiming, le Bon Docteur Orlof et Matière focale. Pour le moment.
Photographies : Copyright Warner Bros. France
00:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/02/2009
Besson par Mozinor
Je suppose que nombre d'entre vous ont entendu parler de la dernière sortie de Luc Besson à propos du piratage et de tout ce qui s'en suit. J'imagine que la proximité des débats au parlement sur une nouvelle loi « création et internet » (sic!) est la raison de ce genre de discours qui sont surtout révélateur d'une peur panique. Internet, c'est un peu l'anarchie, c'est une très grande liberté qui ne rime pas toujours, comme dans les gros films américains, avec grande responsabilité. Mais bon, la vraie vie est tellement submergée de biométrie, de droits, de règles, de vidéosurveillance, de procédures, de contrats et de normes que l'homme, dont l'état naturel est de folâtrer en compagnie de la femme, nu et libre comme un cabri des montagnes, s'est engouffré dans cette belle brèche du système. Comme disait la mère de l'autre : « Pourvu que ça dure ». Évidemment, tout ça ne plaît pas du tout à ceux qui sont du bon côté du contrat. Filtres, censure, délation, riposte graduée, DRM un temps, procès, tout l'arsenal est mis à contribution pour enrayer l'hémorragie, verrouiller la Toile et mater tous ces petits salopards. Mais ça ne se révèle pas si simple que cela. Au milieu de cette mère de toutes les batailles, la réaction du Besson est anecdotique. Elle m'arrache néanmoins un sourire dans la mesure où Besson est quand même un roi du recyclage des idées et formes des autres. En soi, ce n'est pas un problème, c'est aussi ce que fait Tarantino, mais alors, on a la décence de se taire. Mieux vaut donc en rire, et si je vous raconte tout cela, c'est pour faire entrer Mozinor sur Inisfree. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mozinor est un grand détourneur devant l'éternel. Moi, je l'adore, j'ai diffusé nombre de ses films dans le cadre des manifestations de Regard Indépendant. Modeste, il tient à rester virtuel. Mais il est doué le bougre et il a vite dépassé le côté potache qui sévit sur le Net pour développer un univers original et de plus en plus glacé et sophistiqué que je vous laisse le plaisir de découvrir sur son site. Et puis, sa réponse à Besson :
23:04 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : mozinor, luc besson | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2009
Chère Arly Jover
Il fallait que je vous écrive ces quelques lignes, Arly très chère, permettez-moi de vous appeler Arly, que je vous écrive ces lignes donc car je me trouve encore très proche de ce moment étrange et pénétrant où je tombe sous le charme d'une actrice. En bon cinéphile, c'est une chose qui m'arrive régulièrement mais qui est plus rare que les notes enflammées remplissant les colonnes de ce blog pourraient le laisser accroire. Car j'aime les actrices, à ma respectueuse distance de spectateur, mais pleinement, totalement, « amoureux de l'amour » comme disait l'autre.

Sur L'empire des loups (Source Allociné / www.collectionchristophel.fr)
Aujourd'hui, cette actrice c'est vous, chère Arly Jover, permettez-moi de savourer l'intégralité de votre patronyme. C'est vous et c'est tout récent et c'est par hasard et c'est tellement plus agréable quand c'est par hasard. On (Merci Laurent) m'a proposé de chroniquer Le voyage aux Pyrénées des frères Larrieu, film que les réserves de mes collègues "de bureau" m'avaient rendu peu attractif. Je passais outre mes réticences et bien m'en pris puisque c'est ainsi que vous m'êtes apparue. Il me plaît à croire que ce fut un coup de pouce du destin, coup de pouce qui se renouvela par deux fois lors du festival de Clermont-Ferrand en m'amenant, au milieu de la jungle luxuriante des programmes, à vous retrouver dans l'agréable Bunker de Manuel Schapira puis dans l'intriguant C'est plutôt genre Johnny Walker de Olivier Babinet. Tout ceci est assez frais pour que je m'attarde sur ce processus de séduction.
Dans le film des frères Larrieu, vous êtes l'hôtesse pyrénéenne du couple d'acteurs incarné par Sabine Azema et Jean-Pierre Darroussin. Vous incarnez le naturel face au factice de vos invités et malgré un improbable compagnon ex-sherpa tibétain. Vous y êtes douceur et tendresse, sensible au charme et au désarroi du personnage de Darroussin. Je crois que ce qui m'a immédiatement séduit, c'est votre pointe d'accent espagnol, vous qui êtes née à Mellila, pointe tout à fait délicieuse. Vous avez également une qualité rare, c'est de savoir jouer l'écoute. Dans votre première grande scène avec Darroussin c'est un bonheur de vous regarder écouter ses épanchements et lui servir un verre à la façon dont le fit jadis Angie Dickinson pour John Wayne dans Rio Bravo. La seconde scène qui m'a vraiment emballé, c'est celle où vous le ravitaillez dans son refuge de montagne. On sent, là, que quelque chose se passe entre vous. Un petit moment que vous jouez tout en retenue et simplicité. Un moment silencieux, presque recueilli où vous griffonnez quelques lignes sur son journal intime alors qu'il a le dos tourné. Voilà, c'est là je crois bien, que le charme a agit.
Sur le tournage de Bunker (Source Long courts)
C'est dans le même registre et avec encore le goût de cette scène en bouche que je vous ai retrouvée dans Bunker. Infirmière, vous vous occupez de la mère du héros tout en étant amoureuse de lui. Vous êtes là encore celle qui soigne et qui écoute, celle aussi que l'on sent animée d'une passion, pleine mais tranquille, d'un amour vrai mais à nouveau retenu. C'est trop. Même votre accent est retenu dans ce film. Trop sage, vous ne bousculez pas assez les cadres de cette histoire, mais ce qui palpite dans votre présence illumine ce court-métrage. Entre la mère et le fils, vous vous glissez avec une grâce de mouvements qui vient peut être de votre formation de danseuse.
Votre délicieux phrasé revient en force dans C'est plutôt genre Johnny Walker avec cette réplique lancée à la pointe de la langue « Tu m'emmerdes ! » qui m'a donné des frissons dans le dos. Vous êtes dans ce film-ci le point de stabilité dans un film à la dérive, dérive qui en est le sujet puisqu'il s'agit de celle de son héros, Étienne, dont vous êtes la maîtresse excédée. Soyons clair, on vous y voit trop peu même si, comme l'on vous devine toujours présente dans l'esprit d'Étienne, vous restez l'alpha et l'oméga de cette histoire agréablement tordue. Mais je n'avais d'yeux et d'oreilles que pour vous. Pour votre physique latin et félin, vos doigts déliés et votre allure langoureuse. Une femme faite et sensuelle qui tranche agréablement avec les post adolescentes encore vertes qui sont la majorité des nouvelles actrices. C'est peut être cela qui me séduit, comme en leur temps m'avaient séduites Mireille Perrier ou Isabelle Renauld. Votre singularité ouvre les portes de l'imaginaire au-delà des clichés habituels. Chère Arly Jover, permettez à votre nouvel admirateur d'espérer que vous allez trouver des rôles à la mesure de ces promesses. Vous me trouverez prêt à vous suivre.
18:34 Publié dans Courrier du coeur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : arly jover | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/02/2009
Shane au coin du feu
Clermont et le reste m'ont quelque peu fait oublier de vous signaler le western au coin du feu mensuel sur le forum Western Movies. Il s'agit de Shane (L'homme des vallées perdues) réalisé en 1953 par Georges Stevens. C'est un des classiques des années 50, une sorte d'archétype avec son héros solitaire (Alan Ladd), son tueur impitoyable aux gants noirs (Jack Palance, époustouflant et modèle du Phil Defer de Morris pour Lucky Luke), ses fermiers en butte aux agissements de gros éleveurs, le meurtre d'Elisha Cook Jr, Ben Johnson, Jean Arthur et le gamin qui regarde partir son héros au loin, vers les montagnes. J'avoue pourtant que c'est un film qui m'est passé à côté. Je l'ai sans doute vu trop tard et n'en garde qu'un souvenir diffus. La discussion qui se déroule sur le forum, avec quelques belles interventions d'admirateurs me donne envie de la redécouvrir.

16:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : georges stevens, forum | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/02/2009
Clermont 2009 : sélection nationale
Curieusement cette année, plusieurs des films qui m'ont le plus touchés dans la sélection nationale étaient des co-productions plus révélatrices des pays tiers que de la France éternelle. Partition oubliée de Teona Grenade se déroule à Tbilissi, Georgie, et est parlé en géorgien, avec un sujet tout à fait géorgien. On y suit un jeune garçon, pianiste prodige, et sa relation avec son grand frère qui fait partie de la mafia locale. On est dans la référence aux grands films de gangsters, ceux de Scorcese, Léone ou De Palma, et dans une ambiance qui rappelle le Gomorra de Matteo Garrone. C'est bien enlevé et assez palpitant à suivre. Séance familiale de Cheng-Chui Kuo vient de Taiwan et repose sur un belle idée plutôt bien exploitée avec un joli et émouvant retournement final. Une équipe de télé-réalité laisse un cameraman 24 heures au sein d'une famille ordinaire. Au contact de cet intrus, un secret bien enfoui remonte à la surface. C'est finement observé, plutôt drôle, avec cette sorte de mélancolie propre au cinéma de ce pays. Le coeur d'Amos Klein est un film d'animation plutôt franchement israélien de Uri Kranot et Michal Pfeffer. C'est une très belle évocation de la construction du mur qu'Israël a bâtit entre lui et ses voisins palestiniens, à travers les bribes de souvenirs qui remontent à Amos Klein subissant une opération à coeur ouvert. Il se trouve que Klein est l'un des artisans de la construction du mur. Les souvenirs de Klein sont autant de moments de l'histoire du pays, autant d'étapes qui le voient s'enfoncer dans l'engrenage de la guerre, de la violence et du repli sur soi-même. Une oeuvre intense et techniquement virtuose.
Côté animation, de belles choses comme Skhizein de Jérémie Clampin dont c'est le second court. Henri, petit personnage à la grosse tête ronde est frappé par une météorite et se retrouve à vivre à exactement 91 centimètre de lui-même. Ce n'est pas évident à concevoir, c'est encore plus dur à vivre, surtout quand un psychanalyste s'en mêle et qu'un décalage vertical se juxtapose au décalage horizontal. Je ne sais pas si je suis bien clair ? Le délire mathématique de ce film est rigoureusement contrôlé, lui, sans oublier un poil de méditation sur la condition humaine. La vita nuova est la nouvelle oeuvre d'Arnaud Demuynck, en co-réalisation avec Christophe Gautry. Inspiré de la vie et de la poésie de Gérard De Nerval, c'est un film de très belles marionnettes sur lequel flotte la voix d'Arthur H. envoûtante. Les images sont en noir et blanc, très travaillées, comme l'est la technique d'animation et les inventions graphiques. C'est un film que j'aurais aimé un peu moins raide pour pouvoir l'aimer plus, un film que j'aurais préféré admirer moins pour être plus sensible à l'émotion de la poésie. C'est de la belle ouvrage. Très belle gallerie de photographies de tournage.
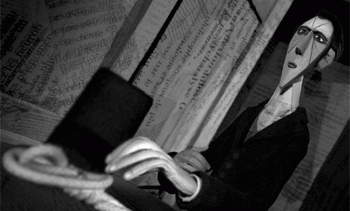
La vita nuova (Les films du Nord)
Comme je l'ai écris en introduction, il y eu plusieurs films plutôt bien fichus, assez agréables à voir, mais qui ne m'ont laissé qu'une impression fugitive. Il y a dedans un point de départ intéressant mais, empruntant des sentiers trop balisés, ces films se laissent deviner facilement et me laissent au moment de la résolution avec un sentiment de banalité. Inutile de s'attarder et voyons du côté de choses plus intrigantes. La vie lointaine, par exemple, de Sébastien Betbeder, fait se rencontrer dans la campagne profonde un fantôme japonais, des ours slovènes parlants, un réalisateur (japonais lui aussi) en train de préparer son nouveau film, accompagné de sa jeune assistante puis rejoint par une amie (quel plaisir de retrouver Aurore Clément) et un jeune homme fragile venu se reposer. Il y a aussi une jeune femme blonde qui fait du parachutisme. Le film déploie lentement mais sans ennui un univers un peu fantastique, un peu fantaisiste, assez attachant. Il y a bien quelques soucis techniques (certains plans nocturnes sont difficilement lisibles), mais dans l'ensemble le film est inventif et surprend constamment. Ce croisement curieux de la campagne française et d'éléments venus de la culture du Japon m'a rappelé un assez joli film, Le pays du chien qui chante (2002) de Yann Dedet et ses deux japonais fascinés par le film de Jean-François Stevenin, Le passe-montagne, et venus retrouver les traces du film dans le Jura. Une scène résume cet étrange croisement, lorsque le réalisateur s'apprête à jouer un morceau sur un instrument japonais traditionnel, habillé comme dans un film de Ozu, le morceau se révèle être... une chanson d'Adamo.
Étonnant également Les paradis perdus de Hélier Cisterne qui se situe en 1968 et propose une sorte de leçon de relativité. Soit une jeune fille pleinement engagée dans « les évènements ». Elle vomit ses parents, braves bourgeois, et veut se mêler des affaires de son père, industriel dont l'usine est occupée. Ce faisant, elle va découvrir une facette pour le moins inattendue de son géniteur et le conservatisme va changer de camp. L'idée est audacieuse, bien menée malgré un final un peu prévisible. C'est très bien joué par Julie Duclos, Philippe Duclos et Marie Matheron.
C'est plutôt genre Johnny Walker de Olivier Babinet est une tentative intéressante de dérapage dans le fantastique. Porté par un acteur atypique, Pablo Nicomedes, sorte de Vincent Gallo en moins ours, le film suit son anti-héros minable, viré de chez sa compagne, dans une errance nocturne entre deux eaux qui va le mener dans une boucle temporelle façon Groundhog Day (Un jour sans fin- 1993 déjà) de Harold Ramis. Le réalisateur arrive très bien à faire basculer la réalité dans l'étrange à l'aide de visions incongrues, comme cette gélule géante qui tournoie au dessus de la ville, et d'une bande son hypnotique, un peu trop électronique à mon goût mais bien adaptée à ce récit. A noter la prestation de la belle Arly Jover, je vais y revenir.
Les fille de feu de Jean-Sébastien Chauvin, oui celui du blog, sur un scénario de Sébastien Benedict, celui du blog aussi, est un intéressant cas d'espèce. Le film a été reçu de façon houleuse lors de la séance où je l'ai vu. J'ai trouvé ces réactions quelques peu malvenues alors que tant de films insignifiants reçoivent de polis applaudissements. Le film touche indéniablement mais il est vrai qu'il n'est pas facile. C'est une histoire d'amour entre filles, au sein d'un grand ensemble de banlieue, en bordure d'une forêt de conte de fée. Elles se cherchent et se perdent, là encore dans une atmosphère proche du fantastique, celui de Godard dans Alphaville plutôt. Il y a un très beau travail sur la photographie signée Simon Beaufils, un talent certain pour filmer les femmes et les éléments, le vent et l'eau, pour les cadrages aussi qui rappellent le travail photographique du réalisateur. Le film dégage une très grande sensibilité et prend de nombreux risques pour aller au bout de sa démarche. Du coup il se retrouve plusieurs fois en équilibre instable lors de scènes comme l'invocation poético-chamanique devant le feu ou le final qui font décrocher certains. Je ne peux pas dire que mes goûts me fassent adhérer complètement à cet objet étrange et entêtant, mais il a ses beautés.

Je vous hais petites filles
Assez proche dans l'esprit me semble être Je vous hais petites filles de Yann Gonzales (ah ! Ce titre !). Présence du fantastique, immersion dans un univers très personnel, héroïnes, atmosphère dépressive, musique du groupe M83 (groupe que l'on retrouve dans le film précédent), façon assez directe de filmer le sexe, les deux films partagent beaucoup de choses, y compris de poser les mêmes problèmes. Portrait de Kate, une musicienne plus si jeune, qui n'a pas fait le deuil de son amant mort dix ans plus tôt ni de l'époque punk, le film est fascinant, rageur et parfois irritant. S'il « sonne » parfaitement punk-rock tant dans son rythme que dans son style visuel, il est à l'opposé de Love You More, et à la vitalité du film de Sam Taylor-Wood se substitue une ambiance mortifère, décadente un peu, aussi désespérée que désespérante. Si je ne suis pas franchement fan des séances de masturbations brutales de la musicienne, il y a par ailleurs des scènes prenantes joliment construites comme ce concert lors duquel Kate voit le public se détourner d'elle et sa musique ne plus toucher. Ou encore cette soirée post punk, prétexte à une galerie de portraits hauts en couleurs, assez fellinienne, d'une faune branchée sans doute authentique. Kate Moran dans le rôle principal dégage une énergie bienvenue et irradie le film avec son bel accent, même si la dernière scène, là encore, est sur la corde raide. Mais c'est tout sauf un film tiède et c'est que l'on veut voir, bon sang, de l'audace ! Allez, un extrait pour se rendre compte.
23:04 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : court métrage, jérémie clampin, arnaud demuynck, sébastien betbeder, hélier cisterne, olivier babinet, jean-sébastien chauvin | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/02/2009
Clermont 2009 : Programme hollandais
Outre les différentes compétitions, Clermont-Ferrand, c'est aussi un ensemble de programmes thématiques venus des quatre coins du monde. Cette année, les Pays-Bas étaient mis à l'honneur avec des oeuvres marquantes de Bert Haanstra, Joris Ivens, Tjebbo Penning, Johan van der Keuken ou encore Loedwijk Crijns (l'incroyable Lap rouge). Le court métrage hollandais a une riche histoire que cette programmation permettait de découvrir, depuis les fondateurs de la Filmliga à la fin des années 20 jusqu'aux créateurs contemporains expérimentaux en passant par la génération des années 60, le courant des films de danse (Shake off de Hans Beenhakker découvert l'an dernier) et celui de l'animation aux réussites éclatantes.
Il fallait choisir entre les six programmes. J'ai choisi celui qui m'a permis de découvrir le quatrième court-métrage de Paul Verhoeven, oui le « hollandais violent », l'auteur de Robocop et de Showgirls. Feest ! (La fête !) date de 1963 et s'attache aux pas d'une jeune lycéen qui tente de séduire une jolie camarade à l'occasion de la fête de l'établissement. A la fois arrogant et timide, il essaye de s'affirmer et de contrôler un jeu sentimental et social. Mais il se laisse entraîner dans un rite innocent en apparence qui lui fait subir un échec humiliant. Feest ! Voit la naissance d'un style et, bien que ce soit facile rétrospectivement à écrire, on trouve dans le film les prémices du cinéma de Verhoeven, outre son indéniable maîtrise. La caméra est déjà très mobile et file à travers les couloirs du lycée de façon excitante (ce ne sont pas les travellings de Gus Van Sant) comme elle le fera plus tard dans coulisses de Las Vegas ou le camp des marines de l'espace. Le film parcourt l'établissement guindé dans ses multiples recoins, multipliant les lieux, salles, escaliers, cours, le transformant en un labyrinthe inquiétant que le héros semble maîtriser jusqu'à cette pièce au sommet d'une tour médiévale qui verra sa déconfiture. Le montage, très contrôlé, fait se succéder les personnages, donnant vitalité à ce petit monde et un rythme haletant tout en ménageant quelques pauses comme la séquence délicate dans la rue. Le noir et blanc de Ferenc Kalman Gall achève de donner au film un côté « nouvelle vague des débuts », le rattachant aux tout premiers essais de Truffaut ou Godard. J'ai pas mal pensé au second épisode des aventures d'Antoine Doinel.

Et puis Verhoeven a déjà ce regard très particulier sur ses contemporains. Il est tentant de rapprocher ce portrait d'une jeunesse hollandaise des années 60 à celui fait des militaires dans Starship troopers (1997) ou celui des jeunes danseuses de Showgirls (1995). C'est le même mélange d'ironie et de cruauté, cette même façon de montrer des jeunes gens déjà formatés, engagés dans la compétition sociale, désireux d'y jouer leur rôle mais piégés par leurs sentiments. A la fois ambitieux et humiliés, déjà abîmés. Un regard assez sarcastique, de moraliste misanthrope, attitude qui ne s'est pas arrangée avec les années et qui vaut au réalisateur de solides détestations comme de francs admirateurs.
Father and daughter (Père et fille - 2000) de Michael Dudok de Wit est un bijou d'animation de huit minutes. Il possède la puissance évocatrice de cet art porté à son point de perfection. Parfaitement. Michael Dudok de Wit n'a que quatre courts métrages à son actif mais une belle carrière depuis 1978 ayant notamment travaillé pour Disney et sur les remarquables films de Rémy Gired La prophétie des grenouilles et L'enfant au grelot. Il a en outre écrit et illustré plusieurs livres pour enfants et ses courts, pour être peu nombreux, ont marqué les esprits et récolté des prix un peu partout. Alors voilà, un père et sa petite fille font du vélo sur une digue plantée d'arbres. Ils s'arrêtent et le père fait ses adieux. Il monte dans une barque et s'éloigne à l'horizon. Longtemps, la petite fille reste là, puis elle repart. Elle revient au même endroit le jour suivant et scrute les flots. Elle revient encore, elle grandit, les saisons passent, les oiseaux chantent, les feuilles volent, la neige tombe. C'est une jeune fille avec son fiancé, une jeune femme avec son mari et ses enfants. Toujours elle revient et regarde au loin. C'est une vieille femme à présent. Il n'y a plus d'eau. Elle s'engage sur la vaste étendue. Au milieu des herbes, elle trouve la barque. Et puis, et puis, voilà. Father and daughter c'est de ce genre de films qui vous prennent là (voir fig. 1), ce genre de films qui rendent la plupart des autres insignifiants. Un de ces films qui savent toucher quelque chose de profond, d'essentiel. Quelque chose chose qui a à voir avec l'enfance, avec cette idée d'absolu qui est propre à l'enfance et qu'il est si difficile de préserver quand on grandit. Cette qualité rare et précieuse, le film la doit à sa simplicité, à la beauté de son graphisme sans une touche de trop. A base d'encre de chine et d'aquarelle, son dessin évoque la peinture chinoise, jeu sur les contrastes, précision du trait, épure. Les mouvements sont également très précis, fluides sans ostentation. Michael Dudok de Wit a le génie de la composition. J'ai parfois pensé à certains passages chez Hayao Miyazaki (Quand Chihiro prend le train au milieu de l'étendue d'eau par exemple). Ce qui est aussi remarquable, c'est l'intensité des émotions qui se dégagent sans que cela ne passe jamais par les visages, les personnages étant toujours vus d'assez loin pour que leurs traits ne se distinguent pas vraiment. Et puis la musique de Normand Roger, variation sur The danube waves à l'accordéon, un peu dans la manière de Yann Tiersen, est parfaite. Voilà, c'est ce genre de films, et rien qu'en évoquant les images, je me remets à tremper mon clavier de larmes alors, voyez le film et débrouillez vous avec.

A côté de ça, Het verborgen gezicht (Le visage caché - 2003) de Elbert van Strien et Het Rijexamen (Le permis de conduire - 2005) de Tallulah Schwab sont plus anecdotiques sans manquer de qualités. Le premier est une histoire à suspense dans l'esprit des contes de la crypte ou autres courts récits proches du fantastique. Une petite fille imaginative ne reconnaît plus sa grand-mère ce qui va se révéler dramatique quand cete dernière aura un accident. Raconté par la fillette en voix off, c'est un bel exercice de style. Le second est une comédie comme on dit bien troussée. La candidate au permis se retrouve avec un examinateur en pleine dispute téléphonique. Plutôt prévisible mais bien mené, le film enchaîne gags et cascades pour un plaisir premier degré mais bien réel.
Nummer Drie (Take step fall) est plus original. Réalisé par Guido van der Werve en 2004, le film mêle le film de danse et un humour de l'absurde assez réjouissant comme cet arbre qui tombe soudain au beau milieu d'une danse dans un parc, sans que rien ne l'ai annoncé ni que la danseuse en trésaille. Dans un tout autre registre, Grijsgedraaid (Matière grise – 2006) de Ina van Beek se présente comme un « documentaire hilarant sur une maison de retraite ». Il fallait que je me rende compte et, effectivement, c'est bien un documentaire sur une maison de retraite et on y rit beaucoup. La réalisatrice s'est fondue dans le quotidien des pensionnaires et en a retiré une succession de moments décalés, comme ces deux vieilles dames aux prises avec un ascenseur capricieux. On sent à tout moment que l'on pourrait basculer dans le drame, mais van Beek tient la ligne et ne tombe jamais dans l'apitoiement, meilleure façon de conserver à ces vieilles personnes toute leur touchante humanité.
Sur father and daughter :
Un entretien avec Michael Dudok de Wit par Gilles Ciment
Le film sur Youtube (qualité médiocre mais bon...)
Photographie Les films du préau
Un article sur Short of the week (en anglais)
Gallerie d'images
14:44 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clermont ferrand, court métrage, paul verhoeven, michael dudok de wit | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
11/02/2009
Clermont 2009 : sélection internationale
Dans la sélection internationale, Love you more est indubitablement de la première catégorie. J'y ajoute volontiers la première comédie islandaise que je vois de ma vie, Naglinn (Le clou) de Benedikt Erlingsson. Je pense que je suis sensible à l'humour islandais. Voici l'histoire d'un homme établi (on va dire ça comme ça, je ne peux pas tout révéler), fasciné par les peintres qui repeignent sa façade. A l'heure de la pause, le voilà qui monte sur l'échafaudage et s'empare d'un pinceau. Une chute plus tard, le voici avec un clou de quinze centimètres dans le front. Cet accident va avoir un effet étonnant sur son comportement. Disons que c'est un conte en forme de variation sur l'histoire de Jeckyll et Hyde avec peut être un arrière plan politique lié aux récents évènements sur l'île. C'est réalisé au petit poil, sans chichi, avec un grand sens du cadre et du rythme des burlesques.
Dans le même registre, Succès (Réussite) du hollandais Diedrick Ebbinge est un petit contre cruel sur l'entreprise moderne, proche de Tati sur la forme, multitude de petites touches précises qui sonnent juste, avec une bonne dose d'humour noir. L'histoire d'un homme qui doit faire une présentation de diagrammes devant ses collègues et le grand patron, et comment cet événement finalement dérisoire va devenir l'accomplissement de toute sa vie. Quiconque a vécu ce genre de réunion sera brillamment vengé par le rire.
Même si très peu l'avoueront, le film qu'il fallait voir, c'est le nouvel épisode des aventures de Wallace et Gromit, A matter of Loaf and Death (Un sacré pétrin) de Nick Park qui revient au format des origines, la petite demi heure. Et même si tout le monde, ou presque, trouve le film excellent, il est de bon ton de laisser poindre une petite pointe de déception. Effectivement, l'univers du grand dadais anglais et de son chien surdoué joue plus sur les retrouvailles de motifs déjà éprouvés que sur le renouvellement. Les deux compères sont ici devenus meuniers et doivent résoudre l'énigme d'une série de meurtres de boulangers. On retrouve les machines sophistiquées (le moulin et ses machines sont superbes), la musique de Julian Nott, le lever de Wallace et sa faculté de tomber amoureux, l'habileté de Gromit, les hommages au cinéma de genre fantastique et policer, les poursuites cartoonesques, le sens du détail et la perfection de l'animation. Après l'expérience du long métrage, il est réjouissant de constater que Nick Park n'a rien perdu de l'esprit de la série.

Voyage autour de ma chambre est le nouveau film d'Olivier Smolders, le cinéaste belge de Mort à Vignole (1998), un des courts métrages les plus importants de ces vingt dernières années. Ce nouvel opus poursuit une réflexion sur le cinéma, sa fragile puissance à saisir le monde et l'essence des êtres. Smolders mêle des images tournées au fil des années et de ses voyages. Il les ordonne en un journal intime et poétique pour les questionner et questionner sa place de cinéaste. Qu'est-ce que je montre ? Comment je le montre ? Quelle part de vérité puis-je capter ? Point de départ, une chambre (imaginaire ?) remplie de souvenirs, fétiches à invoquer pour commencer un « voyage immobile » et intérieur. Il exprime par exemple la difficulté à filmer l'Afrique autrement qu'en images volées depuis une voiture, en touriste filant sur la route. Une réflexion qu'il est intéressant de confronter à celle d'un Jérémie Lenoir (Foniké, Doto) dont l'un des grands mérites est son filmage de face. Smolders évoque ses réussites quand il filme des enfants sud-américains « comme si c'étaient les miens ». Sa façon de saisir la grâce de jeunes danseurs dans une mauvaise image vidéo. Il revient sur sa fascination des cadavres (les plans de flamands roses) et son désir d'aller au delà des apparences en plongeant littéralement dans les corps. A Florence, une séquence extraordinaire passe des clichés touristiques (Persée ayant tranché la tête de la Méduse) aux écorchés de cire du musée de La Specola. Visions fascinantes à donner la chair de poule.
Plutôt inclassable, Three of us (Nous trois), documentaire indien de Umesh Kulkarni est la chronique d'une modeste famille dont le fils est handicapé. Du sujet casse-gueule type, Kulkarni propose le récit sans pathos mais plein d'humanité d'une simple journée. Attentif aux gestes quotidiens, le film évite tous les pièges avec élégance et la photographie est très belle.
Les américains ont décidément le goût de la belle mécanique. On sent le professionnalisme dans The last page de Kevin Acevedo comme dans Short term 12 (Court séjour 12) de Destin Daniel Cretton. Le premier est une comédie autour d'un écrivain qui n'arrive pas terminer la dernière page de son livre. Le second le portrait d'un responsable de centre éducatif pour enfants « à problèmes ». Les deux films partagent les mêmes qualités : précision du scénario, mécanique dramatique, interprétation et travail efficace sur les seconds rôles, sens du rythme. Le premier est vraiment drôle, le second assez émouvant. Ils partagent aussi les mêmes défaut : un peu trop prévisibles, un peu trop sages, comme d'élégantes cartes de visite.
Dans la catégorie des films pas toujours réussis mais intéressants, il y a Vandalen (Vandales) du suisse Simon Steuri, une histoire d'amour entre deux graffeurs qui taggent les trains la nuit et dont l'intérêt est d'adopter une forme proche de l'univers décrit : musique électro, caméra très mobile, montage serré. Balladen om Marie Nord och hennes klienter (La ballade de Marie Nord et de ses clients) du suédois Alexander Onofri vaut pour la prestation de la belle Sofia Helin dans le rôle d'une assistante sociale énergique mais à la vie compliquée. Le film n'évide pas quelques clichés et rebondissements feuilletonesques, mais son ambition force le respect. Majken de Andréa Östlund est également suédois. Le film emprunte beaucoup, un peu trop, à Usual suspects de Brian Singer pour son histoire de vieilles dames indignes montant un réseau activiste contre la société de consommation. L'entreprise étant sympathique, on lui pardonnera une fin quelque peu outrée. Passage du belge Johann van Gerwen est une histoire d'amour et de livres au sein d'une immense bibliothèque. Très formel, l'esthétique un peu froide du film bouffe l'émotion que le sujet appelait mais on peut être fasciné par les élégants travellings.
Et puis, c'est terrible, mais j'ai vu le film qui a eu le grand prix de la compétition internationale, Every day, every day de Chui Mui Tan, un film malais, mais je n'en ai qu'un souvenir diffus, sympathique, mais je suis incapable de vous en dire un mot. C'est bien la peine... (à suivre)
22:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : court-métrage, diedrick ebbinge, benedikt erlingsson, nick park, olivier smolders, umesh kulkarni | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2009
Clermont 2009 : éditorial et introduction
En guise d'introduction à ce compte rendu clermontois de l'édition 2009, je vous invite à lire l'éditorial de Jean-Claude Saurel, Président de Sauve qui peut le court métrage, l'association organisatrice. J'ai lu (et même écrit pour les Rencontres) nombre d'éditoriaux, exercice incontournable du non moins incontournable catalogue. Celui-ci est assez direct et traduit bien l'ambiance actuelle, du moins coté français, une ambiance que l'on retrouvait par ailleurs sur le marché, morose et un peu tendu.
« Faites payer les pauvres, ils n’ont pas beaucoup d’argent mais ils sont nombreux »
Il semble que cet adage attribué à Joseph Caillaux (1863 – 1944) soit en train de s’installer progressivement dans de nombreux domaines. Exemple : prenez un système de protection sociale encore relativement efficace, fruit de nombreuses luttes s’inscrivant dans la durée, et non comme on l’entend souvent, résultat d’une quelconque providence étatique. Mettez ce système en crise en multipliant les exonérations pour des groupes qui auraient largement les moyens de payer, en organisant le glissement progressif de la répartition des créations de richesse, du travail vers la rente boursière, en développant le culte de la réussite individualiste et de la débrouillardise sans scrupules, du tout le monde contre tout le monde, bref d’une société où il vaut mieux être riche et bien portant que… vous connaissez la suite. Le problème, et il est de taille, c’est qu’au bout de quelques années, ça coince, et même ça coince sérieux. Il faut trouver de l’argent et donc, selon la formule du début de paragraphe, aller taper des proies faciles et isolées, en l’occurrence dans le cas qui nous intéresse : une association. Qu’en est-il ?
(la suite sur le site du festival)

L'un de mes objectifs cette année, tenu in-extremis, était de vérifier que Love you more de Sam Taylor-Wood, découvert à Cannes avec enthousiasme, tenait la seconde vision. Il la tient. La première étreinte de Georgia et Peter sur un air des Buzzcocks en juillet 1978 n'a rien perdu de son éclat. Andrea Riseborough est toujours aussi sensuelle et ses yeux bleu profond sont filmés avec un grain qui me fait défaillir. Drôle et rock, le film capte subtilement l'air d'une époque comme le bouleversement universel de la première fois. J'étais ravi de retrouver ce plan magnifique sur les poils du bras de Georgia qui se hérissent de désir ou les micro ellipses dans le montage qui donnent au film sa vivacité tout en collant à l'esprit de la musique. Et puis ces répliques qui ont pour moi quelque chose de hawksien : « Je croyais que je ne te plaisais pas / Tu ne me plais pas » ou « On a pas encore écouté la face B ». J'ai découvert que le film avait son propre site, avec un joli extrait.
Il m'est difficile de livrer des généralités puisque je suis loin d'avoir vu l'ensemble des programmes proposés, rien qu'en compétition, il y en a 31 (National, international et labo). Mais après un ou deux jours de projections, il a quelques tendances qui se dégagent et je peux diviser les films vus en quatre catégories :
Les films exceptionnels, ceux que l'on recommande à tous ceux que l'on croise et dont je suis sûr de me rappeler encore dans 10 ans. Rares par définition.
Les films propres sur eux. Je sais que ça sonne un peu péjoratif et que c'est un cliché pour parler du court-métrage français. Mais ces films sont assez nombreux. Il sont bien écrits, sans doute trop. La photographie est soignée. Ils sont bien joués, parfois par des pointures comme Jane Birkin dans Bunker de Manuel Schapira ou Serge Riaboukine dans La copie de Coralie de Nicolas Engel. Ils ont des sujets graves, traités avec un peu de gravité. Ils se regardent souvent avec plaisir mais ne surprennent que rarement. Leur résolution laisse un goût de trop peu. Trop peu de risque pris, trop peu de générosité, trop peu de folie, trop peu de foi en ce que peut le cinéma, comme disait l'autre.
« Ceux qui ont essayé » comme chantait Brel. Ce sont des films plutôt ratés, sinon ils passeraient dans la première catégorie, mais qui ont le mérite de tenter des choses et de revendiquer un partit-pris fort. Avec le recul ce sont des films que l'on a envie de défendre pour leurs qualités en laissant de côté ce qui est moins abouti. Ce sont des films qui marquent plus, qui intéressent plus que ceux de la catégorie précédente même s'ils sont parfois plus difficiles (littéralement) à voir. Des films pas forcément aimables mais qui donnent envie de suivre leurs auteurs.
Les films insignifiants, déjà oubliés, peu nombreux dans ce que j'ai vu cette année.
Je rentre dans le détail dès la note de demain. Je vais essayer de vous donner un maximum de noms et de titres. Les courts-métrages, souvent mal diffusés, ne sont pas toujours évidents à voir, mais si vous tombez sur l'un ou l'autre, allez-y voir, comme dit Breccio.
23:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : clermont ferrand, court métrage, sam taylor-wood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
09/02/2009
Mariage à l'italienne
Je ne me souvenais plus à quel point Sophia Loren était belle. Cette femme, c'est La Femme avec des majuscules partout. C'est un violoncelle, une amphore précieuse, une déesse romaine, une paysanne sublime et une grande dame, le regard qui enflamme et l'absolu de l'amour. Ce sont toutes les images de l'Italie et toute sa vérité, la joie de vivre et la malédiction de la vie, le drame tempéré par la bouffonnerie, le rire qui se coince parfois dans la gorge en un sanglot. Sophia Loren, c'est l'actrice flamboyante, les mains qui virevoltent, le corps qui irradie la scène et crève l'écran, cent visages pour un personnage.

Photographie : Capture DVD Carlotta
Marcello Mastroianni c'est à la fois un idéal masculin et sa caricature. Il est beau, il est racé, il est élégant, il réussi dans les affaires, il séduit avec juste ce qu'il faut de désinvolture. Dans le même temps, dans sa façon d'avancer la lèvre inférieure, dans des gestes qui deviennent maladroit, dans telle expression du regard, il fait passer tour à tour la naïveté, la bêtise, l'arrogance, la fragilité, l'impuissance ou la lâcheté. De l'incarnation du « latin lover », Marcello Mastroianni s'est amusé à révéler les failles et, ce faisant, le rend à sa condition humaine et en dégage une émotion troublante.
Quelques liens :
Le DVD
Chez Dasola
Sur le Ciné-Club de Caen
Sur Critikat
Sur Culturopoing
23:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vittorio de sica | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2009
Images de la Loren






19:36 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sophia loren, vittorio de sica | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2009
De retour
Le temps passe toujours très vite en bonne compagnie. Le festival de Clermont Ferrand n'est pas encore achevé, mais je suis déjà rentré. Le temps de me remettre les esprits en ordre après cinq journées intensément cinématographiques et autant de nuits trop courtes puis je vous raconte tout. En attendant, deux, trois photographies. Il faisait bon, il y a eu de la neige (j'adore), j'ai vu 71 films, je me suis payé un bouquin sur Spielberg et les mémoires de Louise Brooks, j'ai eu de longues conversations avec des gens très agréables, j'ai mangé à n'importe quelle heure, j'ai bu pas mal mais sans excès, bref, c'était un bon festival.
22:56 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clermont ferrand, court métrage | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/02/2009
Ça donne soif

00:39 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ishirō honda, haruo nakajima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/02/2009
De la censure en Amérique
Mon ami Luc, de l'Illustre Théâtre, m'a demandé de plancher sur la censure. Et il faut toujours renvoyer la censure (pouf, pouf).
Comme l'écrit Ado Kyrou, « le visage du cinéma est amour » et l'amour porte en lui une terrible charge de subversion. Dès les origines, le cinéma a été mal vu par nombre d'autorités dites morales. La puissance expressive des images en mouvement fait peur. En 1896 déjà, The kiss (Le baiser) de William Heise avec May Irwin et John C. Rice fait crier à la pornographie. Aux Etats Unis, terre de contrastes s'il en est, Hollywood sera vite considérée comme une moderne Babylone. Le cinéma attire l'argent à flots. Les acteurs deviennent des stars et jouissent d'une popularité inégalée, de revenus de plus en plus fastueux. Metteurs en scène et producteurs rivalisent de spectacles grandioses destinés à séduire un public toujours plus nombreux.
Des visions de plus en plus hardies prennent corps, comme celles des films d'Erich Von Stroheim qui montre un personnage de Greed (Les rapaces – 1924) joué par Zasu Pitts coucher avec son or de façon fort peu équivoque.
C'est dans ce contexte que les studios, pour répondre aux attaques en moralité à l'issue de plusieurs scandales de moeurs, décident au début des années 20 de s'auto-censurer. Ils font appel à William H. Hays, avocat et directeur de campagne du président républicain Warren G. Harding, pour diriger la Motion Pictures Producers and Distributors Association (qui devient en 1945 la Motion Picture Association of America ou MPAA.). L'association crée les bases de d'un code qui passera à la postérité sous le nom de code Hays et qui explique ce que l'on ne doit pas monter à l'écran. Et une fois le parlant arrivé, ce que l'on ne doit pas dire. La liste est longue.
Dans un premier temps, cette auto-censure n'empêche pas certains créateurs de poursuivre leurs idées. En mars 1930, le code devient officiel et les pressions plus fortes. Les réalisateurs et producteurs, pour peu que les seconds soutiennent les premiers, doivent batailler dur, à l'image de Howard Hawks pour son Scarface, qui devra, par exemple et entre autres, tourner trois fins différentes pour apaiser des censeurs visiblement au bord de l'apoplexie.
En juin 1934, un amendement oblige désormais chaque film à obtenir un certificat de l'association pour pouvoir sortir sur les écrans. On voit encore ce certificat sur nombre de copies de la période. Ancien journaliste et cul-béni, Joseph Igniatius Breen est chargé de faire respecter les règles et il sera particulièrement zélé dans son rôle faisant couper des scènes, en faisant retourner d'autres. L'histoire du code sera jalonnée de combats entre le Breen Office et les réalisateurs et producteurs, jusqu'à l'abandon du code en 1966. Pour donner une idée de la rigidité du code, il était impossible de monter un homme et une femme dans une chambre à coucher s'ils n'étaient pas mariés. Et la MGM dû payer une amende pour la fameuse ultime réplique de Rhett Butler – Clark Gable dans Gone with the wind (Autant en emporte le vent – 1939) : « Frankly my dear, i dont give a damn ».
Pour se consoler, on peut se dire que ces contraintes stimulèrent l'imagination des metteurs en scène comme leur combativité. Avec le recul, certaines scènes se révèlent d'un érotisme délicieux, d'autant plus subtil qu'il devait passer à travers les mailles de la censure comme le baiser de Cary Grant à Ingrid Bergman dans Notorious (Les enchaînés – 1946) de Hitchcock ou l'étreinte sous la pluie de John Wayne et Maureen O'Hara dans The quiet man (L'homme tranquille – 1952) de John Ford. Reste que ce système aura fait beaucoup de mal au cinéma américain, le maintenant dans une vision aseptisée de la vie qui trop souvent fait apparaître les films de cette période comme désuets.
Il est donc étonnant, et assez stimulant de découvrir ou redécouvrir les films de la période « pré-code », avant 1934. On s'aperçoit que Hollywood pouvait alors faire preuve d'audace, de poésie, d'érotisme vrai et d'humour noir. On retrouve ainsi des plans censurés comme ceux de King Kong (version 1933) où Kong croque et écrase indigènes et new-yorkais. Comme cette superbe baignade de Tarzan et Jane dans Tarzan and his mate (Tarzan et sa compagne – 1934) où Tarzan arrachant la robe de la belle, celle-ci évolue dans les eaux dans le plus simple appareil. On retrouve enfin les visions d'orgies de Von Stroheim de Queen Kelly (1929) ou Foolish Wives (Folies de femmes – 1921). On revoit avec émotion le Freaks (1932) de Tod Browning. Plus inattendu est la découverte de l'imaginaire d'un réalisateur connoté « familial » comme Cecil B. DeMille. Ses fresques épiques Sign of the cross ( Le signe de la croix – 1932) ou Cléopâtre (1934) sont traversées de visions mêlant érotisme et sadisme des plus hardies. Il faut voir la grande séquence des jeux du cirque dans le premier film, nous ne sommes pas si loin du Caligula de Tinto Brass.

Au-delà de ces films très connus et qui, même dans leurs versions censurées sont devenus des classiques, il y a tout un tas de productions oubliées qui valent la peine d'être découvertes. Ainsi Baby face (Liliane, tourné par Alfred E. Green en 1933 est étonnamment moderne. On pourrait presque le comparer à Choses secrètes de Jean-Claude Brisseau. Lilianne, jouée avec charme et force par Barbara Stanwyck, est exploitée par son père dans un bar clandestin minable. Quand il cherche à la vendre à un client, ils ont une violente dispute qui se conclut par la mort du père qui se fait sauter avec son alambic. Liliane a une amie, noire et jolie, à laquelle elle semble très attachée. Elle fréquente aussi un vieil intellectuel décati qui lui fait lire Nietzsche et l'incite à partir, à se forger une carapace et à gravir les échelons de la société en utilisant ses charmes. Crânement, Liliane va se faire embaucher dans une grande société et passer d'homme en homme pour monter de poste en poste jusqu'au sommet. Sur un air de jazz, la caméra suit son ascension en gravissant les étages de l'immeuble de la société. Et Liliane avance, cynique, dure, impitoyable. Déterminée. La modernité du film tient à cette interprétation, ainsi qu'à la description sans fard de la société de l'époque, du milieu ouvrier sordide aux intrigues des cadres arrivistes. Green est plutôt direct en matière de sexe et de violence sociale. Le personnage de l'amie, jouée par Theresa Harris est également assez loin des clichés en vigueur façon Hattie McDaniel et leur relation est délicieusement ambiguë. A noter pour l'anecdote que l'une des multiples conquêtes de Baby Face est jouée par le débutant John Wayne, sous chef de bureau niais qui ne servira que de marche-pied.
Les films pré-code ont été remis au goût du jour suite à un documentaire produit par la Warner (rien ne se perd) et une programmation sur TCM. Plusieurs oeuvres ont également été éditées en DVD, autant de raisons de se plonger dans cette époque pleine de surprises et mesurer, une fois de plus, combien la censure peut être bête.
Photographie : Movie Morlock
Un article très détaillé sur Cinéma Classsic
12:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : code hays, alfred e. green, censure | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |





























