15/08/2006
Pièce à convictions
Charles Tesson. Petit dictionnaire des idées reçues de la critique (Panic N°4)
Dans le numéro de mai de Positif, Paul Louis Thirard revient sur le fameux texte de Jacques Rivette à propos du non moins fameux travelling de Kapo, le film de Gillo Pontecorvo. A l'origine, une formule de Luc Moullet reprise et inversée par Jean Luc Godard (Le travelling est affaire de morale) puis illustrée par l'exemple par Jacques Rivette dans un article intitulé De l'abjection paru dans les Cahiers du Cinéma 120 (juin 1961). Plus tard Serge Daney dans le travelling de Kapo paru dans Trafic 4 (1992), fait du texte de Rivette un élément fondateur de sa cinéphilie. Ces textes, comme s'en amuse Tesson, sont toujours emblématiques d'une certaine idée de la mise en scène et occupent une place de premier ordre dans l'histoire de la critique de cinéma.
Rivette : Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés : l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’à mon plus profond mépris.(De larges extraits ICI)
Daney : Abrupt et lumineux, le texte de Rivette me permettait de mettre des mots sur ce visage-là de l’abjection. Ma révolte avait trouvé des mots pour se dire. Mais il y avait plus. Il y avait que la révolte s’accompagnait d’un sentiment moins clair et sans doute moins pur : la reconnaissance soulagée d’acquérir ma première certitude de futur critique. Au fil des années, en effet, « le travelling de Kapo » fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du « travelling de Kapo », je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager.(Le texte complet en pdf ICI)
Pontecorvo :
Daney avoue n'avoir pas vu le film et plus exactement estime qu'il lui suffit de l'avoir vu à travers les mots de Rivette. Bien que connaissant ce texte, j'ai toujours eu envie de le voir, Kapo, parce que j'aime me rendre compte par moi-même, que je m'exprime sur ce que je vois et que le sujet, moral, éthique, historique, artistique, cinématographique, me touche. Évidemment, après en avoir autant lu, j'aurais du me douter qu'il ne me serait pas possible de voir ce passage « normalement ». Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Daney s'il s'était décidé, mais je ne retrouve pas dans les images de Pontercorvo celles que me suggéraient les mots et la colère de Rivette. Le travelling est peu appuyé, tout comme la contre-plongée et je ne vois pas d'effet particulier sur la main. C'est ce que relève aussi Thirard à partir du livre d'entretien d'Irène Bignardi Mémorie estorte a uno smemorato : Vita di Gillo Pontecorvo. On peut aussi se dire que les figures cinématographiques ayant évolué depuis 1960, on ne peut voir ce travelling de la même façon qu'à l'époque.
Bien sûr, ce qui a cristallisé l'attaque de Rivette sur ce plan, c'est la dramatisation d'ensemble du film. Kapo est le premier film occidental (les polonais ont sortit en 1948 l'étonnant La dernière étape de Wanda Jakubowska, rescapée du camp d'Auschwitz, et tourné sur place dès 1947 avec d'autres survivantes) à aborder de front les camps nazis à travers une fiction. C'est l'histoire d'Édith, une jeune pianiste juive française (jouée par Susan Strasberg) qui est déportée avec ses parents à Auschwitz. Elle échappe à la mort en cachant son identité juive sous celle de Nicole, une « droit commun » française qui vient de décéder. Envoyée en camp de travail, avec le soutien de Térèse (Emmanuelle Riva), une résistante, elle remonte la pente et décide de tout faire pour survivre. Elle accepte de se prostituer avec les SS et devient Kapo, c'est à dire gardienne de ses co-détenues, dure et insensible. La rencontre avec un prisonnier russe (Laurent Terzieff) et l'exemple de Térèse l'amèneront à se sacrifier lors de la révolte du camp.
Le film s'appuie sur des ressorts dramatiques classiques voire quelque peu mélodramatiques lors de la dernière partie. Mais au-delà de l'anecdote, ce qui intéresse Pontecorvo, c'est d'abord le processus de déshumanisation qui fonde l'univers concentrationnaire et cette partie me semble bien traitée. Dans le contexte du film, le travelling arrive à un moment dramatiquement fort, celui du suicide de Térèse. Celle-ci incarne l'esprit de résistance durant toute la première partie et son parcours suit une courbe inverse de celui d'Édith-Nicole. Son renoncement du fait des privations et de l'épuisement est caractéristique de la façon dont le système brisait les âmes les plus fortes. Son suicide, même s'il peut être interprété comme un ultime sursaut de dignité, est un moment de profond désespoir. A quoi donc peut bien penser Pontecorvo lorsqu'il décide de filmer ainsi Emmanuelle Riva ? A faire un joli mouvement de style ? N'est-il préoccupé que d'esthétisme ? Je trouve l'explication un peu courte. Pontecorvo a été résistant, partisan communiste et il est juif. C'est un homme engagé qui s'exprime sur des questions qui lui sont proches et sensibles. Il est à un moment clef de son film. Il a choisi une actrice qui dégage physiquement l'idée de force morale. Le personnage de Térèse est une part de lui-même, un hommage sans doute aussi à ses camarades de combat. Je vois dans ce corps d'Emmanuelle Riva prise entre ces barbelés et ce ciel lourd l'expression de ses plus grandes terreurs. Non pas des terreurs abstraites d'artiste mais de celles qu'il avait pu, résistant clandestin, ressentir dans sa chair. La terreur d'être brisé moralement par le système qu'il combattait. Rivette n'a pas choisi ce plan au hasard ; il résume bien l'un des enjeux majeur du film mais nous n'y voyons pas la même chose.
On ne s'interroge que très rarement sur les images mentales d'un lecteur. Au cinéma, les images semblent être uniques, là devant nos yeux, et j'ai longtemps cru qu'elles ne pouvaient qu'être lues d'une seule façon. Mais à chaque discussion polémique, je me rends compte à quel point c'est faux. Rien n'est plus retors que l'image avec son hors champ, sa signification propre et celle qu'elle acquiert entre deux autres. On la lit avec son bagage, ses « dogmes portatifs », sa sensibilité, son sens moral, son expérience, son aveuglement amoureux, ses partis pris définitifs, ses convictions.
Plusieurs choses me gênent dans les textes de Rivette et de Daney. La première, c'est le vocabulaire : « abjection », « plus profond mépris », « point limite », « rien », « définitivement ». Au-delà de la violence des mots, une violence que je trouve toujours un peu artificielle pour parler de cinéma et d'art en général, il y a une volonté de fermeture, un énoncé catégorique qui clôt par avance toute discussion, l'expression d'un dogme, portatif ou non, que rien ne saurait remettre en question. Or l'Art (pour s'en tenir à ce sujet) a toujours progressé par la remise en cause des dogmes et une constante recherche sur les modes de représentation. Est-ce à dire pour autant que tous les modes de représentation se valent ? Bien sûr que non. Certains se fourvoient, certains s'égarent, d'autres mènent dans des impasses. Mais chaque direction prise ouvre des voies pour ceux qui suivent, en confirmation ou en réaction. En ce sens, Kapo a eu son importance comme l'ont eu à leur moment Nuit et Brouillard, la série Holocauste, Shoah ou La liste de Schindler. Pour approcher la synthèse chère à Rivette, j'ai besoin de ces différentes expressions : Pontecorvo et Resnais, Benigni et Munk, Lanzmann et Spielberg, Chaplin et Jakubowska, Cavani et Lubitch. Et comme l'écrit Thirard, la grille de lecture pour ces différentes expressions n'est pas la même, dépendant du temps, du lieu et des préoccupations intimes de chacun.
La seconde chose, c'est cette notion de mépris. Il y a là un glissement pour moi insupportable de l'oeuvre à l'homme. Pontecorvo n'a certainement pas le profil abject. Il n'est ni Céline, ni Riefenstahl, ni même Autant-Lara. En 1965 il réalise un film qui fera date sur la guerre d'Algérie : La bataille d'Alger. En 68, ce sera Queimada, parabole sur le colonialisme avec Marlon Brando et en 1980, Ogro sur le franquisme avec Gian Maria Volonte. Pontecorvo est un homme en prise avec quelques unes des grandes questions de son temps, comme le sont ses acteurs, Emmanuelle Riva, égérie de Resnais la même année pour Hiroshima mon amour, Susan Strasberg et Laurent Terzieff, comme l'est aussi son scénariste Franco Solinas, l'un des plus remarquables auteurs italiens à qui l'on doit, outre ses collaborations avec Pontecorvo, les scénarios de Quien sabe de Damiano Damiani, Le Mercenaire de Sergio Corbucci, Tepepa de Giulio Petroni et Colorado de Sergio Sollima, autant de westerns aux implications politiques, paraboles tiers-mondistes (on pourrait dire aujourd'hui alter-mondialistes) alliant cinéma populaire et réflexion engagée. Solinas qui écrira aussi Salvatore Giuliano pour Francesco Rosi, État de siège pour Costa Gavras et Monsieur Klein pour Joseph Losey. Si l'on parle d'abjection et de mépris ici, quels mots utiliser pour, disons La grande vadrouille ou La grande évasion et leurs visions ludiques, films inoffensifs d'apparence mais qui ont conditionné à grande échelle une image de l'occupation ou des camps allemands ?
Ce que je peux comprendre, c'est que l'on ait du mal à s'imaginer réunir une équipe, installer caméra et projecteurs, faire reconstruire barbelés et miradors et demander à des figurants et des acteurs de « jouer » une scène de camp. J'ai plus de mal à admettre que l'on préjuge de la légèreté, de l'absence de « crainte et tremblement » de la part de ceux qui trouvent le courage de le faire. J'ai toujours retenu un entretien avec Jean-Luc Godard paru dans un spécial Cannes du Matin en 1980. A une question sur ses projets, il évoquait un film sur les camps et disait y renoncer parce qu'il lui faudrait des figurants de 40 kg. C'est une manière d'aveu, Godard ne s'imaginait pas aux prises avec ces problèmes concrets de mise en scène, je dirais de façon physique. Attitude honnête et respectable et qui le serait d'autant plus s'il ne regrettait pas dans les Histoire(s) du cinéma que le septième art n'ait pas filmé les camps tout en se souvenant, ailleurs dans un entretien à l'Humanité, que Chaplin l'avait fait dès 1940 (comme Borzage). De même si Rivette critique peut s'opposer au cinéma tel que le conçoit Pontecorvo et le clouer sur ses rails de travelling, je regrette que Rivette cinéaste (admirable par ailleurs) ne se soit pas risqué à aborder le sujet, pas plus que les cinéastes de sa génération, Resnais mis à part. Je note aussi la remarquable discrétion qui a prévalu à l'époque sur la guerre d'Algérie, René Vautier étant l'exception remarquable. On rapprochera cette notation du regret de Daney dans Persévérance que ce conflit n'ait pas été filmé et du fait que c'est Pontecorvo qui acceptera d'aller faire La Bataille d'Alger, film qui sera interdit en France jusqu'en 1971. Tout m'apparaît comme si le débat paralysait la création, comme si l'on manquait de foi dans le cinéma, comme si l'on préférait s'opposer par un texte plutôt que par un film. Quand Sam Peckinpah veut faire éclater sa colère contre une certaine représentation de la violence au cinéma, il fait La Horde sauvage. Il obtient d'ailleurs un résultat ambigu. C'est le risque. La force du cinéma italien de ces années 55-75, des Rosi, Pasolini, Pontecorvo, Sollima, Monicelli... c'est bien de se coltiner avec la réalité sur tous les fronts et avec leur art de cinéastes. Et cette attitude serait méprisable ? Non, vraiment non.
Une petite chose qui m'irrite aussi, c'est le « de gauche » de Daney dans « l'Italien de gauche Gillo Pontecorvo », qualificatif qui sonne comme un discrédit, reproche habituel fait à des cinéastes comme Guédiguian, Loach, Costa Gavras, Carpita... l'absence de représentation de «l'autre » et autres fadaises sur lesquelles je n'ai pas envie de m'étendre pour cette fois.
La morale pour finir. Rivette et Daney se placent sur son terrain pour mieux enfoncer Kapo dans son abjection. Ils opposent ainsi Nuit et brouillard d'Alain Resnais qui serait un film juste à Kapo qui ne le serait pas. Il est toujours risqué de distribuer ainsi bons et mauvais points car le temps et l'Histoire peuvent amener à nuancer des positions trop rigides. Enfant, j'ai, comme beaucoup d'autres je suppose, appris ce qu'avaient été les camps par le film de Resnais. C'est un film qui m'a profondément marqué et qui continue à le faire parce que, comme l'écrit Rivette, on ne s'habitue pas aux images de Nuit et brouillard(ce qui ne veut pas dire que l'on s'habitue forcément aux autres). Le film a effectivement une juste distance par rapport à son sujet, mais depuis Le chagrin et la pitié et Shoah, il faut admettre que sa représentation n'est pas complètement juste dans la mesure où le film aborde le camp de concentration « classique » et non l'extermination (la spécificité du génocide juif est quasiment absente). En raccourci Resnais parle de Buchenwald et non de Treblinka. D'autre part, à l'exception du plan (censuré) du gendarme français, le film n'évoque pas la part de la collaboration. Le film, faut-il le rappeler, était une commande d'organisations de résistants et déportés fait à une époque ou l'image d'une France résistante était le modèle incontesté. Kapo est plus explicite sur le premier sujet, montrant rafle et déportation de juifs en tant que juifs et faisant de la négation de son identité juive la condition de la survie de son héroïne. Si le film perd un peu en route cet axe, l'affirmation finale de son identité retrouvée par la jeune femme est un moment fort. Le film de Pontecorvo en est-il pour autant juste ? Difficile à dire. Vu aujourd'hui, je le trouve mal construit, pris entre une première partie assez forte, le passage à Auschwitz, la découverte du camp de travail; et une seconde partie dominée par l'intrigue mélodramatique qui passe mal. Trop envahissante et datée, elle prend le pas sur les thématiques amorcées dans la première partie : le phénomène de déshumanisation et l'enjeu de l'identité. Pontecorvo et Solinas n'arrivent pas à se détacher d'une narration classique accrochée à la béquille inutile de l'intrigue. Enfin, la musique de Carlo Rustichelli est trop appuyée et étouffe la justesse des images. Si je devais reprocher quelque chose au travelling, c'est la musique qui le précède. Le film ne manque donc pas de défauts ni d'angles d'attaque, mais celui de la morale me semble injuste. Je veux bien que les travellings soient affaire de morale, mais ils restent indissociables de ce qui est exprimé à travers eux et ce que Pontecorvo a essayé de faire passer à l'époque me semble digne d'intérêt sinon d'estime.
Pistes
Un débat de haute tenue autour du dessinateur Yslaire à partir de Rivette.
Un entretien avec Gaspard Noé.
« Les ficelles de Pontecorvo » par Jacques Mandelbaum dans Le Monde
Réflexions chez J(...)-S(...)
Séminaire Shoah et cinéma
L'abjection chez Turner
Le DVD chez Carlotta films
15:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : gillo pontecorvo, critique, polémique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/08/2006
Jean Arthur

Source : Dr Macro
06:35 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actrice, jean arthur | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/08/2006
Ecoutez le cinéma !
ARTE radio a le bon goût de mettre à disposition certains enregistrements sous licences Créative Commons. Maîtrisant désormais la délicate technique du podcast, je vous propose d'écouter cette émission réalisée par Thomas Guillaud-Bataille autour de Stéphane Lerouge qui restaure et édite des bandes originales de film. Stéphane Lerouge a conçu la collection Écoutez le cinéma ! chez Universal Jazz France. Dans cet enregistrement, on l'entend travailler sur la musique du film de René Clément, Plein Soleil, signée Nino Rota. Puis, avec moins de bonheur car les bandes sont abîmées et qu'il se heurte à des problèmes techniques, sur les bandes d'Eric De Marsan, compositeur de L'armée des ombres de Jean Pierre Melville. Un document passionnant pour tout amateur de musique de film.
Enregistrement : 21 – 30 juillet 2005
Réalisation : Thomas Guillaud-Bataille
Mix : Christophe Rault
En prime, un entretien réalisé avec Stéphane Lerouge sur le site Traxzone.
La collection Écoutez le cinéma !
04:15 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, musique, bande originale, ARTE radio | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
31/07/2006
Le charme exotique des affiches nippones de western italien - Partie 2



03:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, western, affiches | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/07/2006
Comment j'ai manqué les années 70.
L'autre salle, c'était l'Athéna. J'ai le souvenir d'un cinéma très beau, très propre, très clair. Une salle plutôt style Art et essai avec un côté temple, des fresques sur les murs, une atmosphère feutrée. Peut être que ma mémoire enjolive. La programmation y était en tout cas très différente de celle du Daumesnil et c'est d'ailleurs là que mes parents qui ont toujours beaucoup aimé le cinéma, aimaient aller. J'y allais moins souvent parce que les films y étaient plus « adultes » et parce que ceux qui me donnaient envie étaient souvent interdits au moins de 13 ou 18 ans. Je me souviens pourtant d'avoir vu les bandes annonces de Orange mécanique, Barry Lyndon, Obsession, Crias Cuervos, Carrie... qui me fascinaient tout autant qu'elles m'effrayaient. Des images plus fortes que celles des films qu'elles précédaient.
J'ai repensé à tout cela en lisant le dossier de Positif sur les années 70 du cinéma américain. En 1977, nous sommes partis nous installer à Nice et il y a eu une année de flottement avant que nous ne nous installions tout près d'un cinéma légendaire à Nice : le Mercury, place Garibaldi. 7 salles à l'époque, toutes art et essais. C'est là que ma cinéphilie a pu s'affirmer petit à petit et que j'ai pu embrayer avec succès sur les années 80. Entre temps, ce seront la télévision et la cinémathèque niçoise qui m'auront permis de rattraper mon retard sur les années 70. Mais aujourd'hui, quand j'évoque les nombreux noms et titres de ce cinéma américain qui m'est si familier, je me rends compte que je n'ai pas découvert un seul de ces films au moment de sa sortie.
Ca ne m'a pas empêché de m'amuser au jeu de la liste telle que l'a pratiquée l'équipe de Positif et, respectant leur « cahier des charges », voici mes vingt (pas pu faire moins) films préférés, USA, 1970-1979 :
MASH Robert Altman
French Connection William Friedkin
Deliverance John Boorman
Jeremiah Johnson Sidney Pollack
Pat Garrett et Billy the kid de Sam Peckinpah
L'exorciste de William Friedkin
Phantom of the Paradise Brian de Palma
The Rocky horror and picture show Jim Sharman
Zombie de Georges Romero
Taxi Diver Martin Scorcese
Assaut de John Carpenter
Annie Hall de Woody Allen
Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino
Que le spectacle commence de Bob Fosse
Rencontres du troisième type de Steven Spielberg
Apocalypse now de Francis Ford Coppola
Star Wars de Georges Lucas
Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper
Frankenstein Junior de Mel Brooks
1941 de Steven Spielberg
17:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/07/2006
Le charme exotique des affiches nippones de western italien - Partie 1



03:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, western, affiches | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/07/2006
Lectures estivales
J'aime bien lire Manière de voir, la revue du Monde Diplomatique. Je ne suis pas toujours d'accord, je m'énerve parfois de leur dogmatisme, mais leurs points de vue changent agréablement de ce que je lis d'ordinaire sur le cinéma. Le numéro 88 est consacré aux cinémas engagés et c'est Land and freedom de Ken Loach qui fait la couverture. Tout un programme. En l'occurrence un tour du monde assez complet et fort intéressant des cinémas politiques. J'ai appris un tas de choses autour du tournage du Cuirassé Potemkine. Je vous en recommande chaudement la lecture et ce n'est pas qu'une façon d'écrire.
Les Cahiers du cinéma mélangent les torchons (Shyamalan) et les serviettes (Eastwood, Mann) pour un dossier sur le Hollywood des années 2000. L'article de Jim Hoberman sur Steven Spielberg est une compilation des clichés critiques qui m'énervent sur le sujet. Déjà, c'était mal partit et la suite n'a rien arrangé. L'ensemble voudrait nous faire croire que le système Hollywoodien a encore quelque chose de génial ce qui me laisse largement dubitatif.
Tout autre est le magnifique dossier que le numéro estival de Positif consacre à l'Hollywood des années 70. Un ensemble critique riche, cohérent et érudit fait revivre un moment cette époque véritablement créative du cinéma américain. Coppola, Scorcese, Friedkin, Penn, Pollack, Spielberg, Rafleson, Hellman, Allen, Altman, Peckinpah... les noms s'enchaînent et rendent plus tristes par contraste nos pauvres années 2000. Enfin celles de Hollywood en fait car aujourd'hui la richesse, l'originalité, la créativité au cinéma existent toujours et elles sont en Asie. Système oblige, elles sont plus difficile d'accès pour nous, spectateurs, mais n'en sont pas moins réelles. Je rêve parfois à ce qu'une union des talents d'alors qui eurent un instant le pouvoir, aurait pu donner pour les décennies à venir. Mais c'était sans doute impossible. William Friedkin résume leur échec symbolique. Avec Peter Bogdanovich, ils eurent le scénario de Star Wars entre les mains : « J'ai lu le scénario et n'y ai rien compris ; ça me paraissait idiot . Bogdanovich n'a rien pigé non plus [..] Voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans une chambre minable au Ritz, alors que Lucas vit dans un palais plus grand que Versailles ! ». Le film marqua un tournant radical « C'est comme si j'avais été marchand de chevaux et que le type en face venait d'inventer la Ford T ». A lire à l'ombre, longuement.
23:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : revue, William Friedkin | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/07/2006
Ne pas s'encombrer
Geoff Carter: Got a match?
Bonnie Lee: Say, don’t you ever have any?
Geoff: No, don’t believe in laying in a supply of anything.Bonnie: Matches, marbles, money or women, huh?
Geoff: That's right.
Bonnie: No looking ahead, no tomorrows, just today.
Geoff: That's right.
Jules Furthman – Howard Hawks
Only angels have wings (Seuls les anges ont des ailes – 1939)
Source image : Gonemovies
18:30 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Howard Hawks | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/07/2006
Peckinpah, Hawks et Léone
Howard Hawks n'aimait pas trop le cinéma de Sam Peckinpah. Interrogé sur La horde sauvage par Jim McBride, il lui répond (de mémoire) : « j'ai le temps de tuer trois types, de les emmener au cimetière et de les enterrer avant qu'un seul des siens ait fini de tomber au ralentit. ». Pourtant, à revoir le film une nouvelle fois, le fameux « sentiment de perte » que l'on ressent à la fin du film a beaucoup à voir avec le cinéma tel que le concevait Hawks. Si l'on s'attache à ce point aux personnages bien qu'ils nous aient été montrés dans toute la crudité de leur violence, c'est que l'on a appris à vivre avec eux pendant deux heures. Appris à connaître ces professionnels liés par une activité aventureuse dans laquelle ils excellent, ces hommes qui forment un groupe, tendu certes, mais uni par une même éthique, cette même éthique qui leur permet de se comprendre sans se parler avant d'entamer leur marche finale vers la mort. Une éthique de la vie commune, du groupe, qui prend toute sa dimension dans les deux très beaux moments de détente : après le hold-up manqué et lors de la séquence de la bouteille après le vol réussi des armes. Un art de vivre ensemble qui culmine lors de la séquence clef du village mexicain, séquence élégiaque qui rend poignante le passage de leur départ, séquence qui fut largement improvisée sur le tournage, et qui est symboliquement reprise lors du générique de fin. Sur tous ces aspects, les hommes de la horde sont proches du groupe de pilotes de Geoff Carter dans Seuls les anges ont des ailes, de la bande du shérif Chance dans Rio Bravo où des traqueurs d'animaux d'Hatari. Si à l'évidence Peckinpah était fasciné par l'esprit fordien, ses groupes les plus réussis (Major Dundee, La Horde sauvage, Croix de fer) ont une dynamique toute hawksienne. Ce qui devait laisser perplexe le « renard argenté » car ce que Hawks ne pouvait accepter, c'est la dimension qui fait l'ambiguïté du film et sa réussite, c'est le fait que cette éthique soit portée par des bandits, des tueurs. Les personnages de Hawks sont des personnages positifs et lorsqu'il décrit un groupe de bandits comme dans Scarface, il n'y a aucune fascination envers eux. Et quand Tony Montana meurt, pas de sentiment de perte, rien qu'un regard glacé sur son cadavre.
Sergio Léone semble n'avoir pas trop aimé non plus le cinéma de Sam Peckinpah. Il élude les questions à ce sujet. On pourra penser qu'il le voyait à l'époque comme un rival ou, compte tenu de son fort ego, comme quelqu'un qui cherchait à importer, à ramener en Amérique, le style qu'il avait créé. Plus profondément, lui qui venait de sortir Il était une fois dans l'Ouest quelques mois auparavant, devait sentir que Peckinpah avait réussi quelque chose qui lui échappait et qu'il n'atteindrait que dans son film suivant, Il était une fois la révolution, atteindre une véritable profondeur humaine. Léone, comme Peckinpah, admirait les films de John Ford et son esprit tout en en sentant les contradictions. Leurs oeuvres respectives sont des méditations sur ce cinéma et sa morale : la naissance d'une nation, le Nord et le Sud, le chemin de fer, le progrès, la fin d'un monde, le western en tant que créateur de mythe, l'esprit pionnier, une certaine façon d'être, tout est repris, questionné dans leurs films. Mais Leone devant La horde sauvage devait sentir que ses films s'en tenaient jusqu'alors à de magnifiques exercices de style avec une dimension enfantine, celle qu'il revendiquait des gamins qui jouent aux cow-boys (littéralement citée dans Et pour quelques dollars de plus). Jusque là, ses personnages n'ont rien de très humain mis à part Tuco, le premier de ses héros picaresques, et Jill, son premier personnage féminin fort. Les héros de Peckinpah portent un poids autrement conséquent d'humanité, Pike, Thorthon et Dutch en particulier. Quand ils se regardent, ce n'est pas pour s'affronter, se jauger, c'est pour communiquer des sentiments et c'est cette force des sentiments qui les rend si vivants et le film si vrai. Et puis Léone qui avait toujours bataillé pour obtenir de grands acteurs américains, devait envier le fait que Peckinpah, après avoir fait jouer des légendes comme Joel McCrea et Randoph Scott, travaillait avec deux acteurs particulièrement représentatifs de la troupe de Ford : Maureen O'Hara pour son premier film et Ben Johnson, Tector Gorch dans La horde sauvage, qui joue aussi dans trois autres des ses oeuvres. Bien sûr, Leone avait eu Henry Fonda, mais c'était pour renvoyer une image pervertie du héros de La poursuite infernale. Et ainsi, c'est dans Il était une fois la révolution, qui se passe au Mexique pendant la révolution (forcément), que Léone développera deux ans plus tard son véritable premier couple, Juan et John, fonctionnant sur la profondeur de sentiments contradictoires mais réciproques.
00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Sam Peckinpah, Howard Hawks, Sergio Léone, western | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/07/2006
Des frissons dans le dos






00:00 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Sam Peckinpah, western | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2006
Dédicace
16:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Marilyn Monroe, photographie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/07/2006
Revue de presse
Alors que les députés de gauche et du centre déposent un recours contre la loi DADVSI, il est amusant de lire le coup de gueule poussé par Jean Luc Porquet dans le dernier numéro du Canard Enchaîné. Comme nombre de ses confrères critiques et journalistes, il a été invité à la grande projection en avant première dans une salle des Champs Elysées pour la sortie de la nouvelle version de Superman mise en scène par Bryan Singer. Et Porquet de s'indigner qu'ils en profitent pour « Fliquer des centaines de journalistes et d'invités qui s'y rendent. Mieux : les intimider par écrit ». Vous connaissez tous ces messages hautement énervants : pas d'appareil enregistreur, fouille à l'entrée, poursuites judiciaires au cas où, qui vole une auto vole un Superman, etc. M Porquet a fait la seule chose à faire, il n'est pas allé voir Superman en avant-première. Au Canard, dit-il, « nous aimons exercer notre métier [...] sans parano sécuritaire ». Les justes mots.
18:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, droits, DADVSI | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
06/07/2006
Avril en juillet
J'ai pu remarquer que nombre de blogs cinéphiles que je fréquente, comme une partie de la critique d'ailleurs, n'est pas très tendre envers le jeune cinéma français. Nous mettrons d'emblée de côté les transfuges de la télévision (à quelques très rares exceptions) et la horde des admirateurs stériles de l'efficacité américaine façon Besson. Il est aussi vrai que tout n'est pas réussi, difficile de défendre Peindre où faire l'amour des frères Larrieu quand bien même Un homme, un vrai était vraiment intéressant. Difficile de ne pas constater l'échec de Le Petit lieutenant de Xavier Beauvois, très mal construit. Mais je comprends moins les reproches fait à un film comme Travaux de Brigitte Rouan (n'est-ce pas, Pierrot) ou les pointes envers Arnaud Despleschin qui, s'il n'est peut être pas un gentil garçon n'en est pas moins un sacré cinéaste. Peut être est-ce parce que je m'intéresse beaucoup au court métrage mais j'y découvre souvent des personnalités attachantes dont j'attends avec impatience et souvent indulgence leur passage au long métrage. Parfois ils déçoivent (Eric Guirado) et parfois non (Yves Caumont). J'aime ensuite voir leur carrière se développer et les films construire l'un après l'autre une oeuvre. Cette oeuvre restera modeste, ou pas. Qu'importe. Tous les premiers films ne sont pas Citizen Kane, tant pis, et tous les jeunes réalisateurs ne seront pas Godard, tant mieux.
Ce qui m'amène à Gerald Hustache-Mathieu au parcours assez caractéristique. J'ai constaté avec un peu de tristesse que son premier film, Avril, n'a guère provoqué d'intérêt dans la presse « classique » ni sur les blogs. Il me semble pourtant que ce premier long de l'auteur de Peau de vache et de La Chatte andalouse avec Sophie Quinton, l'actrice qu'il a révélé dans les courts sus-cités, était en soi un petit évènement agréablement alternatif au grosses machines habituelles comme aux désespérances de notre cinéma national et qu'il méritait un soutien résolu.

Avril, c'est l'histoire d'une jeune novice qui, au moment de prononcer ses voeux définitifs, apprend qu'elle a un frère jumeau et est poussée à partir à sa recherche. Avril, c'est l'histoire d'une mise au monde, une seconde naissance. C'est un récit initiatique, celui de la découverte des autres et de l'ouverture des sens. C'est aussi une sorte de façon, modestement, de réinventer le cinéma et le plaisir de filmer. Hustache-Mathieu pratique une petite musique cinématographique bien à lui et ce premier long prolonge habilement l'univers mis en place dans les deux courts. Un univers très dépouillé au départ, à l'image de la cellule d'Avril (c'est aussi le nom de la jeune novice), dans lequel le réalisateur introduit doucement quelques éléments étrangers. Un jeune homme, puis deux autres jeunes hommes, la mer, les dunes, le plaisir d'un bon repas, la musique, la peinture, faisant abstraction de tout ce qui est au-delà. Je me suis fait cette réflexion, à un moment, qu'il avait retrouvé cette essence du cinéma : partir en équipe, en bande, tourner au grand air une histoire simplement humaine. C'est Ford à Monument Valley, Hawks en Tanzanie, Truffaut à Nîmes, Renoir en Inde... Avril n'est pas Le fleuve, mais le film dégage cette fraîcheur, cette simplicité, cette forme de naïveté sympathique qui le rend attachant.

Et puis, il y a Sophie Quinton. Rien que d'avoir su la filmer, de lui avoir écrit ce rôle, ce beau personnage, c'est déjà une grande réussite. Il y a aussi et j'y ai été sensible, le fait que Hustache-Mathieu évacue très vite le côté « mystique » de son récit. Je m'explique : les histoires avec des nonnes, cela donne souvent de profondes réflexions sur la foi, Dieu et le reste. J'y suis assez hermétique, mis à part Le narcisse noir de Powell parce que c'est incroyablement beau. Mais là, Avril est presque un film païen au sens où l'enjeu du film, c'est véritablement l'éclosion de cette jeune femme et la découverte de la vie ici et maintenant avec toute la sensualité qui va avec. Dieu n'est pas un ressort dramatique, Avril croit et c'est tout. Mais elle croit aussi au présent, à la matière du monde. Merveilleux plans où elle plonge ses mains dans le sable. Merveilleux sourire qui illumine le visage de Sophie Quinton et l'écran. Moments suspendus lorsqu'elle se tient face à la mer, comme dans La chatte andalouse, puis lorsqu'elle se livre, nue, aux vagues. Pas de psychodrames, pas d'angoisses métaphysiques. Hustache-Mathieu filme l'apprentissage de la joie. Merci à lui.
Pistes
un entretien avec le réalisateur sur Excessif
un entretien avec le réalisateur sur Cinémovies
Source images : Haut et Court
00:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : Gerald Hustache-Mathieu, Sophie Quinton, cinéma français | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/07/2006
Les titans arrivent
J'ai cette vidéo en réserve depuis quelques temps et le moment me semble opportun de la faire partager à mes lecteurs et en particulier à mes amis formant le club des admirateurs et admiratrices de Giuliano Gemma. Les titans (Arrivano i titani) est l'un des premiers grands rôles de l'acteur et l'une des réussites les plus éclatantes du peplum italien. Réalisé en 1961 par Duccio Tessari, le film allie la mythologie et la comédie avec brio. L'extrait que je vous propose montre l'affrontement entre Krios (Gemma) et Rator (Serge Nubret). Outre la beauté des cadrages et la richesse de la direction artistique (les recherches géométriques), on notera le côté décontracté de la bagarre, la violence contenue et désamorcée.

Le film est enfin disponible en DVD et Digitmovies vient de sortir le second volume d'une série de CD dédiée aux peplum et qui propose pour la toute première fois la musique composée par Carlo Rustichelli pour le film.
08:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Giuliano Gemma, peplum, Duccio Tessari | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/07/2006
Salut
Si j'ai bien lu la dernière note du journal Cinématique, Ludovic met un point (final ?) à son blog initié voici vingt mois. Je crois l'avoir écrit quelque part, mais la première fois que je suis tombé sur Cinématique, je l'ai trouvé si bien écrit que j'ai pensé, commençant moi-même Inisfree, arrêter. Finalement, cela m'a plutôt servi de stimulant et j'ai, sinon mieux écrit, du moins fais des efforts en ce sens. Difficile d'expliquer l'originalité d'un tel blog. Ludovic y parle de cinéma, de lui à travers le cinéma, de notre monde à travers le cinéma, d'Art enfin et a entamé une longue et impressionnante conversation virtuelle. Le tour de force, de mon point de vue, c'est d'avoir aggloméré autour de son projet des personnalités aussi différentes qu'Alina Reyes, Juan Ansenio, Marie Marten, Hippogriffe, Jean Sébastien, Georges Kaplan, Sandrine où moi-même et puis tous les autres, les 39 blogs, tant d'autres venu échanger, se disputer, découvrir. Pour être franc, il y a des blogs sur lesquels je n'aurais jamais mis le clic sans avoir auparavant suivi les échanges sur Cinématique. Je n'ai pas toujours tout suivi ni tout compris je crois, c'était parfois abscons, virulent, fin, violent, extravaguant, généreux, intelligent, pointu, pensif, gai, rageur, triste, intello, vivant, surtout vivant. Cela va me manquer.
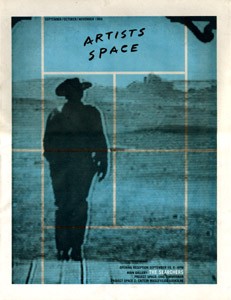
21:16 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/06/2006
Johnny Guitar
Johnny: Tell me something nice.
Vienna : Sure, what do you want to hear?
Johnny: Lie to me. Tell me all these years you've waited. Tell me.
Vienna : (without feeling) All those years I've waited.
Johnny: Tell me you'd a-died if I hadn't come back.
Vienna : (without feeling) I woulda died if you hadn't come back.
Johnny: Tell me you still love me like I love you.
Vienna : (without feeling) I still love you like you love me.
Johnny: (bitterly) Thanks. Thanks a lot.
(Extrait du scénario original)

13:15 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : western, Nicholas Ray, dialogues | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2006
Je ne l'aurais pas cru
08:00 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/06/2006
Django
Le moment me semble bien choisi pour vous faire partager l'ouverture de ce film emblématique du western italien : Django, réalisé en 1966 par Sergio Corbucci. Film matrice, créateur d'un mythe qui inspirera des légions (romaines) de déclinaisons (latines), souvent imité mais bien sûr jamais égalé, Django est un diamant noir. Les quelques minutes de l'ouverture suffisent à exprimer la radicalité du projet de Corbucci. Jamais un héros de western n'était arrivé à pied, à l'exception de John Wayne dans Hondo de John Farrow, mais il marchait de face, au soleil, un chien sur les talons. Deux ans plus tôt, Sergio Léone faisait arriver l'homme sans nom, Clint Eastwood, sur un âne, c'était un premier pas ironique. Django lui, enveloppé dans sa cape noire, chemine péniblement sous une fine pluie, de dos, trébuchant dans la boue, traînant son mystérieux cercueil comme une croix. Le paysage n'est pas ouvert sur de vastes étendues mais, désolé, se refermant entre deux collines chétives.
Franco Nero raconte avec humour comment lors du tournage de cette scène, Corbucci lui a donné comme instructions d'avancer sans se retourner et qu'il lui dirait quand stopper. Au bout d'une dizaine de minutes, n'entendant rien venir, il se retourne et découvre que l'équipe s'est fait discrètement la malle. Un certain sens de la plaisanterie.
Corbucci retourne soigneusement tous les signes habituels du genre pour donner une vision étonnamment neuve et sombre. Second élément qui place d'emblée Django à mille lieues au-delà de Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964) et de ce qui avait été fait jusqu'ici, l'irruption du fantastique gothique. Le cercueil, bien sûr, mais aussi ces lettres rouges sang, dont la police serait adaptée aux films de la Hammer anglaise ou à ceux de Mario Bava. Si les premiers westerns italiens se plaçaient sous le signe de l'imitation, si Léone allait « s'inspirer » du Yojimbo de Kurosawa et engager un cow-boy authentique, Corbucci va puiser son inspiration visuelle dans une tradition bien européenne et à-priori aussi éloignée que possible de l'univers du western. Comme il le fera deux ans plus tard dans Le grand silence, il n'hésite pas à s'asseoir sur le genre. Il ne rend pas hommage, il ne fait pas de clin d'oeil, il subvertit, il dynamite dans un grand éclat de rire sardonique. Car l'humour ne manque pas dans Django, un humour noir all'dente comme lors de la scène de l'oreille. Un humour qui passe ici par les paroles de la chanson pop chantée par Roberto Fia sur la musique de Luis Bacalov. Une chanson qui parle d'amour perdu, d'une femme aimée, du soleil qui brillera demain. Une chanson dont les mots sont en contradiction totale avec ce qui nous est montré sur l'écran. Une chanson qui laisse croire que le film sera une nouvelle histoire de vengeance. Mais l'entreprise de subversion des codes menée par Corbucci va jusqu'à s'en prendre au western italien lui-même et ce thème de la vengeance laisse brutalement place, à mi parcours du film, à des motivations plus vénales. Corbucci va au bout, jusqu'à cette rédemption improbable au cœur d'un cimetière. Revenu du royaume des morts, c'est chez eux que Django retourne pour puiser les dernières forces nécessaires à son ultime combat.
A lire, le très bel article de Francis Moury sur DVDrama auquel il me semble que Ludovic rend hommage.
Django, have you always been alone?
Django, have you never loved again?
Love will live on, Oh Oh Oh...
Life must go on, Oh Oh Oh...
For you cannot spend you life regreatting.
Django, you must face another day.
Django, now your love has gone away.
Once you loved her, whoa-oh...
Now you've lost her, whoa-oh-oh-oh...
But you've lost her for-ever, Django.
When there are clouds in the skies, and they are grey.
You may be sad but remember that love will pass away.
Oh Django!
After the showers is the sun.
Will be shining...
Once you loved her, Whoa-oh...
Now you've lost her, Whoa-oh-oh-oh...
But you've lost her for-ever, Django.
When there are clouds in the skies, and they are grey.
You may be sad but remember that love will pass away.
Oh Django!
After the showers is the sun.
Will be shining...
Django!
Oh Oh Oh Django!
You must go on,
Oh Oh Oh Django...
23:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, sergio corbucci, western | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/06/2006
John Payne, avec un « P »
Je ne sais pas où coucher
Tu restes avec moi
Et cette discussion entre les deux hommes dans la chambre de Tennessee qu'ils partagent, Cowpoke torse nu et avantageux langoureusement lové dans ses draps.
Tu devrais te marier
Mais il faut épouser une femme !
On croirait presque le finale du Grand détournement mais c'est sans doute involontaire.

Le film allie le charme vif de la série B (comme Bud Boetticher) de années 50 avec bagarres, fusillades, poursuite et la distribution masculine ; à la sophistication d'une mise en scène de série A (Comme Allan Dwan, le réalisateur) dans le traitement de la couleur, de l'espace, et la distribution féminine de haute tenue, Rhonda Fleming, Coleen gray et une troupe de charmantes jeunes femmes parmi lesquelles les yeux experts reconnaîtront la débutante Angie Dickinson. Le film dégage une beauté fascinante notamment dans les scènes se déroulant dans la maison close. Richesse des décors, harmonies des teintes magnifiées par le Technicolor, sens du détail, j'ai pensé à la direction artistique de certains grands mélodrames de Douglas Sirk. Très impressionnante aussi une scène de jeu de poker à l'atmosphère sombre de film noir et à l'intensité proprement suffocante. Je sais désormais de John Payne savait jouer et que des films tels que celui-ci en valent la peine.
00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allan dwan, john payne, western | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/06/2006
Deneuve, en passant
05:25 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |


























