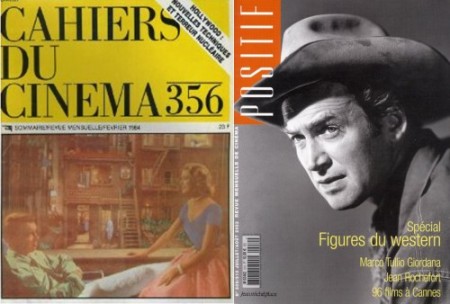30/05/2012
Cannes séquence 3
Lifeboat (La pirogue)
« Je suis un homme africain qui a décidé d'entrer dans l'histoire ! » crie au milieu de l'océan l'un des passagers de La pirogue du cinéaste sénégalais Moussa Touré. Il y a des discours, du côté de Dakar, qui ne passent pas. Qui suscitent une saine colère trouvant son illustration dans ce film, beau, épique et politique. La pirogue, c'est ce long bateau traditionnel et bariolé qui sert à la pêche et dans lequel s'entassent une quarantaine de ceux qui, plein du fol espoir de ceux qui n'ont plus rien à perdre, tentent de rejoindre l'Europe via les Canaries espagnoles. Une quarantaine de ceux qui se lancent, chevaliers de la misère, à l'assaut de la forteresse occidentale, sans écouter les conseils, ni craindre la mort.

Cette pirogue évoque le canot de sauvetage d'Alfred Hitchcock du classique Lifeboat (1943) et ce rapprochement n'a rien d'un réflexe gratuit de cinéphile. Moussa Touré, déjà réalisateur de Toubab Bi (1991), TGV (1998), et de plusieurs documentaires, a débuté au côtés de François Truffaut et de Bertrand Tavernier qu'il cite comme ses maîtres. Et comme Lifeboat en son temps, La pirogue est à la fois simple, linéaire dans son récit (les préparatifs du voyage, ses épreuves, son dénouement), et complexe dans le réflexion que l'auteur articule à partir de son dispositif. Le groupe humain réunit dans l'embarcation est un portrait en réduction de la société avec ses rapports de force, ses aspirations, ses faiblesses, le tout ramené à échelle humaine et inséré dans une action soutenue. Stagecoach (La chevauchée fantastique– 1939) de John Ford ne fonctionne pas autrement, et de quelle manière !
Sont ainsi réunis le capitaine Baye Laye, jeune père de famille qui a du mal à se résoudre au départ, son jeune frère aspirant musicien fasciné par le modèle occidental (Il possède un i-phone), la jeune femme qui embarque clandestinement dans ce milieu masculin hostile, un aspirant footballeur, l'organisateur du voyage qui s'enrichit déjà sur le dos de son peuple, un homme terrorisé par la mer accompagné d'une poule, un groupe de Guinéens Peuls mené par un père et son fils (déjà des migrants au sein de l'Afrique), un malade rêvant de se faire soigner...S'ils reproduisent les différences traditionnelles sociales, de sexe, de religion ou d'ethnie, ils se retrouvent unis de force par l'espoir et le danger. Partir ou rester, chacun a dû répondre à la question, certains avec des regrets (les visions oniriques de la savane), d'autres avec détermination, la plupart sans se faire d'illusion.

Moussa Touré balaie un large spectre de questions. A ces hommes et cette femme, il offre une série de portraits magnifiques, au plus près du grain de la peau des visages filmés par Thomas Letellier. Il ouvre son film sur une impressionnante scène de spectacle de lutte précédé de rites traditionnels (les gri-gris, les ablutions) et contemplée avec ferveur par une foule au t-shirts griffés de marques occidentales. Touré joue sur ces oppositions, la pirogue traditionnelle est équipée de moteurs et Baye Laye se dirige avec un GPS. Las, le GPS est perdu lors d'une spectaculaire scène de tempête (le réalisateur dit s'être inspiré de Master and Commander (2004) de Peter Weir), et les moteurs, en partie par négligence, tombent l'un après l'autre en panne. Les défaillances de la technique transforment le voyage en cauchemar, dérive et promesse d'une lente agonie qui va laisser le groupe anéanti. Seul espoir, être repéré par les équipes de secours occidentales, ce qui signera l'échec de leur aventure avec le sauvetage de leurs vies. La mort ou le retour, un cercle vicieux qui s'annonce quand la pirogue croise une embarcation similaire à la dérive, et ne peut leur venir en aide. Les multiples lectures que l'on pourra faire de la situation des pays d'Afrique sont assez claires.
Moussa Touré filme à hauteur d'homme et ne se laisse jamais engluer ni dans la dialectique, ni dans le pathos quand les choses tournent mal. Il travaille les caractères de chacun des personnages pour les faire exister au mieux au sein du groupe, insistant sur les détails comme cette poule incongrue, une photographie, un instrument, un bijou. Tournant en mer, il privilégie le côté physique des choses : les vagues se succèdent et le bois craque, il faut tenir la barre, faire la cuisine, pêcher, lutter contre les éléments et, quand le destin se fait contraire, les hommes cessent progressivement de se battre. C'est le temps des silences, des prières pour les croyants, de quelques souvenirs sous le soleil de plomb, des dernières forces que l'on économise. Certains meurent, doucement, prétexte à une jolie scène d'inhumation maritime assez fordienne. Le finale en deux temps équilibre le sentiment d'échec (le moment où les pieds se posent sur le sol européen si convoité est poignant), le dérisoire de cette aventure dont on ne retire que la satisfaction d'avoir survécu, et une réflexion d'espoir sur des solutions alternatives qui existent. L'Occident est un mirage, ignorance et compassion distante, qui en échanges de ces vies mises en jeu donne un sandwich et 15 euros. Le combat doit être mené à domicile, l'homme africain peut construire sa propre histoire et rester maître de son destin. Moussa Touré s'assure avec ce film une jolie place dans l'histoire du cinéma.
Un entretien avec Moussa Touré
Photographies © Rezo Films
23:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moussa touré, cannes 2012 | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
22/05/2012
Cannes séquence 2
Tout le monde dit : I love him
Robert E.Weide a suivi Woody Allen pendant deux années pour en tirer ce documentaire de deux heures Woody Allen : a documentary qui devrait sortir en salles à la fin du mois. Le film est une introduction relativement exhaustive à une œuvre foisonnante, quarante et un films à ce jour en attendant To Rome with love. Robert E.Weide progresse chronologiquement depuis l'enfance d'Allan Stewart Konigsberg à Brooklyn, des premiers succès comme scénariste et acteur avec le producteur Charles Feldman pour lequel il écrit What's New, Pussycat ? (Quoi de neuf, Pussycat ?) en 1965, du premier long métrage Take the money and run (Prend l'oseille et tire toi) en 1969 jusqu'au plus récent Midnight in Paris en 2011. Heureuse coïncidence, ce dernier film a été présenté à Cannes ce qui permet à Weide de boucler, temporairement, la boucle. C'est également le plus gros succès public d'un auteur qui a fait de l'indépendance l'alpha et l'oméga de son travail dès le début, indépendance basée sur un système bien rodé de modestes budgets et de fréquence soutenue : le fameux « un film par an ».

Weide dégage les lignes de force de l'œuvre allenienne marquée par la hantise de la mort et la futilité de la vie, questions sinistres transfigurées par l'humour politesse du désespoir. Une œuvre nourrie également par les indispensable figures féminines : Diane Keaton, Mia Farrow puis Scarlett Johansson. Sur le chapitre la vie privée, Weide donne quelques indications sur l'enfance du maître (ravissantes photographies d'Allen bambin), utilise un entretien avec sa mère, mais reste focalisé sur les films, n'abordant le personnel que lorsqu'il interfère avec ceux-ci, comme la séparation d'avec Farrow durant le tournage de Husbands and Wives (Maris et Femmes – 1992). Weide exhume aussi quelques savoureux moments des débuts télévisées d'Allen, un combat de boxe avec un kangourou et une tentative de faire du plat à Gina Lollobrigida lors d'un « talk show ». Pour le reste, il fait défiler les connaissances du réalisateur, ses collaborateurs et ses acteurs, Diane Keaton, Tony Roberts, Marshal Brickman, Sean Penn, Diane West, Robert Greenhut, etc. qui parlent très agréablement de leurs rapports avec Allen sans révélation particulière pour qui est un familier de l'œuvre. Le maître intervient également pour notre plus grand bonheur, modeste et plein d'humour, montrant ses petits papiers couverts d'idées de films, et sa fidèle machine à écrire sur laquelle il continue d'écrire tous ses scénarios, avec une conception particulière du « copier-coller ». Quelques extraits de tournage complètent ce portrait de l'artiste au travail (avec Josh Brolin sur You Will Meet a Tall Dark Stranger en 2010) révélant un metteur en scène discret et très attentif à ses acteurs, ce qui explique sans doute le plaisir qu'ils ont tous de travailler avec lui.
L'objectif de Robert E.Weide était de faire le documentaire sur Allen que le fan qu'il est avait envie de voir. Objectif globalement atteint. On pourra lui reprocher, du moins s'interroger sur l'absence de Casino Royale écrit pour Feldman en 1966 et dans lequel il joue le neveu de James Bond dans un registre très allenien et, après l'approche systématique des films jusqu'en 1987, un passage un peu rapide sur les années suivantes, négligeant complètement des films aussi réussis que Everyone Says I Love You (Tout le monde dit I love you – 1996) ou Hollywood ending (2002). Ceci dit, Weide a promis qu'après la version distribuée en salle viendrait une version de plus de trois heures pour la sortie en DVD, version qui comblera peut être ces quelques regrets.
A lire également sur Le western culturel
Photographie DR source Critique de films.fr
18:22 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : robert e.weide, woody allen | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2012
Cannes séquence 1
De rouille et d'os

Il est entendu qu'un réalisateur digne de ce nom refait toujours le même film. De rouille et d'os est dans l'exacte continuité des précédents films de Jacques Audiard. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve un personnage masculin un peu frustre, peu bavard, très physique, violent si nécessaire mais avec un bon fond. Le Ali joué par Matthias Schoenaerts avec une certaine intensité voire une intensité certaine, fait suite aux personnages incarnés par Vincent Cassel ou Tahar Rahim. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve un personnage féminin marginalisé par un handicap comme l'était le personnage d'Emmanuelle Devos avec sa surdité, et qui va le surmonter en aidant le héros à trouver sa rédemption. C'était également le parcours de la pianiste chinoise jouée par Linh Dan Pham dans De battre mon cœur s'est arrêté (2005). Marion Cotillard est cette fois Stéphanie, une dresseuse d'orques du Marineland d'Antibes victime d'un accident qui la laisse amputée des deux jambes. Je me souviens avoir découvert cette actrice dans La Surface de réparation (1998) un court métrage de Valérie Müller. Elle y dansait joliment sur un classique rock and roll. Chez Audiard, elle a un joli moment du même genre sur sa chaise roulante puis un étrange ballet avec un orque devant une vitre, poésie un peu naïve, un peu grand bleu, mais quand même convaincante. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve aussi la façon particulière dont Audiard investit les genres, le film noir, le film de prison, le mélodrame ici, jouant sur leurs codes sans les subvertir, respectant un certain premier degré ce qui est irritant pour certains, mais pratiquant un léger décalage par injection d'un travail d'arrière-plan documentaire, les expulsions d'immigrés de leur logement, l'univers carcéral, des combats de boxe clandestins ici, chose étonnante dont moi qui habite la région je n'avais jamais entendu parler. Admettons. Le plus intéressant dans De rouille et d'os est certainement ce portrait en creux d'une Côte d'Azur plus moche que nature, lumière solaire mais blanche, aveuglante. Sans surprise mais sans déplaisir, on retrouve la mise en scène maîtrisée jusqu'à l'exubérance de Jacques Audiard, calculée dans tous les coins et recoins du cadre, dans le tempo de la moindre seconde. Un rythme soutenu au risque de la rigidité, allant jusqu'à des ellipses à la limite de la compréhension. Pourquoi Stéphanie se décide-t'elle à appeler Ali ? Comment évolue le beau-frère d'Ali visiblement bien calmé à la fin après l'avoir menacé d'un fusil ? Audiard se soucie peu de répondre aux questions suscitées par son final mené au pas de charge. Reste que cette mise en scène précise et fébrile lui permet d'éviter les principaux pièges de son histoire d'amour traitée sans pathos, aussi simplement et avec la force de l'évidence des réplique de son héros d'une pièce. Audiard est OP, sans surprise mais sans déplaisir. Et vice versa.
17:52 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jacques audiard, cannes 2012 | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2012
Les joies du bain : assoupissement
Sur une suggestion de Benjamin, un bain à caractère fantastique dans lequel il ne fait pas bon se relaxer trop. Là où Victoria Abril faisait nager son homme grenouille dévoué, la jeune Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy Thompson voit surgir une main bien connue dans l'original Nightmare on Elm Street (Les griffes de la nuit- 1984) de Wes Craven. Vous pouvez découvrir la scène complère en cliquant sur la photographie (© New Line).
07:53 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : wes craven | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/05/2012
Les découvertes de l'inspecteur Silvestri
Il y a un petit côté Gainsbourg chez le réalisateur Massimo Dallamano. Une fascination pour les collégiennes en tenue sage et les turpitudes qui se dissimulent derrière la façade lisse et respectable. Quelque chose d'une parabole sur l'innocence et sa perte. La critique aussi d'un monde dont la perversité s'exerce sur le symbole même de la pureté, la jeune fille, quelque chose de proche du principe du sacrifice rituel des sociétés anciennes qui exigeaient la destruction d'une jeune vierge en offrande aux forces surnaturelles. Dans son giallo majeur Ma cosa avete fatto a Solange (Mais... qu'avez vous fait à Solange ? - 1972), Dallamano investissait un collège anglais et huppé pour en faire le cadre de meurtres atroces liés à de sordides histoires d'avortement clandestin. Dans La polizia chiede aiuto (La lame infernale) réalisé en 1974, c'est l'étrange suicide d'une lycéenne qui met les enquêteurs sur la piste d'un réseau de prostitution d'adolescentes recrutées dans une école religieuse pour filles de bonne famille. Les clients font également partie du gratin local. Charmant. Dallamano n'y va pas de main morte et il appelle un chat, un chat (pauvre bête). Au risque d'une certaine ambiguïté, il est direct par éclairs (le cadavre pendu, la tête coupée qui roule, la poitrine juvénile de Sherry Buchanan) tout en privilégiant la suggestion qui lui permet de créer une atmosphère angoissante et malsaine. Il utilise alors l'évocation graphique (les murs ensanglantés) et la bande son quand l'inspecteur Silvestri peut écouter enfin l'enregistrement clandestin et glaçant d'une passe. Ce que notre imagination reconstruit de la découverte d'un cadavre redouble d'intensité une très belle scène de suspense hospitalier comme l'agression de l'assistante du procureur Vittoria Stori dans un parking, évoquant celle du personnage joué par Edwige Fenech dans Il stano vizio della signora Wardh (1971).

De fait, Dallamano opère avec ce film un croisement entre le giallo et la polar, deux genres alors en vogue. D'un côté, il y a ce personnage terrifiant de tueur à moto, cuir noir et casque intégral, si habile avec son hachoir. De l'autre l'enquête est menée par l'inspecteur Valentini (Mario Adorf, excellent dans un second rôle qui aurait mérité d'être plus développé) puis conjointement par l'inspecteur Silvestri (Claudio Cassinelli une nouvelle fois superbe, tout en retenue, regards intenses et petits gestes précis) et Vittoria Stori jouée par Giovanna Ralli, l'inoubliable Columba de Il mercenario(1969) de Sergio Corbucci, qui livre une belle prestation en équilibre entre force et faiblesse, évitant les clichés attendus sur sa rivalité avec son partenaire masculin. S'ajoute une dimension de critique politique, pas trop appuyée ce qui lui évite la lourdeur. Comme dans tant de films du même genre, Dallamano et son scénariste Ettore Sanzò dont c'est le premier script, traduisent la défiance du pays envers ses élites. Le soupçon généralisé, la corruption des mœurs valant pour d'autres domaines. Là encore et sans entrer dans les détails, le réalisateur est direct et le haut responsable auquel se heurtent Silvestri et Stori leur dit sans ambages qu'il n'est pas question de poursuivre les notables dont les noms ont fini par être découverts. Un tueur au hachoir est en liberté, ils peuvent toujours courir après. Lui est issu d'un milieu populaire. On retrouve dans la scène finale, avec la disposition des immeubles en arène et la foule accourue en masse, cette idée de sacrifice rituel destiné à rétablir l'ordre des choses et à apaiser le désir collectif de sang, cette fois par la mise à mort du bouc émissaire.
Formellement riche, le film adopte la forme d'une spirale, nous entrainant dans un mouvement continu et maîtrisé qui enfonce les enquêteurs toujours plus profond dans l'horreur au fur et à mesure qu'ils progressent sur la voie de l'invraisemblable vérité. Cette forme trouve son expression dans un travail de caméra très mobile d'un endroit de la ville à l'autre. Nous suivons les policiers qui investissent les lieux et en découvrent les macabres secrets. Exemplaire est l'exploration de l'appartement moderne qui servait de lieu de rendez-vous et qui les met sur la piste d'un nouveau crime. Sous la surface lisse et sophistiquée se laisse entrevoir proxénétisme et détournement de mineure, puis la contrainte, la violence, et finalement une porte s'ouvre sur les traces sanglantes d'un crime spectaculaire. Il faut ici saluer l'admirable partition de Stelvio Cipriani dont les nappes métalliques et grondantes épousent étroitement le rythme des images et celui du récit, le relançant sans cesse, ironisant sur un étrange chœur féminin à l'innocence décalée, avant de se déchainer en sonorités plus dures. Un travail remarquable, proche de celui effectué sur La polizia a le mani legate (1974). le montage de Antonio Siciliano, déjà responsable de celui de celui de Ma cosa avete fatto a Solange ?, harmonise le tout, avec quelques accélérations lors des rares scènes d'action pure (l'inévitable poursuite voiture – moto, la belle descente d'escalier dans l'hôpital, la scène finale) tandis que la photographie de Franco Delli Colli travaille les ambiances giallesques, accentuant le côté film noir plutôt que polar moderne, ce qui n'est pas plus mal. On pourra éventuellement tiquer, et j'imagine que ce fut le cas à l'époque, sur l'idéalisation un peu naïve de la sainte alliance entre policier de base intègre et magistrate courageuse contre les puissants pourris et invisibles, sans plus de nuance que ça. Silvestri convainc Valentini de reprendre sa démission malgré les pressions subies, et ils repartent comme en quatorze. Les braves gens !
Sur Psychovision
Sur Quiet Cool (en anglais)
Photographie DR source Cinema.de
21:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/04/2012
William Finlay au "Paradise"
10:49 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brian de palma, willima finley | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/04/2012
Les Cahiers Positifs (contribution)
10:45 Publié dans Blog, Revue | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : cahiers du cinéma, positif | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/04/2012
Empire à babord
Nouvel abordage par la quille d'un film qui a beaucoup compté pour moi, The empire strike back (L'empire contre-attaque- 1980) de Irvin Kershner, second, c'est à dire cinquième épisode de la fameuse sage lucasienne qui présente l'avantage majeur d'avoir été co-écrit par Leigh Brackett et Lawrence Kasdan, al première n'étant autre que la scénariste de Rio Bravo. Ce qui n'est pas, vous en conviendrez, rien.

Photographie source The Making of Star Wars: The Empire Strikes Back (depuis le site Cinémovies.fr)
00:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irvin kershner | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/04/2012
Steven Spielberg sur Lawrence d'Arabie
08:42 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : steven spielberg, david lean | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/04/2012
La tête d'Alfredo Garcia en poupe
Pendant sombre de l'élégiaque The Ballad of Cable Hogue (Un nommé Cable Hogue - 1970), Bring Me the Head of Alfredo Garcia (Apportez moi la tête d'Alfredo Garcia - 1974) est admirativement arraisonné sur Abordages. Photographie DR source Sunset gun.

09:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sam peckinpah, abordages | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
11/04/2012
Les réveils du Commissaire Rolandi

Le polar italien peut se diviser en trois grandes familles. Il y a le giallo avec ses codes propres qui ne met pas toujours la police au centre de ses récits mais se structure le plus souvent autour d'une enquête. Il y a le cinéma politique, c'est à dire un cinéma qui, dans les années 60 et 70, s'appuie sur le genre pour dresser un portrait critique du pays et de ses institutions. C'est dans cette veine célébrée dans les festivals et à l'étranger que s'illustrent des réalisateurs comme Francesco Rosi, Damiano Damiani ou Elio Petri. Et puis, n'hésitant pas à puiser dans les deux catégories précédentes, il y a un cinéma plus populaire, cinéma d'exploitation à usage national, le poliziottesco, qui prend la suite du western à bout de souffle, en recycle les artisans (réalisateurs, acteurs, techniciens) et lorgne du côté des succès américains comme Bullitt (1968), French connection (1971) et The godfather (Le parrain - 1971). Ces films mêlent en des cocktails plus ou moins subtils la violence, l'action, l'érotisme et une vision très sombre de l'Italie des années de plomb secouée par le terrorisme, l'instabilité politique et la criminalité. Politique donc, aussi, mais généralement sans nuance, s'éloignant de la rigueur des films-dossiers pour jouer l'ambiguïté d'une atmosphère de paranoïa, de défiance sur l'air du « tous pourris ». La police, corrompue à la tête, est célébrée à travers ses sans grades, simples commissaires ou inspecteurs (beaux, jeunes et athlétiques) amenés à adopter des méthodes faisant passer l'inspecteur Harry pour un aimable policier de proximité. Les titres sont emblématiques : La police ne peut pas tirer, le citoyen se rebelle, La police demande de l'aide, etc. On retrouve ici, après tout, les mêmes schémas simplistes que dans le western et le peplum, sauf qu'ils sont ancrés dans une réalité bien tangible : le quotidien d'une Italie bien réelle. Le côté allégorique, le jeu sur les codes, la fantaisie prenant place dans des espaces de pure fiction, ne fonctionnent pas. Ces polars provoquent un certain malaise par leurs excès, leurs complaisances (Meurtres d'enfant, viols, sadisme des criminels justifiant tous les débordements policiers), mais dans le même temps et avec le recul, ils sont d'excellents témoins d'une époque trouble et violente. Une époque d'attentats sanglants, de machinations politiques, des réseaux maffieux, de la loge P2 et de l'assassinat d'Aldo Moro. « En tuer un pour en éduquer cent », manipulations et corruption sont bien réels comme les lois d'exception et le spectre d'un retour du fascisme. Le polar italien, comme en son temps le film noir américain, devient le révélateur au sens photographique du terme, qui est après tout intrinsèque au cinéma, d'un état d'esprit, l'exutoire de sentiments de peur et d'exaspération face à un quotidien explosif.

Ceci posé, comme pour le western ou le peplum, le cinéma de genre en général, ce qui fait le prix des œuvres réussies c'est ce qu'elles arrivent à faire passer entre les schémas simplistes, et leur mise en scène. Une capacité à combiner l'action et la réflexion, à rendre palpable la tension, à créer une atmosphère, à faire vivre des personnages qui soient un peu plus que des pantins. A saisir aussi l'ambiance d'une époque en parcourant les rues des villes, les ports, les banlieues, faisant défiler devant les caméras les voitures (ah ! Les Alfa Giulia de la police), les objets, les intérieurs et les costumes.
A ce titre, La polizia ha le mani legate (1975), connu en france sous plusieurs titres grotesques, et réalisé par Luciano Ercoli est exemplaire. Ercoli est le producteur heureux des deux Ringo de Duccio Tessari et s'il a signé peu de films, on lui doit trois superbes gialli dont La morte cammina con i tacchi alti (1971) avec en vedette la belle Nieves Navarro (pseudonyme : Susan Scott), accessoirement sa femme, l'heureux homme. Il manifeste les mêmes qualités dans un genre que dans l'autre : préférence pour le suspense, goût modéré pour la violence, élégance des cadres en écran large et des mouvements de caméra qui balaient avec précision de grands espaces clos (L'hôtel ou le métro de La polizia ha le mani legate), jeu sur des montages complexes et sur le son, attention enfin aux personnages par une description attentive d'un environnement et de gestes quotidiens. La polizia ha le mani legate est donc d'une belle facture classique. A Milan, le commissaire Rolandi (Claudio Cassinelli) est sur la piste de trafiquants de drogue. Il se retrouve pris dans un attentat qui évoque le massacre de la Piazza Fontana de 1969. Il mène alors une enquête difficile, pris entre terroristes d'extrême gauche, manipulations d'extrême droite, corruption des services secrets et méfiance de l'intègre procureur Di Federico (Joué avec autorité par le vétéran hollywoodien Arthur Kennedy, admirable méchant des westerns d'Anthony Mann). Un tueur à gages s'en mêle et élimine les témoins potentiels l'un après l'autre, à commencer par le collègue malchanceux de Rolandi, Balsamo, joué par Franco Fabrizi que l'on a vu chez le gratin du cinéma Italien (Fellini, Antonioni, Cottafavi, Risi...). Si l'intrigue est compliquée à souhait par les scénaristes Mario Bregni et Gianfranco Galligarich, le fond est du très classique.

Mais dès la première scène, Luciano Ercoli propose un regard original à travers son personnage de policier. Le réveil du commissaire Rolandi, soigneusement découpé par les soin du monteur Angelo Curi (Opérant déjà sur les gialli d'Ercoli) nous fait pénétrer dans le quotidien d'un policier à la fois ordinaire et un peu décalé. Pour se réveiller, Rolandi a mis en place un ingénieux dispositif qui fait glisser son réveil de la table jusqu'à ce qu'il soit obligé de se précipiter pour l'empêcher de tomber. Homme d'action. Il se lève, caleçon, bâillement, chevelure ébouriffée. Il ouvre Moby Dick. Homme de conviction à la poursuite d'un idéal. Il se gratte la jambe du pied et passe dans la salle de bains tandis que se déclenche la magnifique partition de Stelvio Cipriani, sonorités métalliques, nappes mélodiques entêtantes, contribuant de manière essentielle à l'unité de l'ensemble. Rolandi salue sa concierge en sortant, il porte une longue écharpe vaguement rouge et des lunettes qui lui donnent un air d'enseignant. Sa voiture est une Mercedes d'occasion, toute cabossée avec une grande tache sur le côté. Tout est dans cette accumulation de petits détails, comme nous le verrons plus tard rattraper son sandwich qui glisse le long du tableau de bord. Nous verrons aussi le commissaire aller à la pêche avec sa maîtresse, la belle Papaya (Sara Sperati) et le couple fera l'amour dans la Mercedes. Ercoli aime les effets de contraste, Papaya, visiblement plus jeune que Rolandi, a une allure d'étudiante.

Longue ballade dans Milan au matin, entrée à la préfecture, Cipriani s'estompe. Le film commence. Appuyé sur ce quotidien, Ercoli va nous faire partager l'aventure de cet homme ordinaire quoique commissaire, happé par une conspiration complexe mais qui s'y débat comme un beau diable avec une obstination croissante. Surtout, Rolandi utilise toutes les ressources d'un métier qu'il maîtrise, bien plus que la violence de ses collègues de l'époque : Filatures, déductions, recoupements, réflexion, patientes recherches illustrées par l'épisode de l'oculiste. Et le film de décrire comment la violence du contexte met à mal cette conception noble de la fonction policière. Comment elle rend impuissante la ténacité de Rolandi comme l'intégrité du procureur Di Federico, comment elle provoque la mort du sympathique, presque comique, Balsamo abattu comme Marlon Brando chez Francis Ford Coppola, en achetant des fruits. La trajectoire du film enfonce Rolandi dans la noirceur, l'amène sur le terrain de l'action pure avec l'excitante poursuite du tueur dans le métro, le malmène physiquement et psychologiquement jusqu'au final que l'on peut voir, au choix, comme l'expression d'un renoncement moral où une concession de dernière minute au public. La dernière image se fige, comme dans tant d'autres films de cette époque, effet de style mais aussi l'expression de questions qui n'ont, alors, pas encore de réponse. La polizia ha le mani legate est porté par la composition de Claudio Cassinelli, peu bavard mais très précis dans ses gestes et expressions, il habite parfaitement son personnage et lui donne l'âme nécessaire. Il a un peu quelque chose de James Stewart. On le reverra dans plusieurs rôles proches où il fait merveille, et surtout pas mal de films de Sergio Martino avant qu'il ne trouve, bêtement, la mort dans un accident d'hélicoptère sur le tournage de Vendetta dal futuro en 1985.
Photographies : capture DVD Cecchi Gori
Sur Psychovision
23:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luciano ercoli, claudio cassinelli | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/04/2012
Luc Moullet lit
Devant la caméra de Gérard Courant, Luc Moullet lit Politique des acteurs Garry Cooper John Wayne Cary Grant James Stewart (éditions Cahiers du cinéma), l'un de mes livres de cinéma fétiches.
61e numéro de la série "Lire", réalisation le 26 mars 2007 à Paris (France).
23:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard courant, luc moullet | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/04/2012
Rosette lit
Devant la caméra de Gérard Courant, Rosette lit Le Grand méchant père (éditions Grasset).
65e numéro de la série "Lire", réalisation le 23 janvier 2009 à Paris (France).
23:26 Publié dans Actrices, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : gérard courant, rosette | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/04/2012
La prêtresse du fouet

Raquel Welch dont à l'instar de Marlène Dietrich l'on pourrait dire que son nom se termine coup de cravache, aura su incarner quelques uns de nos plus beaux fantasmes. En bikini peau de bête préhistorique, en poncho mexicain avec rien dessous et ici, en prêtresse du fouet, vêtue de cuir clair, commandant une légion de galériennes aux seins nus dans The magic Christian (1969), doux délire de Joseph McGrath aidé de deux futurs Monty Pythons, d'un duo de Beatles et de Peter Sellers. Photographie DR. Source The sixties
21:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : joseph mcgrath, raquel welch | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2012
Deux westerns de Gordon Douglas
Comme mon éminent collègue, le bon Dr Orlof, je me régale avec le catalogue de l'éditeur Artus Films. Ils viennent d'avoir la bonne idée de sortir un curieux western signé Gordon Douglas en 1951, Only the valiant (Fort invincible) avec un toujours étrange Gregory peck avec sa voix feutrée et son air un peu absent. Gordon Douglas, honoré début 2010 à la Cinémathèque de Paris, est un excellent metteur en scène d'action qui a touché un peu à tout, des fourmis géantes de Them ! (Des monstres attaquent la ville – 1954) à Franck Sinatra en détective, de Laurel et Hardy à Jerry Lewis, des aventures africaines d'Angie Dickinson à celles de James Coburn en super agent Flint. Il a trouvé un terrain de prédilection dans le western avec près de vingt titres sur vingt ans de The Doolins of Oklahoma (1949) à l'étrange Barquero (1970). Comme ses confrères Bud Boetticher, André de Toth ou Samuel Fuller, il aura apporté un ton neuf dans les années 50, plus sec, plus âpre, un goût de l'épure, une approche plus directe de la violence comme en témoigne le premier plan de Only the valiant sur un soldat cloué par une lance indienne sur la porte d'un fort dévasté. Ses westerns sont très divers, séries B et gros budgets, inégaux, de l'expérience 3 D de Charge at Feather river (La charge de la rivière rouge – 1953) à l'improbable remake de Stagecoach (hérésie de 1966), de la trilogie Clint Walker à l'original Rio Conchos(1964).

Only the valiant, inspiré par un récit du toujours intéressant Charles Marquis Warren, met en scène un officier raide et courageux, Gregory Peck donc, qui a bien des problèmes : une guerre indienne en cours, un poste avancé (le fort Invincible du titre français) gardant une étroite passe dans la montagne détruit, un supérieur malade qui se repose un peu trop sur lui, la détestation d'une partie de ses troupes, et une rivalité amoureuse (un peu feinte) avec un collègue dans le cœur de la belle Cathy Eversham (Barbara Payton dans un rôle plutôt potiche). Accusé d'avoir envoyé le sus-dit collègue à une mort horrible (maudit peaux-rouges), notre héros embarque dans une mission suicide (tenir le fameux fort Invincible) tous ceux qui le détestent. Belle collection de trognes originales, un sergent alcoolique, un cavalier arabe (si), une jeune recrue couarde, un psychopathe, un déserteur, la crème de la crème. Jolie galerie de solides seconds rôles, le fordien Ward Bond, l'inquiétant Lon Chaney Jr, Neville Brand dans l'un de ses premiers rôles et Jeff Corey, le Chaney du True Grit de la version Hathaway. Huis clos tendu, la menace est à l'intérieur comme à l'extérieur, Only the valiant déroule un programme attendu traité avec originalité par une atmosphère quasi fantastique et la peinture d'une violence compulsive. Photographié par Lionel Lindon qui a touché un peu à tout lui aussi, le film joue sur les ambiances nocturnes et les ombres profondes de la passe d'où peut sortir la balle ou la flèche fatale. L'effet angoissant est renforcé par l'artificialité du décor, abstraction de chicanes, hautes roches droites sans sommet. A ces sombres décors de studio s'opposent les espaces inondés de lumière de ce qu'il y a avant (le fort principal) et de ce qu'il y a après (Le territoire indien). Extérieurs naturels, âpres comme souvent chez Douglas, son film sent la poussière, le roc chauffé au soleil, la sueur des hommes. Les indiens, c'est bien triste mais c'est comme cela souvent dans les films de série de l'époque, sont des brutes sadiques sans nuances. Mais ils sont aussi, au-delà de la caricature, la matérialisation d'une menace symbolique, puissance de mort quasi surnaturelle comme ce personnage de cavalier arabe, joué par un spécialiste du Loup-Garou et filmé de façon très expressionniste. Sur cette atmosphère irréelle se greffe une violence traitée avec un réalisme brutal qui est aussi celui des personnages. La dureté des décors est celle de leur environnement, le sable, la chaleur, la crasse, exacerbent les pulsions. La violence comme mode de vie s'y exerce au-delà de tout risque personnel, de toute considération y compris de sa propre survie. Lors d'une scène incroyable, deux soldats, ex-nordiste et ex-sudiste, se détestent tellement que capturés par les indiens et promis à un sort plus terrible que la mort, il préfèrent encore se jeter à la gorge l'un de l'autre pour une bagarre de sauvages sous l'œil mi-amusé, mi-incrédule, de leurs geôliers. Lors du finale où les hommes tombent l'un après l'autre, Douglas fait intervenir une mitrailleuse, arme inédite dans le western de l'époque pour une fusillade orgiaque comme on n'en retrouvera que quinze ans plus tard chez les italiens. Le réalisateur reprendra le principe du film, ambiance et tension, en 1967 pour Chuka sans cette fois le happy-end artificiel et un traitement plus nuancé des indiens. Only the valiant reste malgré cela une œuvre relativement originale, très agréable et dont la redécouverte s'imposait.

Fort Dobbs (Sur la piste des comanches – 1958) est le premier films d'une série de trois que Gordon Douglas réalise avec l'acteur Clint Walker. Suivent Yellowstone Kelly (Le géant du grand nord - 1959) et Gold of the Seven Saints (Le trésor des sept collines - 1961) écrit par la scénariste de Rio Bravo, Leigh Brackett. Clint Walker est un grand bonhomme, 1 mètre 98, une stature imposante, une carrure quoi ! Ce qui frappe dans ce film, dès qu'il apparaît à l'écran, c'est comment il annonce Clint Eastwood chez Sergio Leone. Même économie de gestes et de paroles, mêmes qualités de tireur, même détermination (il vient ici pour se venger). Et puis surtout, il porte une veste à motifs indiens comme on en verra sur le poncho de l'homme sans nom. Walker, comme Eastwood, devint célèbre à la télévision avec un feuilleton western, Cheyenne, sans toutefois développer par la suite la brillante carrière de l'autre Clint. Dans Fort Dobbs, il joue Gar Davis qui, sa vengeance accomplie, fuit le shérif local à travers une contrée indienne agitée. Il endosse la défroque d'un cadavre rencontré par hasard puis débarque dans une ferme habitée par une femme et son fils. Manque de bol, c'est la famille du cadavre et le fils, malgré ses dix ans, a la gâchette facile. Rapidement, la femme vient à penser qu'il a tué son époux quand elle reconnait la veste (Gordon Douglas joue habilement sur les va et vient vestimentaires de son héros). Davis va néanmoins faire son possible pour les aider et les escorter jusqu'au fort Dobbs du titre où cela finira par une belle empoignade avec les indiens. L'amateur reconnaîtra quelques emprunts au Hondo (1953) de John Farrow (la menace indienne, la femme, l'enfant, le mari partit, l'étranger dévoué), mais Fort Dobbs est bien mené, bénéficiant de la superbe photographie du grand William Clothier qui n'a pas son pareil pour filmer les grands espaces de l'ouest, d'une musique de circonstance du non moins grand Max Steiner et de la présence aux côtés de Clint Walker de la belle Virginia Mayo, égérie entre autres de Raoul Walsh, de Brian Keith en excellent méchant et du petit Richard Eyer pas trop pénible dans le genre. Douglas est de nouveau très à l'aise avec les paysages désolés et enchaine des péripéties classiques avec conviction et rythme. Il sait toujours faire monter l'angoisse du hors champ, de la limite du champ comme dans la très belle scène où Davis évacue la femme et l'enfant de leur ferme cernée par les indiens. Il a un sens de l'espace assiégé tout à fait remarquable. On retrouve également sa représentation de la violence assez sèche (L'ellipse du premier meurtre, le duel entre Walker et Keith) mais impresionnante avec la fusillade finale où les civils repoussent les indiens à la winchester avec une puissance de destruction équivalente à celle de la mitrailleuse de Only the valiant. Une violence ici tempérée par l'étude attentive des relations entre Davis, la femme et son fils, rapports de méfiance, d'admiration, d'amour et de haine successifs. Il y a là beaucoup de délicatesse de la part d'un cinéaste d'ordinaire assez porté sur l'aventure et l'action pure, qui laisse s'exprimer la dignité de Mayo (quelle classe cette femme !) et la pudeur de Walker, là encore effet de contraste intéressant avec l'allure générale du bonhomme. Quelque chose qui approche certaines compositions de John Wayne.
L'hommage à la Cinémathèque
Photographie : Wikipedia et 50 westerns from the 50s
Only the valiant chez le bon Dr Orlof
La page de l'éditeur Artus Films (avec la bande annonce)
23:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gordon douglas | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/03/2012
A l'abordage !
Toujours un peu orphelin de Kinok, j'ai accepté d'embarquer pour une nouvelle aventure collective et respirer l'air du grand large sous la direction du Capt'ain Mariaque sur Abordage, histoire de prendre moi aussi le cinéma scandaleusement par la quille. Baptême du feu et première bordée en début de semaine dernière avec un bon vieux Fulci des familles (façon de parler, n'allez pas voir cela avec vos enfants ni votre conjoint impressionnable). Hardi, les gars, vire au guindeau !

Photographie © UGC Distribution
22:28 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : abordages, lucio fulci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2012
Les routiers sont sympas

Les palais délicats seront sans doute consternés par la scène introductive de Il bestione (Deux grandes gueules) réalisé par Sergio Corbucci en 1974. Sandro Colautti, joué par Michel Constantin, descend de son camion, petit matin blême et frisquet à un poste frontière, et lache un pet sonore devant un jeune douanier ahuri. « Je le gardais depuis la Hollande » déclare notre héros. Les palais délicats auraient tort de se formaliser parce que le film va s'attacher à montrer ce qu'il y a derrière cette trivialité introductive, et que nous somme de façon un peu provocatrice dans la vérité du personnage, de la même façon que Sergio Leone nous avait présenté Juan Miranda pissant contre un arbre au début de Giù la testa (Il était une fois la révolution – 1971). Il n'y a guère que les cinéastes italiens de cette époque pour montrer de telles choses sans vulgarité ni mépris. En une minute, Corbucci dit avec clarté qui est Sandro Colautti, son boulot difficile, sa décontraction malgré tout, son côté un peu frustre, sa gentillesse, son côté physique habitée par la carrure massive de Michel Constantin, acteur limité mais sous estimé qui est ici parfait. Un peu plus tard, le réalisateur présentera avec la même efficacité et la même économie de moyens le personnage de Nino Patrovita joué par Ginacarlo Giannini, ses bottes de cow-boy, sa casquette enfoncée sur les yeux, sa nonchalance et cette façon qu'il a d'être en retrait. Une allure qui vient à la fois de l'apport de l'acteur tout droit sortit de Mimì le métallo et autres personnages joués pour Lina Wertmüller, comme du goût de Corbucci pour les caractères joués par Tomas Milian dans ses westerns, indiquant le côté rêveur, idéaliste et individualiste de Nino.
Il bestione a tout du western manqué, comme on dit garçon manqué. Corbucci et ses scénaristes, Luciano Vincenzoni et Sergio Donati, reconduisent le principe du duo masculin que beaucoup de choses opposent mais qui doivent travailler ensemble. En 1974, déçu par l'échec de La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972), et par la tournure prise par le western italien, Corbucci s'oriente vers un autre cinéma tout en conservant le goût de l'aventure virile et la nostalgie des grands espaces. Il bestione peut se voir comme métaphore de cet esprit western, de sa perte (ou de son impossibilité) au sein d'une Europe quadrillée de frontières et de barrières. Reste juste le souvenir d'un idéal, un peu anarchiste, d'autonomie et de liberté, qui survit dans le regard des hommes, dans leurs actes pour tenir debout tout seuls et dans l'expression d'une solidarité pas tout à fait morte. On pense à ce qu'exprime à la même époque Sam Peckinpah qui utilisera de la même manière l'univers des routiers dans son Convoy en 1978. Corbucci transpose cet état d'esprit western dès le générique. Le camion de Sandro avale les kilomètres sur fond de plaines éclairées d'un soleil naissant (la photographie est signée du grand Giuseppe Rotunno) sur fond d'une ballade mélancolique chantée par Giannini lui-même et composée par les frères De Angelis (qui feront deux ans plus tard la partition du Kéoma de Castellari). La tonalité de ces images contraste avec la scène d'ouverture.

Sandro va donc rencontrer Nino à l'occasion de la visite médicale obligatoire pour les camionneurs. Son partenaire, trop âgé, est réformé et Sandro hérite du jeune homme. Sandro râle, bougonne, mais bien sûr au fil d'aventures picaresques, les deux hommes vont apprendre à s'apprécier. Ils vont décider de monter leur propre entreprise et acheter un beau camion, il bestione du titre. Comme dans ses westerns révolutionnaires, Corbucci creuse plusieurs veines de front. Une partie comique basée sur l'interaction entre Nino et Sandro où l'on retrouve des motifs connus : bagarre fordienne entre amis, partage de la même femme (Nino séduit la fiancée de Sandro lors du délicieux épisode polonais), coups fourrés. Une partie action traitée avec sérieux et brutalité, tournant autour du camion et des magouilles avec des truands, s'illustrant par une spectaculaire poursuite entre poids lourds et l'intense scène finale admirablement découpée et montée une nouvelle fois par Eugenio Alabiso, digne des grands moments du Duel de Steven Spielberg. Une partie enfin politique et sociale maillée dans le récit, appuyée sur une grande attention documentaire lorsque Corbucci décrit la visite médicale, le mariage en banlieue, l'ambiance des entrepôts où le restaurant des routiers.
Cette dernière scène est emblématique de l'art de Corbucci qui orchestre par une multitude de plans assemblés par Alabiso le repas des chauffeurs en une séquence au lyrisme musical et populaire transfigurant le trivial de la matière par une forme très maîtrisée. Il y a à là quelque chose de l'écrémeuse d'Eiseinstein. Avec le temps, ce genre de scène prend une précieuse valeur de témoignage, un portrait de l'Italie et de l'Europe des années 70 dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas folichon. Une nouvelle fois Corbucci oppose un individualisme rageur aux mécanismes d'une société qui brise les hommes. Dès que l'on est plus de quatre, on est une bande de cons chantait Brassens. C'est aussi le credo de Corbucci qui dirige ses coups sur les patrons (Hommes de main filmés avec des fusils comme ceux du major Jackson de Django (1966)) comme sur les syndicats incapables d'aider le vieux compagnon de Sandro, comme sur les médecins du travail à la réforme mécanique qui ne se soucie pas des conséquences humaines. Égoïsme, impuissance et froideur à tous les étages. Le fond du film est sombre, à peine tempéré par l'humour, cet humour grinçant de la comédie italienne, et la chaleur qui se dégage du portrait des deux amis. Comme pour Sonny et Jed, comme pour Paco et Kowalski, Corbucci dissimule à peine sa tendresse pour ses personnages de marginaux magnifiques sous le voile de l'action et de la farce.
Photographie Nocturno.it
La scène du restaurant
11:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/03/2012
Sean Connery ? Ça ne me dit rien...

George Lazenby offre galamment du feu à Helena Ronee sur le plateau suisse de On Her Majesty's Secret Service (Au service secret de sa majesté - 1969) mis en scène par Peter Hunt.
Photographie Larry Ellis/Express/Getty Images du 22 octobre 1968.
09:46 Publié dans Acteurs, Ça | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lazenby, peter hunt | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2012
Jean Giraud - Moebius et le cinéma

"Le cinéma est le réservoir d'images de Blueberry. J'ai toujours essayé, dès mon plus jeune âge, de faire du cinéma sur papier. Quand je travaille sur cette série, une musique très symphonique va jusqu'à jouer dans ma tête - genre Dimitri Tiomkin ou Maurice Jarre.
Concernant le personnage, je lui ai donné les traits de nombreux acteurs à la mode de films d'action : Belmondo bien sûr, mais aussi Bronson, Eastwood, Schwarzenegger… J'ai même utilisé Keith Richards (le guitariste des Rolling Stones) ou Vincent Cassel (qui a campé le rôle de Blueberry au cinéma). A chaque fois, je rajoutais un nez cassé, ainsi qu'une coupe de cheveux à la Mike Brant ! Beaucoup de réalisateurs m'ont également inspiré. Blueberry doit beaucoup à Sam Peckinpah (La Horde sauvage m'a bouleversé). Il y a aussi du Sergio Leone chez lui. Mais pour ce qui est de son amitié avec les Indiens, je suis plus proche de John Ford qui, toute sa vie, a été écartelé entre le machisme blanc de la conquête de l'ouest et la conscience qu'il avait des minorités opprimées."
Source : article du Monde publié originellement en octobre 2010, pour l'ouverture de l'exposition consacrée à Jean Giraud à la fondation Cartier
Image source The Blueberry visual encyclopedia
09:22 Publié dans Cinéma, Livre, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean giraud, moebius | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/03/2012
Chers lecteurs
J'ai le grand plaisir de vous présenter Adrien, né hier vers quatre heures du matin (le coquin). 3,1 kg tout mouillé et 48 cm tout déplié. Les parents sont pas peu fiers. Armande pleine d'impatience.

07:28 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (21) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |