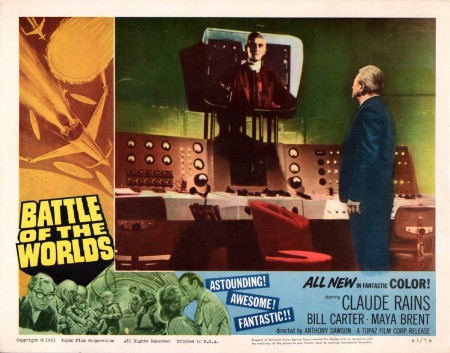13/09/2014
Et le vent apporta la violence
The unforgiven (Le vent de la plaine – 1960) Un film de John Huston
Texte pour Les Fiches du Cinéma
Patrick Brion et François Guérif reviennent dans un entretien croisé pour les bonus du DVD de l’édition Opening sur les conditions difficiles du tournage de The unforgiven (Le vent de la plaine), western à grand spectacle que John Huston tourne en 1960. Le cinéaste fait de chacun de ses films une aventure et cette aventure, humaine, physique, semble pour lui aussi capitale que le film lui-même. Pour paraphraser Martin Scorcese, il est le cinéaste aventurier par excellence. The unforgiven est ainsi tourné au Mexique dans la région de Durango, un endroit difficile et aride, balayé de vents de sable et territoire de gangs qui se rajoutent à la corruption officielle. Pour aplanir les difficultés et se livrer à sa passion plus ou moins légale des antiquités pré-colombiennes, Huston fera appel, comme plus tard Sam Peckinpah, à Emilio Fernandez, acteur et réalisateur qui connaît tout le monde. Avec sa distribution de grand style, Huston doit naviguer entre les angoisses d'Audie Murphy, l'ego de Burt Lancaster qui vient de passer à la réalisation et a ses idées sur la question, qui est en outre l'un des co-producteurs du film, les problèmes de santé d'Audrey Hepburn suite à une chute de cheval, et la nostalgie envahissante de Lilian Gish qui regrette le bon temps de Dark W. Grifffith. The unforgiven est un rêve de western, un rêve de poussière et d'opéra, de chaleur et de tragédie. Mais avec tout cela, Huston file dès la fin du tournage et la production va tailler dans le montage et sabrer le rêve. Le réalisateur va renier en bloc son seul vrai western, classique et audacieux, qui ne trouvera que de rares défenseurs.

De tout cela, le film porte la trace. Dans ses scènes magnifiques, dans ses manques inexplicables, dans ses accès sauvages et ses pauses poétiques, dans ses paysages aussi hostiles que grandioses, dans l'hétérogénéité de interprétation, dans les accents au lyrisme classique de la partition de Dimitri Tiomkin et dans ce qui affleure chez les personnages comme les implications incestueuse de la relation entre Rachel et Ben, le couple vedette. The unfogiven est un film de sauvages et sur ce qu'ils portent en eux de fanatisme, d'intolérance et de racisme. La famille Zachary élève du bétail au Texas. Elle est bouleversée par les révélations autour de la cadette, Rachel, adoptée toute petite et qu'une tribu Kiowa vient réclamer pour l'une de leurs. Le récit est inspiré du second roman d'Alan le May, qui fut scénariste pour Cecil B. DeMille. Le May était déjà l'auteur de The searchers (La prisonnière du désert) que John Ford venait de porter à l'écran, et avec quel talent, en 1956. Les deux histoires sont proches, deux faces d'une même pièce qui se regardent en miroir. A la jeune blanche enlevée et élevée par les indiens répond l'indienne enlevée et élevée par la famille Zachary. Au massacre de la famille Edwards répond celui de la tribu Kiowa. On retrouve le même personnage d'errant un peu cinglé, Moses Harper chez Ford, Abe Kelsey chez Huston. On retrouve aussi chez le personnage masculin principal (joué par John Wayne ici, Burt Lancaster là) la même force physique, la même autorité morale, la même détermination, la même violence, les mêmes névroses, et la même capacité à une soudaine tendresse. Et puis il y a la famille, pivot indispensable, cellule de base qui doit être protégée à tout prix et dont les liens passent avant tout le reste. Sans doute que pour Ford, cette thématique est plus sensible et lui permet d'ouvrir sur sa vision de la communauté, alors que chez Huston, plus franc-tireur, la famille reste en vase clos et la communauté extérieure est aussi hostile que le reste. Toujours est-il que ces liens affectifs sont seuls capables de briser les préjugés, la haine et les sentiments de vengeance. Mais à quel prix ?

{The unforgiven} montre la violence qui secoue la famille Zachary comme les vents brûlants du désert. Elle vient de l'extérieur, des Kiowas qui viennent mettre le siège devant le ranch, de l'énigmatique et inquiétant Kelsey, mais aussi de la communauté qui n'accepte pas l'idée que l'une des leurs puisse être une indienne. Elle vient aussi de l'intérieur avec la haine viscérale de Cash, l'un des frères, qui rejette son propre sang, avec les pulsions de la mère qui tue pour protéger sa fille, de Ben le frère aîné et de Rachel. Tous portent en eux la violence originelle des pionniers, une violence du même ordre que celle des indiens qu'ils ont combattu sans pitié. Comme chez Shakespeare ou les légendes anciennes, cette violence est annoncée par un fantôme venu du passé, ici Kelsey, cavalier de l'apocalypse, clochard de la prairie et ancien sudiste (comme l'était Ethan Edwards). John Huston ouvre son film par une image étonnante. Une vache qui broute sur ce qui se révèle être le toit du ranch Zachary. C'est une demeure enfoncée dans la terre, un terrier, un fortin primitif et sombre, enserrant des secrets innommables et des pulsions inavouables. Deux ans plus tard, Huston réalise Freud. C'est de là que les Zachary assiégés tireront comme à la foire les indiens à l'attaque. C'est là que se cristallisera le combat féroce pour la survie et les révélations qui engagent le passé (l'origine de Rachel) comme l'avenir (le liaison entre Ben et Rachel, le choix de Cash).
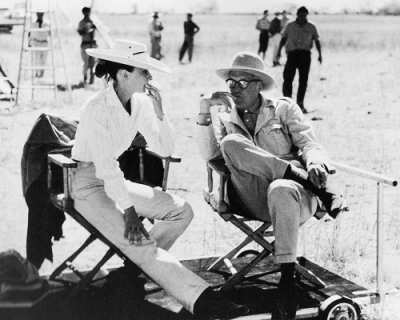
Audrey Hepburn et John Huston sur le tournage
Huston bâtit son film en trois mouvements. La première partie montre autour du ranch de vastes espaces extérieurs, filmés avec souffle, parfois élégiaques, parfois hostiles comme lors de la superbe scène de la tempête de sable. Suit une longue scène nocturne aux lueurs des torches qui s'achève par la pendaison de Kelsey provoquée par la mère, et la rupture des Zachary avec la communauté. Arrive ensuite la séquence du siège où Huston enferme ses personnages dans leur refuge et resserre les cadres jusqu'à plonger dans les visages (Rachel devant son miroir). Espace réduit et bas de plafond, ambiance claustrophobe où se débattent les personnages coincés dans le cadre, menacés par le feu et la fumée. La séquence finale verra la caméra reprendre de la hauteur sur un paysage désolé et jonché de cadavres. Mais de ce chaos naît un espoir. Libéré du mensonge et de la haine, la couple Rachel/Ben peut enfin s'épanouir et Cash est libéré de sa pulsion de mort.
Le récit a quelques lacunes qui déséquilibrent le film, ayant sans doute souffert des coupes. C'est flagrant avec le personnage de Johnny Portugal (joué par l'excellent John Saxon), métis amoureux de Rachel qui disparaît sans explication dans le dernier tiers. Mais Huston réussit de nombreuses belles scènes intenses, magnifiées par la photographie de Franz Planer qui a travaillé sur des westerns à grand spectacle pour William Wyler ou Edward Dmytryk. La scène de la tempête est un morceau de bravoure aux lisières du fantastique où les Zachary traquent Kelsey dans un déchaînement de tourbillons de sable et de poussière où hommes et chevaux errent comme des spectres. La scène du lynchage adopte un dispositif un peu théâtral avec un découpage en blocs des différents groupes autour de Kelsey attaché sur son cheval. Il y a un côté Marc Antoine sur le Forum. Très réussi aussi les jeux de regards entre Lancaster et Hepburn qui expriment la complexité de leurs rapports. Et puis, emblématique du film, il y a cette scène d'un genre que l'on ne trouve que chez Huston, autour du piano à queue ramené par Ben à sa mère, symbole d'une autre civilisation quand celle-ci se met à jouer du Mozart sur la prairie. Lors du siège, la famille sortira pour un dernier concert, une lutte musicale avec les indiens qui chantent au même moment pour honorer leurs morts. Étrange et fascinant duel culturel nocturne.
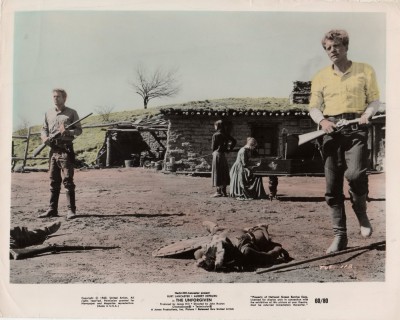
Il y a donc très largement de quoi justifier de ne pas passer à côté de ce film superbe et il ne sert à rien de regretter ce qu'il aurait pu être. Tel qu'il reste, The unforgiven avec ses excès, ses élans, ses manques est un rare exemple de western alliant classique et baroque, l'une des dernières œuvres majeures de l'âge d'or du genre, portant la marque de l'élégance et de la fougue de son auteur.
Photographies : capture DVD Opening / For cinephiles by a cinefille / United Artists
A lire sur DVD Classik
Sur Critikat
19:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john huston | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2014
Marquant
Une petite liste pour la rentrée, je ne saurais résister. Celle-ci m'est proposée par le Bon Docteur Orlof via un réseau social que tout le monde connaît bien : quels sont les dix films qui vous ont marqué. Un film qui marque, c'est vaste. Choc esthétique, émotionnel, circonstances particulières, rencontre décisive avec un univers, nous sommes marqués de bien des manières. Je vais donc remonter pour la majorité des titres à mon enfance et aux souvenir que je sais avoir conservés jusqu'ici, sans que la marque qu'ils ont imprimé en moi n'ait été conditionnée par tout ce que j'ai pu voir ou apprendre depuis lors. Une marque brute en quelque sorte.
Cinq tulipes rouges (1949) de Jean Stelli est une histoire de meurtre pendant le tour de France. J'ai fini cet été par revoir ce film que je recherchais depuis plus de quarante ans. Enfant, il alliait mon goût des films et du vélo et javais été impressionné par son atmosphère de mystère et par l'accident du coureur dont on avait scié le guidon. Très souvent quand je fais du vélo, je pense à cette scène.

King Kong (1933) de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Que dire ? Découvert vers 7 ou 8 ans, je ne m'en suis jamais remis. C'est un des films que j'ai vu le plus grand nombre de fois. Le plan du métro qui surgit du fond du tunnel, je ne sais pas pourquoi, est une image qui m'a toujours hanté.

Les pirates du rail (1937) de Christian Jaque. Aventures exotiques en Chine. Vu là encore très jeune, j'ai conservé ces images nocturnes du train mitraillé qui entre dans la gare sous la pluie avec les cadavres qui pendent des wagons. J'avais sans doute été sensible à l'atmosphère un peu étrange de certaines scènes et à Erich Von Stroheim en général chinois à monocle.

Bend of the river (Les affameurs – 1952) d'Anthony Mann. Le western en général m'a impressionné très tôt. Sur ce film, les « houhou » nocturnes des indiens et la flèche dans la gorge de Julia Addams ont été d'un traumatisme durable. J'ai aussi longtemps mêlé l'abandon de James Stewart en montagne et celui de John Wayne dans Red river (1948) de Howard Hawks.

Escape from Fort Bravo (1953) de John Sturges. Dans celui-ci, que j'ai mis très longtemps à revoir, c'est l'attaque finale des indiens qui envoient des volées de flèches sur le petit groupe de héros coincés dans un trou qui m'est restée. Il parait que John Carpenter aussi en avait été traumatisé.

Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) de Sergio Corbucci. J'ai déjà raconté, je crois, combien j'ai été choqué par le final de ce film vu vers 15 ans à la télévision. C'est, et ça reste d'une certaine façon, la transgression absolue. Je dois être trop sensible.

Rio Bravo (1959) de Howard Hawks. Qui a dit encore ? Ce film m'a marqué de toutes les façon dont un film peut le faire. Ce qui le distingue, c'est que c'est au cours de l'une de mes nombreuses visions que j'ai eu la, j'ose à peine l'écrire, révélation de ce que qu'était la mise en scène de cinéma.

Ai no korīda (L'empire des sens – 1976) de Nagisa Oshima. Là, je suis plus grand, adulte même. Ce film qui en a marqué bien d'autres que moi, fait partie de ces œuvres dont je connaissais la réputation et auxquelles je devais, un jour ou l'autre, me mesurer. Le film d'Oshima fait partie de ces films rares qui sont à la hauteur de leur renommée et dont le pouvoir fascinant et ravageur pour nos âmes ne perd jamais en intensité.

Salò (1975) de Pier Paolo Pasolini en est un autre. J'ai un souvenir très fort de la projection en salle, une salle bondée où l'on sentait palpable la tension des spectateurs. Pour moi, c'est le film qui m'a le plus éprouvé, dans le bon sens du terme. Jusqu'ici indépassable.

Photographies : RKO, Warner Bros., Universal et DR.
10:17 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/09/2014
L'enfer des ninjas
Clash of the Ninjas (1986) de Wallace Chang / Ninja in Action (1987) de Tommy Cheng / Ninja : American Warrior (1988) de Tommy Cheug
Texte pour les Fiches du Cinéma
Ami lecteur, ce texte va être quelque peu différent des autres. Je n'y parlerais pas, ou si peu, de mise en scène, de scénario, de photographie, pas plus que de musique, de montage (encore que), de son ou de jeu, ni d'une façon générale de tout ce dont on parle quand on parle de cinéma. Je ne m'aventurerais pas plus à vous donner des repères historiques ni de pistes cinéphiles que je ne me risquerais à des informations sur les participants aux films chroniqués. D'abord, faudrait pouvoir, ensuite il me semble clair que si vous envisagez d'acquérir le coffret Ninjas paru aux éditions Artus sous le patronage de Nanarland, ce n'est pas pour découvrir des perles méconnues du cinéma d'action asiatique, mais bien pour rigoler un coup devant un navet certifié délectable. Ou par l'effet d'une curiosité perverse dont je connais bien le mécanisme pour le partager à l'occasion. Ou alors c'est le cadeau d'un ami au sens de l'humour spécial. Ou encore, tu es ami lecteur un ninja toi-même et sois bien certain que je n'ai que respect pour ta noble profession (frappez pas ! ).

Soyons clair d'entrée, l'estampille Nanarland, également producteur d'intéressants bonus, est ici le gage d'une qualité paradoxale. Les trois films proposés, Clash of the Ninjas de Wallace Chang, Ninja in Action de Tommy Cheng et Ninja : American Warrior de Tommy Cheung, sont d’authentiques catastrophes sur pellicule, des monstres de films niant plus d'un siècle d'histoire des arts et techniques du cinéma, œuvres de Frankenstein de l'image, escrocs et infâmes tripatouilleurs de celluloïd, riant telle la hyène en pensant à leurs acteurs, techniciens et spectateurs. Le spectacle sera donc navrant ou hilarant à petite dose selon l'humeur.
Déjà, j'ignore si aucun des trois réalisateurs existe vraiment. Si cela se trouve, ce sont trois faux nez pour le fameux Godfrey Ho, ancien assistant et acteur pour Chang Cheh ou John Woo, responsable depuis d'une foultitude de films aussi mauvais les uns que les autres. Ho existe, mais pour son producteur Tomas Tang, les informations ne sont pas claires. Il est peut être mort, peut être qu'il n'existe pas, peut être que si. Comme à la grande époque du cinéma de genre italien, les génériques des films sont pleins de pseudonymes, le plus gratiné étant celui du scénariste de Clash of the ninjas, Kurt Spielberg. Si. Seuls les hum-vedettes occidentales ont leur nom bien en gros sur les affiches. Les hum-acteurs asiatiques, on ne sait même pas qui ils sont. C'est que ces trois films résultent d'une opération un peu particulière. Voilà : quand j'ai découvert le premier de la série, Ninja : American Warrior, je n'ai rien compris pendant une bonne demi-heure. Qui ? Quoi ? Où ? David Lynch, à côté, c'est Jean Girault. Puis il m'est venu le soupçon que le film que je tentais de regarder n'était pas un mais multiple. Je n'avais pas encore vu le documentaire en bonus qui explique très bien la forme de ces hum-œuvres, le 2 en 1.
le principe en est simple. La production, ici Filmark, achète au kilo des films d'action asiatiques, tourne vingt à trente minutes de film avec des acteurs occidentaux plus ou moins consentants (voir l'entretien avec l'ancienne gloire du peplum Richard Harrison). Mélangez le tout, servez en VHS, emballez c'est pesé. C'est pas cher et ça peut rapporter gros semble-t'il. Il faut juste un monteur astucieux pour relier les morceaux, l'exercice entraînant parfois un surréalisme involontaire. Un exemple : dans Ninja : American Warrior, on démarre avec une jeune femme occidentale (actrice 1) qui se bat contre des ninjas. Pour affronter une redoutable chef de gang, la Mégère, elle décide de mettre un masque et hop ! La voilà transformée en combattante asiatique (actrice 2). Comme le masque ne ressemble à rien et que la motivation est obscure, inutile de dire qu'on ne comprend rien de rien. Mais il y a de l'idée comme quand les acteurs dialoguent d'un film à l'autre : « Vous ici ? ». « Oui, je me suis fait acheter par Godfrey Ho ». Le procédé, à dire vrai, n'est pas nouveau. Mohawk de Kurt Neumann pille sans vergogne Drums along the Mohawks (Sur la piste des Mohawks) de John Ford. Roger Corman ou la firme Eurociné savaient mixer les films à l'occasion.

Pour le reste, le spectateur averti prendra un plaisir pervers à tout l'inverse de ce qui intéresse le cinéphile bien né. Il privilégiera la version doublée pour se délecter des voix atroces ou des accents étrangers grotesques dans Clash of the ninjas. Il appréciera les faux raccords de règle et les incohérences, les différences de couleur et de format, les scènes nocturnes invisibles à force de sous exposition où les couleurs délavées en extérieur-jour. Il se régalera de dialogues sous acide dont le fameux « un cadavre vient de tomber du toit, chef, envoyez des renforts ! ». Il vibrera aux prestations absentes ou approximatives des acteurs, les extraordinaires Louis Roth en méchant, Paulo Tocha alias Bruce Stallion en clone de Stallone ou le grimacier Stuart Smith. Il s'amusera à reconnaitre entre les son synthétiques les morceaux prestigieux pompés (j'ai trouvé du John Williams). Il se délectera d'effets spéciaux qui consterneraient Méliès avec apparitions-disparitions des ninjas dans un « pouf » de fumée. Tout ce qui concerne les fameux guerriers de l'ombre dégage une furieuse poésie déviante et infantile : couleurs vives rouges, jaunes, oranges, armes loufoques (des cerceaux!), un curé-ninja, des triplements, des têtes qui tournent, moi même je me sens nauséeux... C'est Barnum, mais un Barnum mité de province.
Dans tout ce foutoir, le plus curieux est le sentiment devant les scènes issues des films asiatiques piratés, à priori tournées sérieusement et qui contiennent de fortes scènes de violence et/ou de sexe. On devine dans le film caviardé par Ninja : American Warrior un polar violent avec meurtre d'enfant et assassinat d'une femme de policier enceinte. Les combats y sont nerveux. Dans Ninjas in action, Stuart Smith et sa partenaire se livrent à des ébats dignes d'un « porno-soft » tandis que le film asiatique propose une scène de domination sexuelle assez sordide et tout aussi explicite. Dans les parties « occidentales », il y a toujours un décalage entre ce qui est montré et le ridicule de la façon dont c'est montré. Par exemple la scène gratinée de torture de ninja dans Ninjas in action avec briquet dans les valseuses. Un grand écart impossible à maintenir qui laisse atterré.
Voilà. C'est une expérience. Le cinéma peut être ça aussi. A petite dose, ça peut amuser, ou entre amis, mais vous êtes prévenus.
Photographies DVD Artus
10:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : godfrey ho, ninja | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/09/2014
Relax (3)
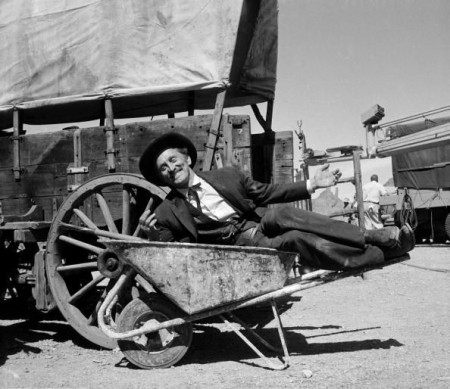
Kirk Douglas entre deux prises sur le plateau de Gunfight at the OK Corral (1957) de John Sturges. Photographie Ralph Crane.
14:41 Publié dans Relax | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kirk douglas, john sturges | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/09/2014
Le casse du siècle
The Brink's job (Têtes vides cherchent coffres pleins) de William Friedkin (1978)
Texte pour Les Fiches du Cinéma
S'il y a bien quelqu'un que je n'attendais pas du côté de la comédie, c'est bien William Friedkin, le réalisateur torturé de The exorcist (L'exorciste - 1973) et de To Live and Die in L.A.(Police fédérale Los Angeles - 1985). C'est pourtant bien lui qui se retrouve aux commandes de The Brink's job en 1978 dont le titre français, Têtes vides cherchent coffres pleins, accentue la dimension comique. Le film est écrit par Walon Green, immortel scénariste de The wild Bunch (La horde sauvage – 1969) pour Sam Peckinpah, et qui venait d'écrire pour Friedkin Sorcerer, le remake du Salaire de la peur de Henri Georges Clouzot. Ce dernier film, grande œuvre incomprise en son temps, est alors un échec public et critique. Il est bien possible que les deux hommes ne se soient pas fait trop prier par le producteur Dino de Laurentiis pour reprendre ce projet dont venait de se désengager John Frankenheimer. The Brink'job s'inspire du célèbre vol de la Brink à Boston en 1950 qui a vu un groupe de petits truands mettre la main sur un gros paquet de billets verts. C'est donc un typique film de casse où la dimension de comédie se double d'un regard nostalgique dans la reconstitution d'une époque, le situant entre le gros succès The sting (L'arnaque - 1973) de George Roy Hill, et le mémorable I soliti ignoti (Le pigeon – 1958) de Mario Monicelli, référence revendiquée, les fripouilles sympathiques menés par l'ingénieux et tenace Tony Pino étant une belle bande de bras cassés.

Pourtant, pourtant, ils ne sont peut être pas si sympathiques que cela. Par exemple ils envisagent froidement l'exécution du receleur McGinnis. Friedkin reste là fidèle à lui même et donne à ses personnages d'étranges zones d'ombre. Du coup, il peine à donner de la chaleur au groupe dans la description des relations en son sein. Pour jouer Tony, il a Peter Falk, acteur bénéficiant d'un grand capital de sympathie, et pour sa compagne Mary, Friedkin distribue Gena Rowlands. Le réalisateur réactive ainsi le couple cassavetien de A Woman Under the Influence (Une femme sous influence – 1974), mais s'en tient à quelque chose de superficiel. A vrai dire, ce qui fonctionne tient plus à la complicité des deux acteurs et au souvenir que le spectateur peut avoir du film de Cassavetes. Comme si Friedkin n'était pas intéressé où comme s'il s'était retenu. Il dira plus tard avoir fait un film en demi teinte, « murmuré ». Du coup, The Brink's job adopte un ton étrange où la comédie, qui peut se faire à l'occasion burlesque (la scène des bonbons façon Rabbi Jacob (1973) !), se teinte d'amertume, dégage une sorte de neurasthénie qui affecte l'empathie que l'on pourrait, devrait ressentir pour la bande de Tony Pino. Et par conséquence affecte aussi la tension qui devrait naître du récit, après tout, c'est un film de casse. D'une certaine façon, ces anti-héros incarnent une version déviante du rêve américain et rejoignent par là les autres personnages peuplant l’œuvre de Friedkin. Ce sont tous des gens sur le fil, des solitaires au fond qui se tiennent à la marge et souvent basculent.
Mais foin de considérations psychologiques. The brink's job est quand même de la belle ouvrage. Bénéficiant du travail du spécialiste Dean Tavoularis, la reconstitution est soignée, d'autant qu'elle ne recherche pas l'épate mais la justesse. Les rues du Boston de 1950 sont vivantes. Participant à la reconstitution, la photographie de Norman Leigh adopte des teintes automnales et urbaines, plutôt dans une veine mélancolique, mais n'évite pas toujours un côté appliqué. L'histoire est très classique, préparation, exécution, traque policière et final, menée avec rythme sur un montage de Bud S. Smith, déjà responsable de ceux de The exorcist et Sorcerer, tempo lent mais soutenu, dilatant les longues scènes d'action (ici l'exécution du vol) et accélérant sur les scènes finales qui se déroulent à grand coup d'ellipses sur plusieurs années. La scène centrale est réalisée avec minutie, grand luxe de détails et virtuosité dans la description du grand espace de l'immeuble de la Brink, précision des gestes et des mouvements des voleurs qui donne lieu à un véritable ballet, mécanisme d'horlogerie perturbé par l'inévitable grain de sable. C'est dans cette partie que Friedkin, sans doute plus à l'aise, donne le meilleur de lui même.
The Brink's job est l'un des films les moins connus de son auteur et sera lui aussi un échec à sa sortie, vite effacé par le sulfureux Crusing (La chasse – 1980). Sans être une pièce maîtresse, c'est un film très agréable à découvrir d'autant que la troupe d'acteurs vaut le coup d’œil, qui regroupe de superbes comédiens comme Peter Boyle, Allen Garfield, Paul Sorvino, et l'immense Warren Oates fidèle à ses personnages bien barrés. Friedkin reviendra encore à la comédie en 1983 avec Deal of the century, autre échec. Ce n'est pas sa voie.
Photographie Critics round-up
14:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/08/2014
Aventures dans l'espace (à l'italienne)
Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) de Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires - 1965) de Bario Bava
Texte pour Les Fiches du Cinéma
Le cinéma de genre italien s'est le plus souvent basé sur les succès étrangers du moment. Exception notable : le peplum qu'ils ont inventé. La série de films de science-fiction initiée dans les années soixante semble plus motivée par l'air du temps, la course à l'espace entre américains et soviétiques, la bande-dessinée et le roman d'anticipation que par un succès en salles. 2001 était à réaliser. Ces films de série B aux moyens limités ont beaucoup vieillit, et pas seulement à cause de l'évolution des effets spéciaux. Le genre n'a pas vraiment donné d’œuvre majeure. Les découvrir aujourd'hui c'est comme feuilleter un ancien numéro de Sidéral trouvé dans un vide-grenier, amusant mais anecdotique. Reste parfois un travail de défricheur d'idées. L'imagination des scénaristes, l'inventivité des metteurs en scène, font que l'on trouvera les prémices de productions de plus d'ampleur, américaines et friquées. Aimable idée de la circulation des idées au sein de la vaste histoire du cinéma, qui n'est jamais cloisonnée. C'est un principe que l'on pourra vérifier dans la première salve de science fiction européenne proposée par les éditions Artus : Il pianeta degli uomini spenti (La planète des hommes perdus – 1961) signé Antonio Margheriti et Terrore nello spazio (La planète des vampires) que Mario Bava réalise en 1965.
Le météore de Margheriti
Bricoleur doué, Antonio Margheriti a touché à tout avec une prédilection pour les effets spéciaux. Il restera le réalisateur le plus prolifique du genre avec une demi-douzaine de titres entre son tout premier Space men en 1960 et les quatre films de la saga Gamma uno tous réalisés en 1966. Il pianeta degli uomini spenti date de 1961 et il possède le doux parfum de la science-fiction rétro avec des soucoupes volantes, des fusées effilées, des costumes rigolos et des panneaux plein de voyants rouges et verts qui font blip et blop, d'indicateurs à aiguille et de leviers chromés. Dans cet opus, il s'agit d'un corps céleste qui s’approche dangereusement de la Terre, abritant le redoutable ordinateur d'une race extraterrestre éteinte. A terre, l'équipe de l'excentrique professeur Benson a compris le danger et organise la riposte. La première scène, un peu fleur bleue avec un coupe au bord de l'océan, est assez jolie. On se croirait dans une comédie estivale avec Catherine Spaak. Puis le film entre dans une série de tunnels très, trop, dialogués où seul maintient éveillé le cabotinage de Claude Rains incarnant l’irascible Benson. Ce sera le dernier rôle principal de l'acteur de James Whale, Michael Curtiz et Alfred Hitchcock. Autour de lui, raides comme des gravures de mode, les autres acteurs ne peuvent donner vie à des personnages trop schématiques. L'amateur remarquera la présence du juvénile Giuliano Gemma et d'Umberto Orsini dans l'équipe de Benson et déplorera l'absence d'érotisme dégagé par les actrices. Le scénario a beau être l'ouvrage d'Ennio De Concini (sous pseudonyme russe!), il aligne les clichés comme à la parade.
La mise en scène de Margheriti, sans être indigne, illustre platement les longues joutes verbales et échoue à créer une tension. Pourtant cette fichue planète s'approche de plus en plus. Le réalisateur se réveille, un peu, dans le dernier quart du film, quand les forces terrestres envoient des fusées vers le corps céleste et que, l'une après l’autre, elles sont détruites par les soucoupes ennemies sur fond d'une amusante musique électronique rappelant celle de Louis et Bebe Barron pour Fordidden planet (Planète interdite - 1956). Les effets sont rudimentaires et les lasers semblent grattés à même la pellicule. Mais il faut reconnaître que nous assistons, à ma connaissance, à la première bataille spatiale de l'histoire du cinéma. Dans l'ultime partie qui se déroule sur la planète errante, Margheriti fait preuve de ses talents avec les décors en carton pâte et les maquettes. C'est beau comme les couvertures de la collection « Anticipation » du Fleuve Noir. Si je vous dis que la terre est sauvée à la fin, je ne pense pas que vous serez étonnés. Du même auteur, je serais curieux de découvrir I criminali della galassia qui a meilleure réputation.
L'enfer spatial de Bava
C'est le style de Mario Bava qui fait de {Terrore nello spazio (La planète des vampires) réalisé en 1965 le fleuron de cette production science-fictionnelle à l'italienne. Le style et l'habileté du scénario de Bava avec l'aide de Alberto Bevilacqua, Callisto Cosulich, Antonio Román et Rafael J. Salvia inspiré d'une nouvelle italienne et qui fonctionne sur une trame simple et forte, avec unité de temps et d'action, sans s'encombrer de psychologie ni de conflits artificiels. Pour le reste, les acteur sont tout aussi raides que chez Margheriti, engoncés dans des costumes de cuir spatial avec un col très haut, très esthétiques mais peu pratiques. Les personnages sont dessinés à gros traits et la direction d'acteurs réduite à sa plus simple expression. Bava aurait pu injecter un peu de l'humour bande-dessinée comme il le fera si bien avec Diabolik, mais s'en tient à un sérieux papal qui fonctionne bien pour ce qui est de la tension, mais fait ressortir les incohérences et les naïvetés de certaines scènes comme le pilotage des vaisseaux avec tous ces appareils amusants façon Star Trek.

Deux vaisseaux se posent sur la planète hostile Aura, attirés par un mystérieux signal. Là se terre une force non moins étrange qui possède les astronautes, les forçant à s’entre-tuer puis à revenir comme des zombies pour attaquer leurs camarades. Le film hybride avec bonheur la science-fiction avec l'horreur comme Bava l'avait déjà réussi pour le peplum avec Ercole al centro della Terra (Hercule contre les vampires) en 1961. Le réalisateur pallie un budget très réduit par son sens visuel et son expérience de directeur de la photographie, jouant de toutes ses gammes de couleurs pop, vives, rouges, verts et bleus, noyant la pauvreté sous les brumes et faisant preuve d'une ingéniosité étonnante. Dans les bonus de cette édition Artus, un documentaire passionnant explique les trucages du maestro à base de recyclage de morceaux de décors et de rochers, de jeux de miroirs et de polenta mise à buller pour simuler un champ de lave. Miracle, cela fonctionne et Bava crée un monde fascinant et inquiétant entre Buck Rodgers et Flash Gordon. Il conserve un point de vue distancié ce qui lui permet de fabriquer son suspense sur le champ et le hors champ tout en s'autorisant des échappées avec la caméra qui nous font découvrir ce que les survivants ignorent. L'angoisse est bien présente et du film se détachent quelques moments forts de pure mise en scène comme le réveil des cadavres sortant de leurs tombes et déchirant leurs linceuls transparents, la traversée d'un paysage tourmenté ou la fameuse scène de la visite d'un vaisseau alien échoué, peuplé de gigantesques squelettes. Ce dernier passage ramènera immédiatement au film de Ridley Scott qui avait bien d'autres moyens techniques et un scénariste, Dan O'Bannon qui avait de la mémoire.
Photographies : DR et Artus Films
14:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario bava, antonio margheriti | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/08/2014
Silence
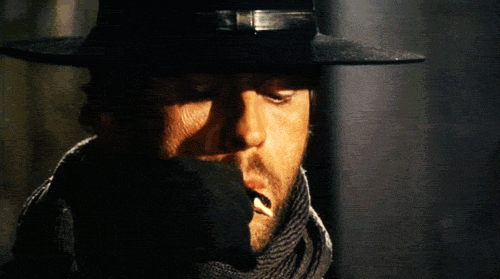
Merci, Frédérique !
22:59 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis trintignant, sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
24/08/2014
Deux femmes armées
Donne armate (1990) de Sergio Corbucci
La dernière œuvre de Sergio Corbucci sera un film pour la télévision, co-produit par la RAI en 1990. Donne armate (littéralement : femmes armées) est diffusé en 1991, en deux parties. A ce moment, Sergio Corbucci a déjà disparu, emporté par une crise cardiaque le 2 décembre 1990 à soixante ans. Malgré quelques limites en grande partie dues à son format et son cadre de production, Donne armate est un film riche dans lequel Corbucci fait preuve une fois de plus de son talent de raconteur d'histoire et de sa façon décalée d'aborder, sous la décontraction du cinéma de genre, des sujets sérieux en prise avec leur époque. Le film montre aussi une réjouissante constante dans les lignes de force de son œuvre, la place particulière des femmes, le goût pour les duos de personnages opposés mais liés par le mouvement du récit, et le mélange dynamique d'action et de comédie. On trouve enfin une capacité, après une soixantaine de films, à emprunter de nouvelles pistes, en l'occurrence des éléments venus du cinéma de Dario Argento.

Chien et chat, Angela est une jeune agente qui doit convoyer en compagnie de son supérieur, l'inspecteur un rien machiste Locasciulli, Nadia une ancienne terroriste internée. Il y a un os et, à une pause, Nadia s'évade en tirant sur le macho. Mais qui a organisé l'évasion et pourquoi, Nadia ne le sait pas plus que nous. Tandis qu'elle cherche à y voir clair en reprenant contact avec les anciens de son réseau, Angela qui culpabilise se met à sa poursuite. Les choses vont vite se révéler beaucoup plus complexes dans le scenario écrit par Corbucci avec la collaboration de Sefano Sudriè et Gianni Romolli, qui travaille avec Corbucci pour la cinquième fois et qui signera la belle histoire de Dellamorte Dellamore en 1994 pour Michele Soavi, ainsi que, tiens, Trauma de Dario Argento en 1993. Les deux femmes vont être amenées à s'unir, non seulement pour démêler le sac de nœuds, mais pour survivre. Le duo Nadia – Angela fonctionne comme à la belle époque de Paco et du Polack ou de Vasco et du Pinguino. Dans ces relations se mêlent des sentiments antinomiques de méfiance, de mépris, d'admiration, d'envie, matérialisés par une rivalité physique. C'est une alliance de contraires qui se découvrent des points communs et où les objectifs personnels opposés (sens du devoir, conviction, argent...) percutent une amitié naissante et mal assurée en provocant de profondes remises en cause. Souvent, fidèle à son style, Corbucci désamorce une émotion qui pourrait devenir artificielle par son goût de la comédie et la décontraction de ses personnages. Il sait pourtant donner d'un coup une densité à son couple mal assorti comme quand le cabot Guido Guidi meurt dans les bras du brave curé Don Albino dans Che c'entriamo noi con la rivoluzione? (Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? - 1972).

Dans Donne armate, sans doute motivé par la féminité de son duo, le réalisateur va un peu plus loin que d'habitude dans le registre sensible. Ce qui passe entre Nadia et Angela est palpable, porté par l'interprétation de Lina Sastri et Cristina Marsillach, et le film a l'intelligence de ne pas emprunter la piste du sous entendu sexuel qui n'apporterait rien. L'amitié entre la terroriste et la policière est de nature hawksienne, se construisant sur la reconnaissance des capacités professionnelles de chacune, sur l'estime qui se développe entre elles. Cette relation est mise en parallèle avec celle qui uni Nadia et son ancienne camarade Cora. Nadia retrouve petit à petit en Angela les mêmes qualités tant du domaine de la compétence que morales. Corbucci traite dans la même veine, avec finesse, la face amoureuse de ses héroïnes, laissant deviner la liberté sexuelle de Nadia tandis qu'il dessine à petites touches la timidité d'Angela dans sa relation hésitante avec Marco La Valle. Dans une courte scène explicite, les deux femmes dans un bar-dancing sont abordées par un dragueur que Nadia éconduit en entrainant Angela sur la piste de danse. Tout est dit de leur camaraderie naissante. Mais aussi, pour les deux femmes engagées dans une course contre la mort, pas de temps pour autre chose.

L'un des aspects remarquables de Donne armate est dans la façon dont Corbucci aborde la figure du terroriste dans l'Italie de la fin des années quatre-vingt qui sort tout juste des « années de plomb ». A travers son couple vedette, il est le premier à montrer dans le cadre d'une œuvre commerciale destinée à une chaîne nationale la réconciliation possible entre les adversaires d'hier et la possibilité d'un apaisement. Par le choix de l'actrice Lina Sastri, il inscrit Nadia dans le prolongement de la terroriste impitoyable jouée dans Segreti segreti (1984) de Giuseppe Bertolucci (qui lui valu un prix d'interprétation). Mais Corbucci apporte de nombreuses nuances dans le personnage. C'est une femme d'un certain âge mais encore belle, marquée dans son regard, mais qui ne renie rien de son engagement sans rien dissimuler de son amertume face aux lendemains qui déchantent et à la disparition souvent violente des anciens amis. Elle est filmée comme femme d'action, avec sa vitalité dans l'action, sa précision et sa dureté, mais aussi sa fatigue, sa lassitude et ses remises en cause, ce qui la rend émouvante. Face à elle, Corbucci met en scène avec Cristina Marsillach la nouvelle génération, faisant ressortir sa fragilité d'apparence, montrant ses temps morts et ses hésitations, mais aussi sa technicité, un rien scolaire. La jeune policière est fine de physique, presque une adolescente, parfois naïve dans ses réactions, ce qui ne l'empêche pas de faire le coup de poing à l'occasion. A l'idéologie de Nadia, Angela substitue une déontologie sincère, un poil rigide dans son obsession à agir selon les règles. Mais c'est là, dans ce que l'on pourrait appeler un code d'honneur dans l'action, que les deux femmes peuvent trouver un terrain d'entente. Comme à la grande époque de ses westerns imprégnés de l'ambiance politique des années 65/75, Corbucci exprime sa défiance instinctive quand aux idéologies comme aux corps constitués, que ce soient ceux de l'état ou de ses adversaires. Comme l'écrivait Jean-Patrick Manchette : « Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique que leurs mobiles soient incomparables, sont les deux mâchoires du même piège à con. ». Un piège à con dans lequel se débattent les couples improbables de Sergio Corbucci. Comme dans les nombreux polars italiens des années soixante-dix, il y a dans Donne armate la violence et les manipulations. Mais au nihilisme rageur, parfois à un fascisme décomplexé, Corbucci substitue la possibilité d'une rédemption, un dialogue débouchant sur l'apaisement malgré la douleur. Cette constante dans les convictions du maestro dans la nature humaine et son regard toujours plein de tendresse amusée pour ses héros force mon respect.
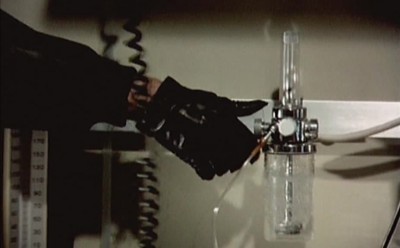
Le film trouve pourtant ses limites dans son format télévisuel. Corbucci dont le travail à partir de la fin des années soixante-dix a été critiqué, parfois à raison, pour sa pauvreté visuelle de téléfilm, travaille pour la première fois pour ce medium. De fait, Donne armate a une photographie réaliste signée Sergio D'Offizi qui a fait un peu de tout (Cannibal holocaust (1980) de Ruggero Deodato) et parfois n'importe quoi. Le film ne possède pas une grande force visuelle, c'est du travail propre. Il y a quelques belles scènes pourtant comme l'ouverture où l'on découvre Nadia dans le jardin de la prison que l'on prendrait pour un asile, avec une chanson lointaine en patois et une atmosphère étrange de temps suspendu. La prison est ensuite filmée avec une belle économie de moyens, comme une idée abstraite de prison. Un couloir, une grille, un son qui résonne. Le récit ensuite est monté de façon linéaire sur un rythme soutenu (montage de Ruggero Mastroianni quand même) mais sur les deux heures trente, il y a bien quelques baisses de régime, peut être atténuées par la diffusion en deux parties. Plus étonnant de la part du réalisateur de Django (1966), la violence est très atténuée. Les scènes d'action sont rapides mais sans éclat, j'allais écrire sans esbroufe, la violence est sèche, elliptique, refusant les effets de suspense que l'on pouvait attendre comme dans la scène de l'hôpital. Un gant noir et clac !

Puisque l'on parle de gant noir, j'évoquais Dario Argento en début de texte et je trouve étonnant les emprunts à un cinéaste si éloigné de l'univers de Sergio Corbucci. Outre ce gant tout à fait argentesque qui fait office de clin d’œil, le plus évident est le choix de Cristina Marsillach que Corbucci avait fait jouer dans I giorni del commissario Ambrosio (1988) après son rôle marquant dans Opéra (1987). Il utilise de la même façon son visage juvénile et innocent comme sa détermination physique. Les deux réalisateurs font passer leurs sentiments à travers des personnages de jeunes femmes. Comme chez Argento, Marsillach incarne un symbole de pureté plongé dans une sombre machination, une sorte d'Alice aux pays des horreurs, horreurs plus prosaïques dans ce film ci que dans ce film là. Sans trop entrer dans les révélations, il y a des similitudes intéressantes entre le final de Donne armate et celui d'Opera quand à la fiabilité de la gent masculine. Il est aussi permis de voir une filiation entre Angela et l'inspectrice Anna Manni qui sera jouée par Asia Argento en 1996 dans La sindrome di Stenldhal (Le syndrome de Stendhal) de Dario Argento, mais je m'avance peut être. Dans le même esprit, Corbucci offre à Donald Pleasence le rôle d'un vieux sage, ami de Nadia, tout à fait dans la lignée de son personnage de Phenomena (1984).
Au final, Donne armate, disponible en DVD italien, hélas sans sous-titres, clôt, sinon en feu d'artifice, du moins très honorablement la belle carrière du maestro. Comme John Ford qu'il a toujours admiré, Sergio Corbucci tire sa révérence avec des femmes admirables qui ont le sens du sacrifice et de l'humour.
20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/08/2014
Un film sur une femme vertueuse
The fan (L'éventail de lady Windemere) de Otto Preminger (1949)
Texte pour les Fiches du Cinéma
Ce n'est pas l'image que je m'en fais, rigueur et relative froideur, mais Otto Preminger à la réflexion est peut être bien un romantique. Un romantique au feu contenu, aux élans canalisés par une mise en scène précise, aux accents sombres et parfois amers, mais un romantique quand même. Nombre de ses films empruntent au mélodrame, fautes enfouies au fond des cœurs, amours rédempteurs, amours impossibles, sacrifices, traumatismes, passions exhalées pouvant mener à la violence, coups de foudres étranges qui se résolvent à la lisière du fantastique. Ce sont aussi des personnages féminins fascinants dans Laura (1944), Daisy Kenyon (1947), ou Forever Amber (Ambre – 1947). Après avoir aidé Ernst Lubitsch malade à terminer That Lady in Ermine (La Dame au manteau d'hermine), Preminger adapte en 1948 la pièce d'Oscar Wilde Lady Windermere's Fan déjà porté à l'écran par Lubitsch en 1925. Oscar Wilde dont la vie de dandy et la plume acérée ne masquent pas sa profonde humanité et sa sensibilité à vif mise à mal par la rigidité de la société victorienne.

L'éventail du titre est un objet chargé d'émotions qui permet de remonter le temps pour découvrir un récit de sacrifice et la révélation du secret d'une grande âme. Le film de Preminger est écrit par rien moins que Walter Reisch qui collabora au scénario du Ninotchka (1939) de Lubitsch et la poétesse Dorothy Parker. L'histoire est décalée dans le temps et c'est après la seconde guerre mondiale que madame Erlynne retrouve l'éventail dans une vente aux enchères d'objets récupérés après les bombardements sur Londres, le Blitz. Pour le récupérer, elle fait appel à lord Darlington qui héberge dans sa vaste demeure de charmantes auxiliaires américaines. Devant ses réticences, madame Erlynne va devoir lui rafraîchir la mémoire en le ramenant au début du siècle. Comme dans Laura, le film est composé de flashbacks qui recomposent le puzzle du récit, moins brillants peut être parce que plus linéaires, mais tout aussi rigoureux et toujours très imaginatifs dans les transitions entre passé et présent.
La belle et jeune lady Windermere aime sincèrement son charmant mari mais ne peut empêcher ce dernier de nourrir des soupçons à son égard à la veille de son anniversaire. Il est pourtant bien cachottier le lord, lui qui entretient la mystérieuse madame Erlynne suite à un curieux arrangement. Bientôt le doute et le mensonge vont miner le couple. Au point que lady Windermere se laisserait bien fléchir par la cour de lord Darlington, un séducteur redoutable qui est aussi le meilleur ami de son époux. L'éventail,le fameux éventail, cadeau du lord à la lady, va cristalliser le danger sur le couple et résoudre, avec quelle élégance, la crise.
Soupçons, mensonges, secrets, amours mal contenus, hypocrisies, tout ce qui fait le miel de Wilde comme de Preminger. The fan est un film à la forme raffinée, costumes, décors, photographie en noir et blanc soyeux de Joseph LaShelle, un ténor, où tout se joue dans les regards, les gestes esquissés, les expressions fugaces, sous le brillant dialogue venu du théâtre. C'est une succession de joutes verbales où la vérité des personnages est entre les mots, eux qui ont tant de mal à exprimer les sentiments. Les choses les plus simples se compliquent dangereusement dans une société de paraître, proustienne, accaparée par des rituels aristocratiques, bals, visites, courses et cancans, et minée par des valeurs désuètes. Le mariage, cible favorite de Wilde qui semble bien partagée par Preminger, ne protège pas l'amour vrai des époux Windermere. Son altruisme, un peu troublé, ne protège pas plus le lord, et il faut la force de caractère peu commune de madame Erlynne ou le dandysme un rien cynique de Lord Darlington pour maîtriser les choses.
Preminger orchestre ce ballet des sentiments en virtuose, pesant chaque réplique, chaque plan. Il fait naître l'émotion sous la sophistication et le texte théâtral, mettant en valeur le jeu de comédiens plutôt sublimes : Richard Greene (Windermere), Madeleine Carroll en madame Erlynne, Jeanne Crain en lady Windermere qui offre quelques magnifiques gros plans sensuels et, parfait dans un rôle qui lui sied comme un gant, George Sanders en lord Darlington, plein de morgue et de vérité. Le réalisateur est attentif aux points de rupture et traque le moindre frémissement, comme dans la très belle scène de dispute entre les époux où, après un passage heureux filmé large, il resserre petit à petit les cadres après le réveil nocturne de la lady minée par le doute, au fur et à mesure qu'elle apprend la relation entre son mari et madame Erlynne. Preminger manie également un humour satirique avec le personnage de duchesse de Berwick (délicieuse scène de l'essai des chaussures), et à travers le principe des flashback, une certaine mélancolie. Le couple Windermere a péri dans les bombardements. Madame Erlynne et Lord Darlington, qui ont su taire leurs sentiments envers la lady, se retrouvent, l'une obligeant l'autre à se souvenir jusqu'à ce qu'il reconnaisse la valeur de cette mémoire. Et les deux vieillards de s'éloigner, complices.
Peu estimé, y compris chez les admirateurs d'Otto Preminger, le film est sortit tardivement en France et mérite l'attention. Seul bémol à la sortie de cette rareté dans la collection Hollywood Classics, il s'agit de la version courte de 76 minutes. Il en manque une bonne dizaine.
Photographies 20th Century Fox
22:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto preminger | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/08/2014
1969 (Quand parle la poudre)
C'est partit pour un retour en 1969 sur Zoom Arrière avec un éditorial ébouriffant de Frédérique. Sacrée belle année de cinéma dans les salles françaises pour clore la décennie. Il y a en ce qui me concerne une demi-douzaine de films de chevet, signés Truffaut, Leone, Peckinpah, Edwards, Corbucci ou Molinaro, et un cinéma venu des quatre coins du monde qui offre des œuvres majeures des cinéastes Rocha, Rohmer, Tarkovski, Costa-Gavras, Bunuel, Fischer, Ferreri, De Toth, sans compter tous ceux que je n'ai pas vus mais dont mes camarades disent tant de bien.
Ce qui me frappe pourtant, c'est l’impressionnante concentration, façon feu d'artifice, de westerns de haut vol. Le western à l'italienne offre aux français une sorte de bouquet final par le jeu du hasard des dates de sortie. Nous verrons donc, concentrés sur douze mois, l'aboutissement des œuvres des trois Sergio, Leone, Corbucci et Sollima. Le premier donne son film le plus ambitieux et rend hommage à John Ford en filmant quelques plans à Monument Valley même tout en pervertissant l'image des yeux bleus du "all american" Henry Fonda. Le second va au bout de sa veine nihiliste et sarcastique avec l'aide d'un Jean-Louis Trintignant aussi mutique qu'il était bavard à Clermont-Ferrand. Le troisième concentre sur les écrans sa trilogie politique avec Tomas Milian, royal en paysan frustre, rebelle et débrouillard. Derrière eux, comme l'écume, plusieurs films de belle tenue qui témoignent de la vitalité d'un cinéma de genre sur le point d'entrer en décadence.
Et, comme un passage de témoin, aux États-Unis, Sam Peckinpah remis de ses déboires avec les producteurs, peut réaliser avec The wild Bunch, le film du grand retour du western au pays natal. Clôturant dans le sang et la poudre des années soixante déprimantes, il reprend le genre là où l'avait laissé Ford dans The man who shot Liberty Valance (1962) et y intègre tout ce qui est né de formel du passage en Europe en y réinjectant le regard moral et humaniste des grands classiques américains. L'hommage à Ford ne passe pas comme chez Leone par le symbole mais par un état d'esprit. Dit autrement, ses Deke Thornton et Pike Bishop sont de la même trempe que Tom Doniphon et ce dernier, quand il s'efface, pourrait bien être partit pour le Mexique. Ce faisant, le grand Sam ouvre la porte à un nouveau western américain qui donnera de belles choses dans les années soixante-dix. Comme un échauffement, Sydney Pollack trousse un aimable Scalphunters.







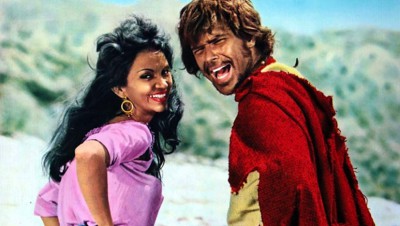
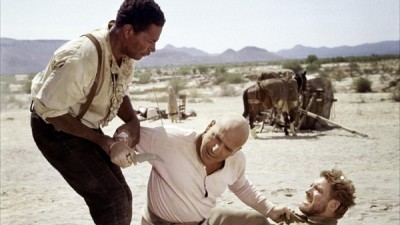
Photographies DR
16:48 Publié dans Blog, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio léone, sergio sollima, sergio corbucci, sydney pollack, giuseppe colizzi | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/08/2014
"Just whistle" : Lauren Bacall
09:42 Publié dans Actrices, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : lauren bacall | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/08/2014
En vacances !

13:38 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/07/2014
En première page
Park Row (Violences à Park Row) de Samuel Fuller (1952)
Texte pour Les Fiches du Cinéma
Dans une première vie, Samuel Fuller travailla dans la presse. A douze ans, il est copy-boy, à dix-sept, il est reporter criminel pour le New York Evening Graphic. Il passe ensuite à l'écriture en tant que scénariste et romancier avant de s'engager dans la fameuse Big Red One pendant la seconde guerre mondiale. C'est avec une caméra 16 mm qu'il participe à la libération du camp de concentration de Falkenau. Le soldat laissera place au cinéaste à la fin des années quarante. De sa première expérience, son cinéma gardera l'empreinte par ses côtés documentés, la concision de son style et quelque chose de l'ordre de la conviction. Pour Samuel Fuller, le journaliste est un héros, un homme engagé dont la voix porte un idéal. Du moins, il devrait. Il devrait s'inscrire dans une longue lignée d'hommes enthousiastes, John Peter Zenger, Benjamin Franklin, Horace Greeley, James Gordon Bennett ou Joseph Pulitzer, hérauts d'une presse libre. Et américaine. Pour célébrer cet idéal, Fuller finance, produit, écrit et réalise un poème épique, enflammé et violent, Park Row en 1952. Il a pour cela refusé l'offre de Darryl F. Zanuck avec à la clef un gros budget, le Technicolor et Gregory Peck. Il reprend Gene Evans qu'il vient de diriger dans Fixed Bayonets ! (Baïonnette au canon) et tourne très vite, 10 jours à l'énergie, pour un tout petit budget. Le film sera un échec mais, comme John Ford qui aimait mettre en avant ses « petits films » très personnels, Fuller le citera toujours comme son préféré.

Park row est une rue de New-York, près de Wall Street, où étaient installés au XIXe siècle les grands journaux, veillés par la statue de Benjamin Franklin. C'était un âge d'or de la presse écrite dynamique et foisonnante, bien avant la radio, la télévision sans parler d'Internet. Sur Park Row naissent et meurent les quotidiens qui tirent plusieurs éditions par jour, se livrant à une lutte acharnée à coup d'idées et de phrases assassines, parfois aussi avec une violence plus concrète qui peut rappeler les agissements des bandes de gangsters. 1886. Ce chaudron bouillonnant, Samuel Fuller, enflammé par son sujet, y plonge en avec une caméra fiévreuse en longs mouvements aériens et voluptueux le long des immeubles. Il pénètre les bureaux de rédaction, les imprimeries et ce bar où se réunit tout le petit peuple de la presse, éditorialistes, reporters, typographistes, caricaturistes, là où s'échangent les informations et où naissent les articles. Les images signées John L. Russel (Le directeur de la photographie inspiré du Macbeth (1948) d'Orson Welles et du Psycho (1960) d'Alfred Hitchcock) et les ambiances sont d'un noir d'encre et de polar, d'un blanc rustre de papier journal, ce papier vital qui peut être papier de boucherie sous le poids de la nécessité. Les plans sont saturés de personnages croqués à grands traits et d'action. Le mouvement avant tout. La fièvre encore.
Un soir, Phineas Mitchell, qui vient de se faire virer du Star, met son rêve à l'épreuve et crée le Globe. Fuller le suit dans ce projet fou qui cherche à retrouver l'esprit des grands anciens. Mitchell va se heurter à son ancien employeur et désormais rival, la belle Charity Hackett . Main de fer dans un gant de dentelle, Charity la bien mal nommée, est une héritière qui a la puissance financière mais pas le feu sacré. C'est par contre un sacré personnage, femme forte et autoritaire dans un univers masculin, comme le sera Jessica Drummond en 1957 dans Forty guns (Quarante tueurs). Elle rend passionnant son duel avec Mitchell d'autant que Fuller ne recule pas devant un rien de romance. Il a le bon goût de s'en tenir à la lisière, mettant le jeu de séduction en avant comme arme, laissant deviner les sentiments plus profonds, et contradictoires, qui assaillent les rivaux. Mary Welch, dont c'est hélas le seul film, campe une Charity Hackett fascinante dont on ressent les failles sous le masque, manipulatrice, impitoyable mais humaine en dernier ressort, érotique aussi à sa façon. Je suis conquis.

Face à elle, Gene Evans donne densité à un Phineas Mitchell d'un bloc, concentré de rigueur et de talent, évoquant le Charles Foster Kane des débuts dans le film de Welles, annonçant le Dutton Peabody courageux de The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance– 1962) de John Ford. L’héritage de Mitchell est celui d'une tradition de grand journalistes. Pourtant Fuller ne fait pas du Globe un grand journal d'investigation comme le Day mis en scène par Richard Brooks la même année dans le superbe Deadline U.S.A. (Bas les masques). Mitchell ne se bat pas pour une grande cause, mais démarre sur l'histoire d'un homme qui saute du Brooklyn Bridge, puis lance une souscription pour payer le socle de la statue de liberté. Joli symbole. Ce sont pourtant des sujets qui apparaissent bien légers mais qui, du coup, ne parasitent pas le fond du film, le principe d'indépendance.
N'ayant pas peur d'en rajouter, le scénario rajoute une réflexion sur l'évolution technologique avec le savoureux personnage (authentique) de Ottmar Mergenthaler, qui invente la linotype destinée à remplacer la composition manuelle (effectuée avec dextérité dans le film par un italien qui ne sait pas lire!). Cette invention capitale sera un enjeu de plus dans la lutte entre Hackett et Mitchell. Park Row s'en tient à une déclaration de principes et trouve sa richesse dans le portrait vivant de tout ce petit monde de la presse, dans le travail au quotidien de tous les rouages. Trouver le papier, manipuler les caractères, plonger les mains dans l'encre, organiser la diffusion, sont aussi importants que le fond des articles. François Truffaut montrera le travail de cinéma de la même façon vingt ans plus tard. Le parallèle est d'ailleurs limpide et si Fuller cède à un rien de nostalgie en faisant son autoportrait en jeune copy-boy avec le personnage de Rusty, il s'imagine en Mitchell, avec qui il partage le goût des gros cigares, dans les jeux de pouvoir hollywoodiens. Rapide et rythmé, Park row file comme un récit de passionné avec d’impressionnantes bouffées de violences typiques de l'auteur quand les choses s'emballent et que Mitchell fait jouer ses poings. Poème noir aux doigts d'encre, Park row est un Fuller essentiel.
Photographies : United Artist
A lire sur Critikat
A lire chez Shangols
A lire sur the Guardian (en anglais)
A lire sur Brightlightsfilms (en anglais)
Par Jonathan Rosenblaum (en anglais)
16:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel fuller | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/07/2014
Les joies du bain : celle qui doit être obéie
Aimablement transmise par FredMJG (qui prend courageusement sur son temps libre) voici la belle actrice tchécoslovaque Olga Schoberová dans le bain et le double rôle de Carol et Ayesha, la divine héroïne imaginée par Sir Rider Haggard, She, celle qui doit être obéie. La débutante Olga remplaçait au pied levé la non moins belle Ursula Andress, vedette d'un premier film produit par la Hammer en 1965. Cette suite directe, The vengeance of She (La déesse des sables - 1968), signée Clive Owen ne rencontra pas le même succès. Pour ce qui est du bain, Olga était pourtant moins farouche qu'Ursula. Photographie DR.

20:06 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/07/2014
Lectures pour tous
L'évènement du mois, c'est sans conteste, sa modestie dû-elle en souffrir, la grande fête virtuelle des 10 ans du journal cinéma du bon Docteur Orlof que je m'obstine à appeler Pierrot pour des raisons nostalgiques, alors qu'il s'appelle Vincent comme toutes les âmes bien nées. Nos blogs ont une histoire parallèle, mais j'y reviendrais en novembre. Tout juillet, peut être au-delà, la blogosphère, la twitosphère, la face de boucosphère et les gens normaux qui lisent encore du papier célèbrent en mots et en images l'anniversaire d'un bastion cinéphile de haute tenue. J'y serais, je n'aurais manqué cela pour rien au monde.
Autre plume remarquable en son genre, l'ami Mariaque, le Capt'ain d'Abordages, revient avec Mancheck sous tirée "l’addition pourrait être salée", où il propose une très agréable forme de journal cinéphile, sur les traces de celui de Manchette, JP. Dommage que l'on ne puisse pas commenter, je lui exprime ici tout le plaisir que j'ai à le suivre.
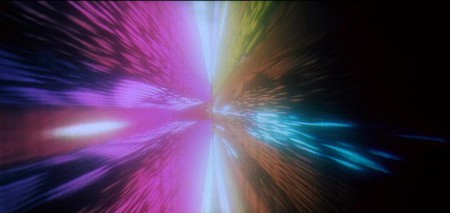
Après 1967 sur lequel j'ai quelque peu fait l'impasse (pardon, pardon), Zoom Arrière se penche sur l'année 1968. Sous les pavés, les films, et de belles choses, la tête dans les étoiles. Bientôt 1969, sacrée année où j'ai repéré pas moins de six films potentiellement au sommet en ce qui me concerne. Encore des choix déchirants alors qu'il fait si chaud. Ce n'est pas humain. A lire en complément la note fleuve avec plein de photographies de FredMJG dont les goûts pour le vrai cinéma qui sent la poudre du côté d'Alméria m’emplit le cœur d'envies révolutionnaires, adelante ! Et puis merci pour m'avoir mis sous les yeux les films de Glauber Rocha.
Édouard de Nightswiming (en pause) et de Nage nocturne (en action) intègre l'équipe DVD des Fiches du Cinéma et entre en fanfare avec un bel article sur le coffret "Jean Epstein, poèmes bretons".
Sur ce, je vais peut être me remettre au travail...
Photographie : MGM
23:10 Publié dans Revue des popotes | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : blogs | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/07/2014
Petits carnets cannois (3)
La haut sur la montagne
« […] et ce côté sursignifié (l'horreur de la vie moderne, la technologie, internet, les téléphones mobiles, la mondialisation, aliénation et incommunicabilité… bla bla ou cui cui, je sais plus ». cette phrase de Buster sur Balloonatic à propos d'un autre film correspond tout à fait à mon sentiment d'agacement à la vision de Sils Maria d'Olivier Assayas. Inutile de dépenser beaucoup plus d'énergie pour ce film. Juliette Binoche incarne Maria Enders, une grande artiste dans la quarantaine qui doit rejouer dans la pièce qui la rendit célèbre à vingt ans. Dans cette pièce, une femme de quarante ans est dévorée de passion pour une jeune femme de vingt. Elle s'est révélée dans le rôle de la seconde, elle doit désormais affronter celui de la première. Rapport entre l'actrice et l'âge, entre le théâtre et la vie, avec le cinéma derrière. Le sujet est beau même s'il a déjà été abordé avec talent (esprit de Bergman, est-tu là?). Mais Olivier Assayas filme comme il écrivait et étouffe son film sous une mise en scène très en avant, pleine d'effets de style (montage sec, ruptures brutales, effets de reflets, caméra très (trop) mobile, sérieux papal). C'est tour à tour agaçant, lassant, désespérant. Le réalisateur reste à la surface des choses en enfilant une collection de clichés (inévitable vomissement). Une jolie scène rafraîchissante : Caméra quasi fixe. Binoche et Kristen Stewart qui joue la secrétaire – confidente de Maria, se jettent dans un lac de montagne. A leurs cris authentiques on devine que l'eau était vraiment froide.

Afrique
Il y a un monde entre Olivier Assayas et le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako. Un monde et une conception du cinéma. Timbuktu est une œuvre d'une grande force et d'une grande beauté. D'une simplicité d'accès qui nous fait pénétrer en douceur, mais avec fermeté, dans la complexité d'une situation tragique. Le film évoque la prise de Tombouctou par les milices islamistes et le bouleversement de la vie quotidienne des habitants qui se voient imposer la charia de façon aussi stupide que cruelle. Timbuktu est un film qui ouvre des portes. Sissako fait le pari que l'émanation d'une culture particulière, ici Africaine, exprime quelque chose d'universel via des valeurs partagées par tout être humain, l'amour (sous plusieurs formes), la foi, l'art et l'aspiration au bonheur. Hélas, la bêtise alliée à la brutalité sont de redoutables ennemis de ces valeurs. Le film de Sissako suit le destin de Kidane, éleveur de vaches dans les dunes, qui vit paisiblement entre sa femme aimante et sa fille adorable. Une famille idéale qui est dépeinte avec une économie de moyens, gestes simples, paroles rares et regards justes. L'harmonie est ressentie plus que démontrée. La rupture de cette harmonie ne viendra pas comme on peut s'y attendre de l'ingérence extérieure, mais d'une faille de Kidane, de ce qu'il porte encore en lui de violence et de trop grande confiance en lui. Pour tout dire, ce sera une histoire de vache appelée GPS et de voisinage difficile.
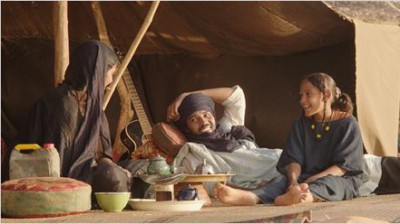
Entre temps, Sissako nous fait découvrir une large galerie de portraits, mosaïque humaine qui compose un portrait global des oppressés comme des oppresseurs. Côté islamistes, le réalisateur met en avant les côtés humains et les motivations prosaïques, sachant utiliser un humour absurde qui peut virer au noir. Il y a ce milicien qui fume en cachette et est amoureux de la femme de Kidane, il y a son jeune chauffeur qui l'a percé à jour mais laisse faire, il y a ce jeune homme bêta qui tente d’enregistrer un message vidéo menaçant (une scène très drôle), et puis les autres, désœuvrés, peu convaincu, mais qui seront, c'est le point terrible, les bras et les armes de la violence la plus abjecte. Face à eux, il y a ce très beau personnage de la femme aux tissus qui tient tête aux islamistes avec sa folie de façade, il y a ces enfants qui jouent au football sans ballon (c'est interdit!), il y a cette poissonnière qui ne veut pas porter de gants au marché (ce n'est pas pratique), il y a ces musiciens qui se cachent pour jouer et dont la chanteuse est jouée par la malienne Fatoumata Diawara. Entre les deux, il y a un saint homme modéré, figure de l'équilibre qui défend l'islam de tolérance.
Peut être que le film aurait gagné a ne pas tant vouloir étreindre. Il y a un côté systématique chez Sissako qui semble vouloir passer en revue tous les aspects de son sujet. Certaines scènes comme l'ouverture avec l'enlèvement d'un occidental, ne sont pas intégrées au reste du récit. La scène de la lapidation, moment glaçant, arrive de façon abrupte. Par l'absence de point de vue à l'intérieur du film, elle fonctionne plus comme une scène choc que comme élément dramatique.
Mais la force de l'ensemble, l'aisance dans les ruptures de ton et le jeu très vivant de l'ensemble des acteurs, emporte l'adhésion. D'un point de vue formel, Timbuktu est d'une grande beauté. La photographie du tunisien Sofian El Fani qui a travaillé sur les deux derniers films d'Abdellatif Kechiche, est une splendeur qui rend les teintes chaudes des murs de terre, la finesse des étendues de sable, la richesse des couleurs des vêtements, opposée bien sûr au noir et terne des islamistes. Les femmes sont photographiées avec passion, avec cette sensualité africaine un peu alanguie, la plus belle des réponses aux intégrismes.
Photographies : DR Télérama et © Le Pacte
10:41 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2014, abderrahmane sissako, olivier assayas | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/06/2014
Adios, Tuco

Eli Wallach 1915 - 2014
"Le monde se divise en deux catégories..."
08:24 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
22/06/2014
Petits carnets cannois (2)
Irlande
Avec Jimmy's hall, Ken Loach revient à son meilleur. Si ce doit être son dernier film, comme il l'a annoncé, ce serait une belle conclusion à sa filmographie. Loach n'a rien perdu de sa verve militante, ce que ne manqueront pas de lui reprocher ses détracteurs habituels, ni de ce rien de naïveté qui fait tout son charme et l'amène à conserver vivante la flamme de l'espoir au terme de récits de défaites. Les hommes tombent mais cette flamme se transmet. Il me semble surtout que de situer ses histoires dans le passé oblige le réalisateur à travailler plus sa mise en scène, à trouver des solutions cinématographiques pour la reconstitution, pour rendre vivante l'époque utilisée. Il y a une richesse visuelle dans Land and freedom (1995) ou The wind that shakes the barley (Le vent se lève – 2006) absente des contemporains Looking for Éric (2009) ou Bread and roses (2000). Avec Jimmy's hall, nous sommes dans l'Irlande des années trente pour suivre l'expérience collective de Jimmy Gralton qui ouvre à travers un danging en pleine campagne un lieu d'éducation populaire, de culture et de militantisme. Une sorte de MJC alternative quoi. Il se heurte sans surprise aux puissants, l'église en premier lieu, suivie de l'IRA et des gros propriétaires, alliance du sabre, du goupillon et de l'argent. Loach intègre en filigrane un discours sur le fondamentalisme religieux valable pour les intégristes de tout poil et de toutes convictions. Il synthétise avec ce récit l'essence de son combat et cela fonctionne plutôt bien. D'abord parce que Jimmy, incarné par Barry Ward, est un porte parole idéal et idéalisé qui ramène à de prestigieux modèles comme le Tom Joad de Henry Fonda, ensuite parce que le film est porté par un souffle, un rythme assuré qui emballe le discours dans un grand mouvement. Il y a aussi la belle photographie de Robbie Ryan, la musique de l'inamovible George Fenton, la beauté de Simone Kirby et l'énergie d'une troupe d'acteurs irlandais homogènes et enthousiasmants. Comme dans Land and freedom qui reste pour moi son chef-d'œuvre, Loach sait rendre dynamique les échanges au sein d'un groupe, l'intelligence et la soif de savoir collectives. Loach soigne également quelques personnages mémorables comme ce prêtre progressiste ou la mère fordienne de Jimmy, et donne de belles scènes comme la danse nocturne où la scène finale où les jeunes du village accompagnent Jimmy emmené par la police en exil. Une fin loachienne au possible. Naïve et sincère, musicale et intense.

Vive Takahata !
Belle occasion manquée pour le festival de mettre en avant Isao Takahata, compagnon de route de Hayao Miyazaki avec lequel il fonda dans les années 80 le studio Ghibli. Kaguya-hime no monogatari (Le Conte de la princesse Kaguya – 2013), film d'animation que son auteur annonce comme son dernier (quelle épidémie !), a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs quand la sélection officielle présentait hors compétition Dragon 2. L'écart entre ces deux films est tel qu'il se passe de commentaire. Restons donc à un niveau acceptable et risquons la comparaison entre Takahata et, disons, Alain Resnais. De Cello hiki no Gōshu (Gōshu le violoncelliste – 1982) à Pompoko (1994) en passant par Hotaru no haka (Le tombeau des lucioles – 1988), Isao Takahata aura fait des films très différents, se lançant des défis formels toujours renouvelés tout en gardant un ton propre. Il mêle avec bonheur des éléments intellectuels (adaptations littéraires, calligraphie, peinture traditionnelle, philosophie, musique, religion...) avec des formes populaires (le manga, le burlesque, la caricature, le fantastique). Takahata sait aborder les convulsions les plus douloureuses de son temps sans se départir d'une étrange douceur, sans sacrifier ni à la poésie, ni à l'humour. Il a vu, lui, quelque chose à Hiroshima. Un maître, dis-je.
Kaguya-hime no monogatari est une nouvelle démonstration éclatante de son art. Inspiré d'un conte traditionnel Le Conte du coupeur de bambou, le film suit la destinée d'une petite princesse recueillie par un couple de paysans, grandissant à une vitesse surhumaine au sein d'une vie simple et naturelle. Kaguya va être victime des ambitions de son père, lui-même victime d'un système social féodal rigide. Le brave homme aimant sincèrement l'enfant cherche à faire son bonheur selon les normes de pensée en vigueur et va donc chercher à lui trouver un riche et puissant époux, sollicitant les grands du royaume et jusqu'à l'empereur lui-même. Ce faisant, il la coupe de ses racines et de cette vie simple où elle a rencontré un aimable jeune paysan, amenant le malheur et le drame. Récit initiatique, conte moral, réflexion sur la destinée humaine, je ne puis lire ce film qu'à travers ma culture occidentale, celle des contes de Grimm ou d'Andersen, et je n'ai donc que des intuitions sur la relation que l'œuvre entretien, relation profonde sans doute, avec les religions japonaises, le shintoïsme et le bouddhisme, le cycle de la vie et la réincarnation en particulier. Mais la spiritualité du film émane de ses images, du finale impressionnant dont la dernière image renvoie au 2001 de Stanley Kubrick. Un dernier plan qui, si Takahata a dit vrai, sera une pièce de choix pour la collection de Buster.

Visuellement, Kaguya-hime no monogatari est une splendeur graphique incroyable, un grand coup d'air frais dans notre ère de numérique criard. Équilibre des compositions, beauté des estampes classiques, infinie délicatesse des pastels, formes plus ludiques venues des mangas, simplicité expressive des traits, le film ose l'hétérogénéité justifiée par les tonalités émotionnelles du récit. Là où Miyazaki est mouvement, Takahata est souvent plus contemplatif, parfois immobile pour laisser le spectateur se pénétrer de la beauté d'un plan, de l'harmonie d'une image. Il joue aussi en virtuose des variations de lumière via la couleur et sait à l'occasion utiliser le mouvement comme dans cette scène du cauchemar de la princesse. Joe Hisaishi, précieux partenaire, offre une nouvelle partition dont la faculté de renouvellement n'inspire que le plus profond respect.
Photographies © Sixteen Filmset Ghibli.
16:33 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cannes 2014, isao takahata, ken loach | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/06/2014
Petits carnets cannois (1)
Pour une poignée de films
Cannes pendant un dizaine de jours est le plus bel endroit du monde pour voir des films. Le plus beau et le pire. Année après année, festival après festival, je me retrouve face à cette contradiction et je n'en suis pas à une près. Parfois cela se passe bien, parfois moins. D'un côté, il y a cette incroyable diversité, les films rares, la présence des équipes anxieuses venues des quatre coins du monde, la qualité des projections dans des salles où le cinéma est encore considéré comme un art et non comme un produit d'appel pour vendre des confiseries. Cela devient l'exception. D'un autre côté, il y a tout ce déballage de camelot, ce luxe omniprésent et parfois arrogant qui parade devant les écrans où s'ausculte toute la misère du monde. Les braves gens ! Il y a cette organisation pesante cultivant la paranoïa, le culte du contrôle et la hiérarchisation quand les films célèbrent la liberté et la révolte. Il y a ces files interminables pour des films qui ne réuniront jamais autant de spectateurs dans toute leur carrière commerciale. Réjouissant, irritant, c'est Cannes.

Ouaf
Fehér isten (White God) du hongrois Kornél Mundruczó est le mélange improbable de The lady and the tramp (La belle et le clochard – 1955) produit par Walt Disney, de Willard (1971) de Daniel Mann, de The great escape (La grande évasion - 1962) de John Sturges et du conte du joueur de flûte de Hamelin. Le héros en est un chien que l'on sépare de sa jeune maîtresse bien aimée. Quelques péripéties plus tard, traqué par la fourrière et promis à l'euthanasie, le toutou organise la fuite des pensionnaires du chenil. Déterminé, il conduit la horde canine et sauvage à travers la ville, submergeant la police et organisant sa vengeance. C'est très réussi malgré quelques baisses de rythme ici où là. Kornél Mundruczó met en scène son conte avec une invention constante et un premier degré assumé qui ne fait pas le malin avec son histoire, tout en conservant cette pointe ironique propre aux cinémas d'Europe de l'Est ce qui laisse la possibilité d'une lecture au second degré jouissive. Le film est tour à tour poétique (le finale, superbe), lyrique (la course de la horde), haletant (la traque, successions de scènes impressionnantes dont le montage inspire le respect), social (c'est ancré dans une réalité très prosaïque), sachant jouer avec un suspense un poil fantastique (l'ombre du chien sur le mur à la Tourneur) et un soupçon d'humour. Joli dosage. Le travail avec les chiens laisse la langue pendante d'autant qu'il ne semble pas y avoir d'effets numériques. Prix de la section Un certain regard.

Ouest poussif
Il est douloureux pour l'amateur de western que je suis de n'en voir sortir qu'un ou deux par an et de les trouver ratés. The homesman, le film de Tommy Lee Jones est d'autant plus agaçant qu'il avait un fort potentiel. Une histoire où une courageuse fermière doit convoyer trois femmes devenues folles à travers les étendues sauvages et désolées du territoire du Nebraska des années 1850. Elle embarque pour l'aider un ex-soldat qu'elle a sauvé de la pendaison. Le couple que Jones forme avec l'excellente Hilary Swank fonctionne bien et aurait pu marcher dans les pas de celui d'African Queen (1951) de John Huston dont on peut toujours rêver, en vain, de ce qu'il aurait pu tirer de tout ceci. Le couple, la folie, l'aventure, l'ironie... Las ! Tommy Lee Jones qui a écrit le scénario avec Kieran Fitzgerald et Wesley A. Oliver, part dans tous les sens sans rien aboutir. Il multiplie les incohérences. Exemple : Sur ce territoire, les femmes grattent durement la terre (c'est le premier plan du film). Le personnage joué par Hillary Swank a un superbe ranch, du bétail et des terres (c'est son argument pour tenter de convaincre un homme de l'épouser). Pourtant elle est seule et un monde la sépare de ses malheureuses voisines qui vivent en famille. Le western a déjà montré des femmes aux beaux domaines mais elles avaient quarante cow-boys à leurs ordres ou, comme Joan Crawford chez Ray ou Claudia Cardinale chez Leone, elle avaient payé de leur personne. Il y en a d'autres. La mise en scène est tout aussi confuse. Pour traiter de la folie, Jones multiplie inutilement des flashback que l'on croiraient imaginés par Michael Haneke. Sinon il y a de la belle image mais pas de poésie. Une scène tente de marcher sur les traces de Clint Eastwood sans que ni l'acteur ni le réalisateur aient la carrure. Le coup de force scénaristique du second tiers dont je ne révélerait rien par charité abasourdit et achève le film qui préfère l’esbroufe au style, l'effet au souffle. Dommage, trois fois dommage. Et par pitié que l'on ne vienne pas me parle de « féminisme ».

Photographies : Festival de Cannes
10:54 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cannes 2014, tommy lee jones, kornél mundruczó | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/06/2014
Bande annonce
Magnifique bande annonce composée d'extraits de tournage du premier volet Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964) pour la ressortie des trois westerns du maestro Sergio Leone avec Clint Eastwood. Un document pour l"histoire. A noter le titre de tournage : Il magnifico straniero.
14:22 Publié dans Curiosité, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sergio léone | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |