08/12/2010
Godard - Portraits
Le Corbucci - Godard blogathon
Joachim prend le relais avec une belle note sur 365 jours ouvrables qui nous livre la minute où Godard nous dit pourquoi on va au cinéma. Je me suis décidé à voir, enfin, Sauve qui peut (la vie) (1979) mais le temps m'est par trop compté aussi je m'en tiendrais à ma programmation initiale. Voici quelques portraits de Godard et une curiosité, une publicité des années 70 pour un après-rasage réalisé par le groupe Dziga Vertov.
Par Gérard Courant (série Cinématon 1981)
Par Wim Wenders (Room 666 - 1982)
Par lui même JLG/JLG, portrait de décembre (1994)
06:15 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard, gérard courant, wim wenders | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2010
L'adieu aux armes de Sergio Corbucci
Le Corbucci - Godard blogathon
Le bon Dr Orlof décidément inspiré par JLG propose une cinquième note autour de la relation particulière de Godard avec la télévision ou comment il la critique de l'intérieur.
De tous les westerns réalisés par Sergio Corbucci, son dernier en 1974, Il bianco, il giallo, il nero (Le blanc, le jaune et le noir) a la plus mauvaise réputation. Rien ne serait à sauver de cet adieu au genre auquel on reproche son manque d'imagination, de rythme, ses concessions à la mode déjà déclinante du western comique, le cabotinage de Tomas Milian et surtout, un humour raz des pâquerettes assaisonné d'une dose de vulgarité.
Mouais. Autant avouer de suite que j'ai pris beaucoup de plaisir à ce film, que j'y ai ri de bon cœur et sans remords, voire même avec une certaine jubilation comme on dit chez Télérama. Il est facile de comprendre la déception des admirateurs des contes cruels de Django (1966) ou Il grande silenzio (Le grand silence – 1968), et de ceux qui avaient aimé les aventures colorées de Il mercenario (Le mercenaire – 1968) ou Companeros ! (1970). Mais si l'on remet Il bianco, il giallo, il nero en perspective dans la carrière de Sergio Corbucci, au-delà du western, on pourra mieux lui faire une place et comprendre son importance. Mieux, ce film est passionnant pour explorer l'essence du cinéma de son auteur tant il est à la fois un bilan, un manifeste (parodique) et une ouverture. Il permet aussi de bien situer où se trouve le malentendu avec Corbucci, les raison parfois (mais pas toujours) justifiées pour le sous-estimer.

Il bianco, i giallo, il nero suit les aventures picaresques d'un improbable trio : l'intègre shérif Black Jack joué par Eli Wallach, le truand sympathique et athlétique d'origine suisse Blanc de Blanc joué par Giuliano Gemma, et le serviteur japonais apprenti samouraï Sakura joué par Tomas Milian. Tous les trois recherchent un poney sacré enlevé par de faux indiens et se disputent une bonne vieille malle pleine de dollars. L'argument, co-écrit avec pas moins de six scénaristes vaut ce qu'il vaut, c'est à dire pas grand chose. Mais il a donné déjà de bon résultats. On voit que Corbucci joue avec deux idées classiques : une parodie inspirée de Soleil rouge (1971), western de Terence Young avec Alain Delon, Charles Bronson et Toshiro Mifune en samouraï, et évidemment celle du trio lancé à la chasse au trésor dans le classique de Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo (Le bon, la brute et le truand – 1966) auquel le titre fait clairement référence.
Souvent surnommé « L'autre Sergio », Corbucci s'est amusé avec dérision de son rapport avec Leone. On se souvient du personnage joué par Tomas Milian déclarant dans La banda J.S. (Far west story - 1972) « Celui qui a inventé les spaghettis, c'était un génie et il a du se faire de l'argent » en dévorant un plat de pâtes. Leone qui a toujours eu une haute estime de lui-même disait des westerns italiens « On m'avait désigné comme le père du genre ! Je n'avais eu que des enfants tarés. ». Mais Corbucci était passé à l'acte avant lui avec Massacro al Grande Canyon (Massacre au grand canyon – 1964) sortit trois mois avant le, il est vrai mythique, Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars). Les deux hommes se connaissaient bien, ont travaillé ensemble vers 1959 et tourné côte à côte dans le désert d'Alméria. Face au succès et à la reconnaissance acquise par Leone, Corbucci peut parodier son film fétiche avec l'emblématique interprète de Tuco et faire dire à l'un de ses personnages « ...vergognati di fare vivere i tuoi bambini come dei barboni. Leone, questo devi diventare... » Barboni signifiant clochards mais étant aussi le patronyme d'Enzo Barboni, réalisateur des films de Trinità, tandis que « Tu devrais devenir un Leone/lion » est explicite. Plus largement, Il bianco, i giallo, il nero passe à la moulinette dix ans de western all'italiana. La première scène, savoureuse, voit la femme de Black Jack lui passer un savon en règle, lui reprochant une vie ratée. Le long monologue est constitué de titres de westerns italiens et autres fines allusions que le shérif écoute stoïquement avant de lancer « Ma ché c'entriamo noi, con la rivoluzione ? », titre originale du film précédent de Corbucci. L'effet comique est renforcé du fait que d'habitude, les personnages d'Eli Wallach sont ceux qui agonisent les autres de paroles.
La distribution va dans le même sens. Wallach c'est Leone, mais aussi tous les acteurs hollywoodiens venus trouver un second souffle en Europe. Giuliano Gemma incarne le western italien première manière, celui des Ringo et autres Arizona Colt, héros décontractés. Milian, c'est le renouvellement apporté par les personnages de mexicains (avec arrière-plan politique) et la tentation de greffer des éléments asiatiques sur un genre qui s'épuise. On peut aussi dire que Wallach incarne la tradition classique, Gemma le héros invincible et Milian la veine parodique. Bref, tout cela se tient, j'ose dire que cela fait sens. Et puisque c'est un adieu, Corbucci reprend aussi nombre de motifs qui ont jalonné sa carrière. Le shérif bien sûr, qu'il aime honnête, courageux et un peu idiot, et Black Jack d'être le digne héritier des personnages joués par Franck Wolf ou Gastone Moschin. Gemma joue un étranger un peu truand comme le polonais et le suédois joués par Franco Nero faisant équipe avec Tony Musante et déjà Milian. On trouvera aussi un Milian enterré jusqu'au cou, un cercueil contenant de l'argent, un cimetière (grand motif corbuccien), une prostituée rousse et une séquence de travestissement bouffonne. Je note un clin d'oeil à Howard Hawks quand, de derrière un muret, Gemma jette de la dynamite pour que Wallach tire dessus. Cet ensemble très référencé, mais sans parasiter l'action, peut dérouter celui qui s'attend à un pur récit, mais devrait réjouir par ce regard posé sur le genre et la réflexion un peu désabusée menée sur la fin d'un cycle.

Le rapport à la comédie est important dans Il bianco, il giallo, il nero. Il faut commencer par rappeler que la comédie est le domaine de prédilection de Sergio Corbucci. Il en a fait avant ses peplums et ses westerns, il en a fait après et même ses films les plus sombres en contiennent une bonne dose. C'est de la comédie italienne, du sud, romaine, maniant l'humour noir, la parodie, le grotesque. D'où peut être malentendu si l'on ne considère cet aspect que comme accessoire alors qu'il me semble central. Corbucci manie le gag dans un esprit très bande dessinée, visuel et immédiat, jouant sur l'anachronisme et les ressorts éternels de la Comédia dell'arte. Blanc de Blanc porte une croix blanche sur son marcel rouge, façon d'arborer sa nationalité suisse. Il file sur la moto d'un démonstrateur ambulant. Plus tard, Black Jack tombe d'un pont tout droit dans la nacelle du side-car que Blanc de Blanc va séparer de l'engin. Plus loin encore, le shérif transforme cette nacelle en une variation du pousse-pousse asiatique qu'il oblige le Suisse à tirer tandis que le japonais court derrière. Ironie et répétition. Un esprit cartoon que l'on retrouve dans les oreilles démesurément allongées de Sakura lors de son sauvetage. Les gags construits sur la distance sont plus laborieux comme le mal de dent de Sakura ou l'évasion.
Reste le fameux gag du pet de Poney qui a traumatisé les commentateurs. Il mérite que l'on s'y attarde car à lire les compte rendus, il y en aurait pléthore. Il y en a deux, bien intégrés à l'intrigue. Au-delà de la finesse de l'idée, certes discutable, son rejet est symptomatique d'une éducation cinéphile. Les codes de représentation dans lesquels nous avons baigné (et baignons toujours largement) aux USA comme en Europe, bannissent nombre de choses liées au corps, le sexe en premier lieu, mais aussi nombre de fonctions naturelles. Le cinéma italien, plus direct dans son approche, a beaucoup fait pour l'évolution de ces représentations. Ainsi la première fois que j'ai vu un homme uriner à l'écran, c'était Rod Steiger dans le premier plan de Giù la testa ! (Il était une fois la révolution – 1971) de Sergio Leone. Plan coupé dans les copies américaines. Il suffit d'évoquer certaines scènes de Fellini, Ferreri ou Pasolini pour comprendre la nature de leur apport. Aujourd'hui, les choses ont évolué et Kubrick a pu filmer Nicole Kidman assise sur ses toilettes. On sera peut être moins sensible, ce qui n'est pas sûr.
Il bianco, il giallo, il nero est aussi une comédie de la parole, d'un phrasé, d'une langue spécifiquement romaine que Corbucci a développé spécialement avec Tomas Milian dès leur première collaboration et qu'il parodie ici avec son japonais de bazar. Le personnage de Sakura est prétexte au plaisir du jeu de mot, car il comprend tout de travers. Il faut avouer que cet humour ne passe pas la traduction. La version française est authentiquement vulgaire, la version anglaise plate. Les amateurs des Marx Brothers savent quels peuvent être les dégâts d'une version française. Ceci posé, Milian n'est pas Groucho et il faut aussi accepter (supporter) le jeu outré du cubain. Ce n'est pas, je le concède, évident pour tout le monde mais si l'on aime les Monty Pythons ou John Belushi, on devrait être à l'aise. Milian s'est beaucoup amusé avec Sakura, au point de le reprendre en bloc dans un film contemporain, Delitto al ristorante cinese (1981) du frère Bruno. Par contraste, Corbucci fait jouer Wallach tout en sobriété, loin des exubérants Tuco ou Cacopoulos. Gemma seul reste fidèle à lui même.
Globalement, ce côté comique marqué du film est à la fois un retour aux comédies de l'époque Totò (les mots, les gestes) et l'annonce d'un retour au genre qui va se poursuivre avec Bluff l'année suivante, un démarquage du succès américain de The sting (L'arnaque – 1973). Corbucci a fait le tour du western, en épousant toutes les inflexions, il referme le cycle dans un éclat de rire, comme Black Jack retourne à sa famille après avoir rêvé mener la grande vie avec les dollars et la belle prostituée.
L'ensemble reste mis en scène avec élégance, même si l'on décèle l'abandon des recherches visuelles ayant marqué les oeuvres les plus remarquables. Sergio Corbucci tend à un style plus épuré, direct, plus simple. Son monteur favori, Eugenio Alabiso est toujours aux commandes et enchaîne les péripéties sans temps mort, maniant l'ellipse hardiment. Mais il s'est assagi, exception faite de la scène bouffonne où nos trois héros se déguisent en danseuses de saloon, se font draguer puis déclenchent une bagarre fameuse. La photographie de l'espagnol Luis Cuadrado qui avait signé les superbes ciels de La banda J.S. est conforme aux canon du genre. Il y a toujours de belles choses ici et là, l'entrée des héros dans le village déserté, la précision des scènes d'action, l'utilisation de l'écran large, la composition de la première scène avec ses multiples personnages répartis en profondeur. Corbucci a toujours le chic pour tirer partie des extérieurs espagnols que l'on a vus cent fois. Seule véritable concession à la mode, c'est l'une des rares fois qu'Ennio Morricone ne signe pas la musique, confiée aux frères De Angelis qui composent un thème sautillant, énervant mais qui finit par s'imposer.
Il bianco, il giallo, il nero, avec ses limites, est un film plus intéressant qu'il n'y paraît, souvent distrayant, important au sein de la carrière de son auteur, attachant par certains côtés si l'on veut bien le voir à travers le regard fatigué du shérif Black Jack.
Sur Psychovision
La chronique de Tepepa.
Photographies : Flixter
06:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
06/12/2010
Godard contre Kubrick
Pour filer la métaphore cycliste, le Dr Orlof fait une belle course fond sur le col du St Godard avec un nouvel article, Godard décortiqué, sur la présence de notre homme deans le travail de Gérard Courant. De son côté, Ed de Nightswimming nous propose un de ces classements dont il a le secret. Êtes vous godardien ?
A l'origine de ce texte, il y a la découverte, voici quelques années, de la vidéo ci-dessous sur le toujours excellent et toujours multilingue O Signo do dragao. Cet extrait provenait de l'une de mes émissions cultes du temps que je regardais la télévision. Ah ! Cinéma, cinémas, la musique déchirante de Franz Waxman, les peintures de Guy Peellaert, le cri de Rita Hayworth dans Lady from Shanghai et les portes d'Aphaville. J'imagine que tous ceux qui suivaient ce magasine télévisé sur Antenne 2 dans les années 80 s'en souviennent avec les yeux humides. Donc je regarde et, comme souvent avec Godard, au bout d'une minute, je fais des bonds sur mon siège, excité, passionné et furieux. Les idées roulent dans ma petite tête, puis je temporise, je prends le temps de la réflexion en même temps que des notes, et puis le temps file, et puis comme on ne badine pas avec le contenu copyrighté, je constate que la vidéo a été retirée. Me voici avec un texte embryonnaire, une grande envie d'en découdre, mais plus de quoi travailler. Et pas question de se lancer de mémoire, la mienne est trop aléatoire. Je laisse donc macérer le temps que la vidéo ressorte, ailleurs. Magie d'Internet.
Donc voilà.
C'était ça, Cinéma, cinémas, et je trouve ça passionnant bien qu'en même temps ça me fasse grimper aux rideaux. Godard dans ses œuvres. Rien que sa façon de dire « C'est du Peckinpah, si tu veux ». Moi, je n'y tiens pas. En même temps c'est ici qu'il a cette belle phrase sur la télévision qui fabrique de l'oubli et le cinéma des souvenirs. Godard a la passion de la critique de cinéma. Devenu metteur en scène, il a fait vivre cette passion dans ses films. Rien ne l'enthousiasme plus que de confronter les images entre elles et nul peut être plus que lui n'a autant pensé (sur) les images. Reste que, comme toute l'équipe historique des Cahiers du Cinéma, il a construit cette réflexion sur des positions tranchées, des clivages marqués, une confrontation des films et des auteurs où se mêlent aux critères esthétiques des considérations politiques et morales. A cela s'ajoute chez JLG ce désir de la dispute dont j'ai déjà parlé. Il y a dans telle ou telle prise de position une part de provocation qui appelle une réponse. Mais son style, quelque peu ombrageux, puis sa réputation font que la réponse ne se fait pas.
La démonstration est ici exemplaire. Godard reçoit l'équipe de tournage (Guy Girard et Michel Boujut) au sein de son atelier ou de son laboratoire. Il confronte deux images, deux passages de deux films : Full metal jacket (1988) du réalisateur américain Stanley Kubrick et 79 veranos (79 printemps – 1969) du cinéaste cubain Santiago Álvarez. Il y a deux écrans l'un au dessus de l'autre, un peu comme Godard filmait Numéro 2 (1975). A première vue, tout oppose les deux films et leurs auteurs, la grosse production classique d'apparence, américaine (même si le film a été tourné en Angleterre) d'un auteur célèbre et célébré, face à un film poème, expérimental et très engagé d'un réalisateur cubain par ailleurs combattant de la révolution. Ce qui me gène, c'est le choix de la confrontation de ces deux films (au lieu d'une comparaison), les arguments utilisés et la plus value morale qui est donnée à l'un contre l'autre. Ce n'est pas tant sur le principe que je m'élève. Godard défend un cinéma qu'il aime et qu'il pratique, c'est son droit. Son dispositif est parfait. Mais sous l'habillage démonstratif, scientifique pourrait-on dire, il se permet de passer sous silence un certain nombre de faits, d'ignorer la spécificité de certaines situations et de passer en force au risque de l'énormité, le tout avec une parfaite mauvaise foi, renforcé du fait que ce n'est pas Boujut qui va lui faire la moindre remarque. Bien mieux, lors de l'échange autour du film de John Wayne de 1968, Godard se paie le luxe d'apparaître magnanime (ceci dit, il n'aurait plus manqué qu'il soutienne l'idée d'interdire un film). On sent trop le plaisir qu'il a de se mesurer lui-même avec Kubrick, n'abordant jamais le caractère particulier de l'œuvre et de l'homme.
Prenons l'histoire du ralenti. Chez Peckinpah il est inclus dans un montage très fragmenté, rapide, enchaînant les points de vue. Il s'agit de dilater le temps, de donner une respiration au sein des déchaînements de violence. Chez Kubrick, qui l'a peu utilisé, c'est tout autre chose. Il s'agit de donner du poids à un moment précis, celui de la mort de l'un de ces soldats que l'on suit dans un tourbillon ininterrompu depuis le début du film. Là, il est isolé et le ralenti, comme le plan subjectif juste avant, très large, accentue le sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Chez Peckinpah c'est un point virgule, chez Kubrick c'est un point final. On peut dire aussi que chez Peckinpah c'est une façon de faire avancer l'action en la morcelant, alors que chez Kubrick c'est une suspension du temps pour figer l'action. Il est difficile de croire que Godard ne fait pas la différence d'autant que le ralenti kubrickien est proche de celui qu'il utilisa dans Sauve qui peut (la vie). Donner de la densité à un instant , à un geste bien particulier. Et celui d'Alvarez n'est guère différent puisqu'il s'agit de figer, de densifier un instant, ici de douleur. La seule différence se situe au niveau du personnage. Alvarez fait un film dont le personnage est un peuple en lutte, disons comme quand Eisenstein fait Octobre (1927), alors que Kubrick fait un film sur des individus envoyés dans la guerre. Godard ne nous dit pas que Full metal jacket n'est pas un film sur la guerre du Vietnam, mais mais un film sur le conditionnement à la guerre et l'effet de ce conditionnement. C'est là que se situe le travail documentaire de Kubrick. La guerre du Vietnam, en tant que fait historique, politique, est une abstraction que Kubrick rend en ne montrant justement pas l'ennemi, en ne faisant aucun discours alors qu'Alvarez conclut son plan par un intertitre qui sonne comme un slogan. La guerre de Kubrick ce sont de jeunes gens qui tirent aveuglément sur la façade d'un bâtiment qui pourrait être de n'importe où. Et qui meurent parfois. Et quand ils découvrent leur ennemi, c'est une gamine de 13 ans. Car le contre-champ existe. Kubrick doute de l'homme quand Alvarez croit dans le peuple. Godard ne nous dit pas que Kubrick est un artiste misanthrope, obsédé de contrôle et farouchement individualiste. Comment imaginer qu'il ait pu faire un film « américain » ?
Côté mauvaise foi, la sortie sur les grands acteurs hollywoodiens jouant les officiers allemands est un grand moment. J'allais citer John Wayne mais, le saviez vous, il a bel et bien joué un commandant de navire allemand dans The sea chase (Le renard des océans – 1955) pour John Farrow. Il y est bien entendu un allemand anti-nazi. Inutile de vous dire qu'il y est crédible comme moi en pape. Évidemment très peu l'on fait. Stewart, Bogart, Cooper, Grant, McQueen, Eastwood, certainement pas. Et quand on voit ce qu'à donné Marlon Brando en officier de la Wermarch pour Edward Dmytryk, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est un peu comme quand on a imposé des acteurs espagnols à John Ford pour faire les indiens dans Cheyenne Autumn (Les Cheyennes – 1964), cela ne fonctionne pas terrible. A plus forte raison, penser qu'un acteur américain puisse jouer un vietnamien, c'est difficilement imaginable. Tant qu'au contraire...
Ce dont Godard ne parle pas, qui est essentiel et sur lequel on pourrait se rejoindre, c'est la différence d'accès aux films entre Kubrick et Alvarez, une différence économique qui est aussi un acte politique. Mais chacun des deux faisait les films qui lui ressemblait. Les deux visions sont complémentaires, pas antagonistes. On peut penser à bien des films qui auraient été plus pertinents pour la démonstration de Godard. Mais il lui fallait un adversaire à sa taille.
05:26 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jean-luc godard, stanley kubrick, santiago Álvarez | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2010
Lo smemorato di Collegno : la comédie selon Corbucci
Le Corbucci - Godard Blogathon
A lire certains contributeurs, je me demande si je n'aurais pas du partir sur un article général pour présenter Sergio Corbucci. Alea jacta est comme on dit du côté de la gare de l'est. Le Dr Orlof propose un doublé superbe sur Godard avec Made in USA et Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard réalisé en 2009 par Alain Fleischer et qui lui permet d'approfondir les rapports de JLG avec ses contemporains. Ran répond de belle manière au questionnaire Godard sur De son coeur le vampire. une constante se dessine : Anna Karina.
Et maintenant pour quelque chose de complètement différent...
Par quel bout prendre Lo smemorato di Collegno, comédie italienne de 1962 réalisée par Sergio Corbucci avec Totò ? Peu connu voire totalement ignoré en nos contrées, l'objet me semble nécessiter une étude physico-chimique par décomposition de ses constituants que, lecteurs que j'aime, je vais réaliser sous vos yeux esbaudis.
En première approche, « comédie italienne » est le bout le plus familier. L'un des grands genres du cinéma transalpin. Célébré pendant plus de vingt ans puis pleuré pendant le même laps de temps. Ne nous y fions pas. Des tests poussés nous apprennent que la comédie italienne recouvre une grande variété de films et que, longtemps, elle ne fut guère considérée. Rappelons par exemple que le passage, au début des années 60, de Pietro Germi ou de Vittorio de Sica à la comédie ne fut reçu qu'avec des pincettes, et des accusations de traîtrise au néo-réalisme et au cinéma dit sérieux. Il fallu le travail acharné de critiques, la reconnaissance de festivals prestigieux et le soutien sans faille du public pour imposer quelques noms comme Dino Risi, Mario Monicelli puis Ettore Scola. Mais sous la plage se dissimule la face cachée de l'iceberg. Genre populaire entre tous, la comédie italienne a produit des milliers de titres dont une large partie est restée à usage national. Lo smemorato di Collegno fait partie du bataillon des sans grades signés Steno, Lucio Fulci, Giorgio Bianchi, Vittorio Cottafavi, Mario Mattoli ou...Sergio Corbucci. Il y a sans doute à explorer dans cette luxuriance, tant chez les stakanovistes du genre que chez ceux qui se feront un nom ailleurs. Mais ce n'est pas sans risque car on trouvera là une majorité de films anodins, vite vus et justement oubliés. Puisque nous en parlons, Lo smemorato di Collegno est l'histoire d'un amnésique, inspirée du procès Bruneri/Canella de 1926. Un homme qui cherche à trouver une histoire, la sienne, et auquel on en propose plusieurs. On en voudra pas à la France de ne pas s'être intéressée à ce film, nous avions alors (et c'est toujours le cas) nos propres comiques à usage interne. Mais le cinéphile bien né est un chercheur acharné et il n'hésite pas à trier des monceaux de caillasse pour dégoter quelques perles.
Penchons nous alors sur le composé « Totò ». Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi dit Totò, napolitain né en 1898 et monument national comme la fontaine de Trevi, la pasta all'arabiatta et Garibaldi. Totò a joué dans plus de cent films. Devenu très malade des yeux en 1956, il ne ralenti pas le rythme, incarnant toujours le même type de personnage, Totò, à mi chemin entre Chaplin et De Funes (qui le doubla en français et joua avec lui deux fois). Très populaire en son temps, ses films étaient pourtant mal reçus, souvent, par la critique. Il est toujours l'objet d'un culte fervent et, sur les marchés, sous les arcades, on le trouve toujours entre les posters de Marilyn et de James Dean. En France, son comique reposant beaucoup sur la parole et un type régional marqué, font qu'il n'est connu que pour quelques œuvres atypiques et de haute volée : le courageux père de famille de L'oro di Napoli (L'or de Naples - 1954) de Vittorio de Sica, le truand napolitain de I soliti ignoti (Le pigeon - 1958) de Monicelli et le moine de Uccellaci e uccellini (Des oiseaux petits et gros - 1966) de Pasolini. On voyait souvent à une époque sa collaboration avec Fernandel dans La Loi, c'est la loi (1958) de Christian-Jaque.
Lo smemorato di Collegno est plus typique. Totò a joué sept fois pour Sergio Corbucci au début des années 60, un Corbucci qui semble s'être beaucoup amusé à ces comédies souvent scénarisées par son frère Bruno, au point qu'il y fait de petites apparitions décontractées. Ce sont des films véhicules pour le Stradivarius Totò, faits pour mettre en valeur son extraordinaire force comique. Évadé d'un asile, notre amnésique est reconnu par une femme comme étant son mari, riche industriel. Il y a embrouille et la justice s'en mêle. A la barre défilent d'autres personnes (de petits truands, une veuve immigrée) qui affirment reconnaitre le smemorato. C'est donc un film de procès, de ces procès farfelus et bouffons comme on en a pu voir chez Sacha Guitry ou John Ford. Totò y donne toute sa démesure entre tirades déclamatoires à l'absurde précis et longs silences rendus intenses par son regard absent. Il y donne aussi libre cours à son goût du travestissement (en infirmier, en bonne sœur, en chasseur alpin), toujours très digne, toujours noble. Il a aussi cette présence tout à coup poignante quand il parcourt, voûté, avec son chapeau à plume, les quais du Tibre, avec sur les talons le chien qui sait, seul, la vérité sur l'homme. Passe alors l'ombre d'Umberto D.
Le dernier composé, c'est Sergio Corbucci que l'on sait bien aimé sur Inisfree. Sa veuve aimante, Nori Corbucci raconte l'anecdote suivante sur Taxi drivers : Le critique d'art Antonello Trombadori rencontre Federico Fellini accompagné de Corbucci à Rome et se présente devant le premier avec une sorte de révérence. Et Fellini de répliquer : « Vous feriez mieux de vous incliner devant Corbucci, parce que l'on parlera toujours de Totò et donc aussi de Corbucci. De moi, je ne sais pas...». Corbucci est aujourd'hui connu et plutôt bien connu pour ses westerns. Ils lui ont assuré en leur temps, succès et reconnaissance internationale. Mais comme pour beaucoup de réalisateurs de genre qui se sont révélé dans un créneau particulier, une large part de son travail est méconnu. Le western ne représente guère que 20% d'une filmographie de plus de 60 titres. Corbucci faisait de la comédie avant de faire des westerns et quand ce genre fut épuisé, il y revint jusqu'à sa mort. Ce qui permet d'affirmer que la comédie est le trait caractéristique de son cinéma. A de rares exceptions près, il mise sur l'humour avec délectation. Un humour aux multiples visages, ironique, satirique, noir profond dans Il grande silenzio (Le grand silence – 1968) ou Django (1966), parodique quand il démarque La dolce vita (1960), grotesque ou bon enfant quand il met en scène le duo Bud Spencer et Terence Hill, parfois un peu raz de terre. Mais de l'humour toujours, de ce ton et de ce style très romain, élégant et trivial à la fois, féroce aux grands, capable de tendresse aux petits, profondément pétri d'humanité. Un humour que l'on retrouve chez Pasolini, Nanni Moretti ou Fellini sur les aspects les plus excessifs, avec l'influence de la caricature et de la bande dessinée.

Lo smemorato di Collegno est bien dans ce ton avec une mise en scène discrète, visant à l'élégance de la comédie classique américaine. Un noir et blanc limpide signé Enzo Barboni qui avait débuté avec Corbucci l'année précédente et sera un collaborateur fidèle avant de passer à la mise en scène sous le pseudonyme d'E.B. Clucher et d'inventer le personnage de Trinita. Beaucoup de soin est apporté aux décors, studio, studio, du tribunal, de l'asile et de la maison de Ballarini dont le côté artificiel rappelle le Hollywood des années 30 comme les téléphoni bianchi de l'époque fasciste. La musique de Pièro Piccioni est discrète, les plans sont larges, organisés autour de Totò comme Leo McCarey ou Sam Wood organisaient les leurs autour des frères Marx. Il s'agit de mettre le prince en valeur, de saisir pleinement ses expressions, ses gestes, lui qui est comme lâché en liberté dans le film. Aucun des effets affectionnés plus tard dans les péplums ou les westerns, débrayages d'espace ou profondeur de champ. Ce n'est pas aussi beau, question cinéma pur, que les constructions des duels de Django ou les formes circulaires de Il mercenario (Le mercenaire – 1968) mais il serait dommage de passer à côté de ce qui est déjà typiquement corbuccien. On retrouve des constantes, une conception mathématique de la mise en scène venue de son admiration pour Howard Hawks, l'éclatement du récit dans le temps avec l'utilisation de flashbacks enchâssés dans la scène de procès, le goût des portraits de groupes composés par accumulation, à-plat, et la place des personnages féminins. Ce dernier point est caractéristique. Au milieu du déchaînement de bêtise et de veulerie, la tendresse du réalisateur va au personnage de madame Polacich jouée par Elvy Lissiak. Jeune veuve de guerre, immigrée des Balkans, elle essaye de se recaser pour assurer l'avenir de son fils. C'est à elle que le smemorato réserve sa sympathie. « Je voulais l'entendre de ta... pardon, de votre bouche » lui dit-il quand elle avoue sa tentative de manipulation. C'est l'un des moments les plus émouvants du film, comme les regards fatigués et la silhouette voûtée par tant de bêtise que Corbucci sait mettre en valeur lors des dernières minutes qui voient s'éloigner son héros, errant à la recherche d'une vie qui lui échappe, avant la pirouette finale.
Bien sûr, il est amusant de retrouver tel ou tel trait de style que l'on a déjà repéré dans les films plus tardifs. C'est de la critique saumon qui remonte le courant, pas bobsleigh qui suit la pente naturelle du temps. Quand on parle d'artisanat à propos de réalisateurs du cinéma de genre, c'est à des films comme celui-ci qu'il faut penser plus qu'aux œuvres les plus ambitieuses. Facile à trouver en Italie, ce film, comme tous ceux du tandem Totò/Corbucci restent hélas inédits chez nous et ne bénéficient pas de sous titrage français. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter l'expérience.
Affiche Antoniodecurtis.org
00:05 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci, totò | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2010
Histoire(s) de Jean-Luc Godard
Le Corbucci - Godard Blogathon
A l'aube du troisième jour, vous pouvez lire les réponses généreuses de Frédérique et celles d'Anna sur Goin' to the movies au questionnaire JLG, le Fantasmascope godardien d'Ornelune sur la Kinopithèque, la chronique de Raphaël sur La Banda J.& S. Cronaca criminale del Far West (Far West story – 1972) et le décryptage du monologe de la note précédente par Breccio.

J'ai entendu parler de Jean-Luc Godard très tôt. Et dès le début, il a toujours représenté pour moi un faisceau de choses contradictoires, un mélange complexe, tour à tour excitant et repoussant, amical et hostile, stimulant et irritant. Je peux utiliser pour le décrire la phrase qu'il écrivit sur John Wayne : « Comme puis-je le détester quand il soutient Barry Goldwater et l'aimer tendrement quand, à la fin de La prisonnière du désert, il prend Nathalie Wood dans ses bras ? ». Il me suffit de remplacer le sénateur républicain par son antipathie pour Steven Spielberg et le geste d'Ethan Edwards par celui qu'il fit en envoyant un chèque conséquent à une MJC niçoise pour qu'elle puisse diffuser ses Histoire(s) du cinéma.
Je pense avoir entendu parler de lui pour la première fois à l'occasion de la diffusion télévisée de France, tour, détour de deux enfants à la fin des années 70. Le titre m'avait séduit, je devais me sentir concerné. Mais j'étais un peu jeune et la diffusion tardive. Sa phrase sur le Duke m'avait marquée, reprise sans doute pour la mort de Wayne en 1979. Godard, c'était le cinéma de mes parents. C'était l'auteur engagé, européen, de gauche, intellectuel et radical. C'était tout l'opposé du cinéma que j'aimais alors (et que j'aime toujours). Il est d'ailleurs resté le symbole d'un cinéma adulte, démonté, désossé de sa part de rêve et d'innocence (pourtant...). Avec sa phrase sur John Wayne, Godard établissait un pont et me tendait la main. En dissociant l'homme et l'acteur, il me permettait de résoudre mes propres contradictions encore bien juvéniles. C'était un argument de poids. Godard a dit que : ... Important ! Aujourd'hui, je sais qu'il n'allait pas au bout et que, comme l'écrira Luc Moullet, c'est parce que l'acteur était l'homme que le plan final est aussi fort. Mais cela reste, relativement à mon rapport au cinéma, un jalon essentiel. J'ai commencé avec le Godard critique.
Godard réalisateur, je l'ai découvert un peu plus tard, sans sens chronologique jusqu'aux années 2000, poussé dans un premier temps par le fait que, cinéphile revendiqué, Godard faisait partie des incontournables. Il fallait y passer. Et rétrospectivement, combien de gens, combien de réalisateurs, ont eu le choc de leur adolescence en découvrant A bout de souffle (1959) ou Pierrot le fou (1965) ? Un tas. Pas moi. En ce qui me concerne, ce fut sans doute Masculin – Féminin (1966), à la télévision, attiré par l'étrange présence de Chantal Goya que ma petite sœur écoutait alors. Je me souviens ne pas avoir aimé. C'est à dire que je n'ai pas compris grand-chose, que j'ai sans doute été désarçonné par le style godardien et que, plus largement, la jeunesse française pré-68 ça ne me parlait pas à l'époque. J'ai donc temporisé jusqu'à ce que ça me parle. Godard restait présent à travers de nombreuses images (Dutronc devant le tableau avec écrit : Caïn et Abel / Cinéma et Vidéo) et des textes. Le déclic s'est fait sur Bande à part (1964), vu en salle, ce qui n'est guère original. C'est sans doute son film le plus accessible, libre et léger, trépidant et drôle. Et puis Anna Karina. C'est l'un des films fétiches de Quentin Tarantino (dont la boite de production s'appelle A Band Apart). Il paraît que Godard ne veut plus entendre parler de ce film. C'est un signe. C'est là que j'ai ressentit le choc dont on parle tant. J'étais converti. L'autre film qui a eu son importance, c'est Une femme est une femme (1961), sa comédie musicale lubitchienne. Le vélo dans l'appartement, la bataille à coup de titres de romans noirs, la séance de photographie d'Anna Karina, c'est je genre d'idées que j'adore chez lui. Parrallèlement, je suis venu à son cinéma contemporain des années 80 après quelques hésitations (gros fantasme sur Maruschka Detmers) et une raison un peu tordue. Je vous salue, Marie en 1985 a eu les problèmes que l'on sait : menaces, cinéma incendié, manifestations d'extrémistes... J'y suis allé par solidarité. Question de principe. Il ne m'est rien resté du film si ce n'est cette idée du parasitage du dialogue par le son. J'ai suivi jusqu'à Nouvelle vague (1990) puis nouveau décrochage. J'ai repris sur Histoire(s) du cinéma, retrouvant ce mélange d'excitation et d'énervement, emporté quand même par la force de la forme, et puis à partir de la séance cannoise d'Eloge de l'amour (2002), malgré les piques à Spielberg, je lui suis resté fidèle. Tout ceci pour arriver à ce dernier intertitre de Film Socialisme (2010) « Quand la loi est injuste, le justice passe avant la loi » qui m'a transporté au-delà du raisonnable. Enfin, ça me parle.

La lecture cette année du pavé de De Baecque m'a permit de remettre un peu d'ordre dans cette découverte façon puzzle. De conforter quelques intuitions et de relancer mon envie de découvrir des périodes de son œuvre, si vaste, qui me restent inconnues. Rien que pour cela, le livre est réussi, malgré quelques scories sur lesquelles je reviendrais à l'occasion. Je vois en JLG un homme aux multiples saisons. Il y a le Godard critique que je connais assez peu. Il y a une première période qui va du court Tous les garçons s’appellent Patrick (1957) à Pierrot le fou. Ce serait le Godard classique, jeune et inventif, embrassant le cinéma sous toutes ses formes : le Scope, couleur et noir et blanc, comédie et polar, flippers et musiques du temps, découvreur de Belmondo et de Karina, multipliant les audaces de fond (Le petit soldat, Une femme mariée) et de forme (jeux sur le montage, les couleurs, le récit, le son). Un Godard feux d'artifices qui contribue au premier rang à illuminer le cinéma. Mais un Godard qui sait conserver à ses films une cohérence d'ensemble qui les rendent accessibles à un esprit classique comme le mien. Rien à jeter ou presque de cette période, sauf peut être la farce sinistre des Carabiniers (1963). Godard a toujours cultivé la contradiction. Je pense que c'est son moteur, dans sa vision du cinéma (Il aime opposer les films entre eux), dans ses films et semble-t'il dans sa vie. Il a besoin du choc des contraires, il a besoin de la dispute (au sens littéraire) et des gens capables de disputer avec lui. Après le succès de Pierrot le fou, il sabre radicalement dans l'idée de récit (il a souvent parlé de son rapport au fait de raconter des histoires) et jusqu'à Week-end (1967) il conserve les formes du cinéma commercial : utilisation de l'écran large, couleurs sophistiquées, vedettes, présence dans les festivals prestigieux, tout en mettant en avant le côté expérimental de son travail. Le cinéma est désormais exploré et explosé de l'intérieur, avec des passages virtuoses (le fameux travelling de Week-end, l'image de Deux ou trois choses que je sais d'elle), des réflexions de fond en prise sur son époque (la vie dans les grands ensembles, les jeunes et la politique, la guerre du Vietnam) et des essais parfois horripilants (Les enregistrements nasillards de Made in USA, Mireille Darc en sous vêtements récitant du Bataille).
Aux effets de collages d'images qui vont devenir de plus en plus importants, se superpose le plaquage d'un discours politique trop dans l'air du temps pour avoir du recul. Godard n'a ni la distance ironique de Chabrol, ni les cloisonnements de Truffaut. Je ne suis pas du tout d'accord pour voir du second degré dans La chinoise (1967) vis à vis de l'idéologie maoïste quand on sait comment le réalisateur va évoluer quelques mois plus tard, quand bien même il apporte une forme de contradiction lors de la scène avec Francis Jeanson, ce qui est bien dans son style. Pour dire les choses autrement je partage le point de vue de Truffaut dans la fameuse réponse de rupture en 1973 : « L’idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi, elle n’est pas ressentie. Il te faut jouer un rôle et que ce rôle soit prestigieux. J’ai toujours eu l’impression que les vrais militants sont comme des femmes de ménage, travail ingrat, quotidien, nécessaire. Toi, c’est le côté Ursula Andress... ». Théoriquement je devrais détester la période suivante, celle de la « clandestinité », du groupe Dziga Vertov et de la collaboration avec Jean-Pierre Gorin. Ce n'est pas le cas. D'abord parce que je la connais mal, ensuite parce que la démarche, au-delà de l'idéologie, me plaît. L'utilisation du tourné-monté, les ciné-tracts, la recherche d'indépendance, l'utopie d'un autre cinéma, l'exploration des possibilités de la vidéo naissante, tout cela m'inspire du respect et l'envie d'explorer le résultat.

Je pense que l'on peut ouvrir la période suivante avec Sauve qui peut (La vie) en 1979 et la refermer avec Hélas pour moi (1993). Retour à des formes classiques (production, diffusion, vedettes voire stars, budgets, festivals), en réaction peut être à la période qui s'est achevée. Elle ressemble, de façon moins marquée, à la seconde période. Godard n'a rien perdu de son désir d'invention. Il y a la découverte de Myriem Roussel et l'utilisation de jeunes comédiennes très douées. Godard cultive sa liberté de création au sein d'un système et d'une période qui ne brille pas par son originalité. Pourtant, de tous les films que je connais, aucun ne s'impose vraiment. Je lui trouve toujours ce mélange hétérogène de choses magnifiques et d'autres plus confuses, de beautés simples et d'expérimentations hasardeuses. Plus largement, son cinéma s'il reste visible, n'est plus au centre. Il est comme il le dit, à la marge qui fait tenir les feuilles ensembles. Mais quelles feuilles ? Truffaut meurt, Rivette, Rohmer et Chabrol restent dans leur coin. Les années 80, ce sont celles de Besson, Beineix, Annaud, etc. Ce ne sont pas des contradicteurs pour Godard. La dispute n'est pas possible. Petit à petit, il lui arrive quelque chose de terrible, il entre au Panthéon (avec un césar d'honn(rr)eur déjà en 1987). Godard suscite alors respect craintif et admiration polie. Il devient un monument national, ce qui est encore le meilleur moyen de le neutraliser. J'imagine qu'il en a été conscient et il s'est battu, multipliant les incursions chez l'adversaire, la télévision. Mais trop souvent il amuse alors qu'il devrait déranger.
C'est peut être encore en réaction qu'il laisse tomber et s'engage dans les Histoire(s) du cinéma. Il ouvre une nouvelle séquence, plus personnelle, plus apaisée mais toujours inventive. Il se choisit un disputeur à son échelle : la cinéma lui même. Il tourne le dos au système pour des productions plus légères, plus autonomes. Toujours féru de technique, il utilise comme personne les nouvelles images. La beauté visuelle de Film Socialisme ou d'Eloge de l'amour est sidérante. Le succès de ses Histoire(s) remet sa marge au centre, du moins dans une position de vieux sage bougon qui lui convient mieux. Mais la véritable dispute critique qu'il appelle de ses vœux n'aura pas vraiment lieu, si ce n'est avec ses vieux ennemis de Positif. On préfère se prosterner devant la parole divine que d'ouvrir une discussion stimulante sur la base de ses virulents partit-pris. Les années 2000 le voient se mettre en retrait derrière ses films, courts et longs, toujours sensibles à la marche du monde. Il ne va ni à Cannes ni en Amérique chercher des colifichets, il sabote son projet à Beaubourg. Il est une présence rassurante mais fragile dans un monde bordélique (pardon, mondialisé), une exigence de créativité et d'indépendance. Jean-Luc Godard en 2010, c'est le fantôme de la liberté.
Photographies : Tout le ciné / To soon to tell / DR
00:45 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2010
Monologue
Le Corbucci - Godard Blogathon
Vous pouvez d'ores et déjà découvrir un superbe inventaire chez le bon Dr Orlof (qui vaut largement l'officiel abécédaire de Bernard Pellegrin) comme il fallait s'y attendre, les commémorations en tout genre vont fleurir dans les medias pour JLG. J'attends quelques contributions de choix et Ran me renvoie à un article sur Alphaville pour faire patienter ses réponses au questionnaire. Passons à "l'autre Sergio" sur lequel on pourra se rafraîchir la mémoire en suivant l'historique sur Inisfree.
Il bianco, il giallo, il nero (Le blanc, le jaune et le noir – 1975) de Sergio Corbucci s'ouvre sur un morceau de bravoure en matière de dialogue. Sauras-tu reconnaître, lecteur attentif, les nombreux titres originaux de westerns all'italiana et autres allusions au cinéma de l'époque ? Voici, à partir de la retranscription du site Spaghetti western database le monologue en version originale. Solution la semaine prochaine.
La femme du shérif : « Per un pugno di dollari, per un miserabile pugno di dollari, che non sono neanche tuoi, devi già ripartire? Almeno lo facessi per qualche dollaro in più!, e invece, vamos a matar compañeros, sempre in giro con il buono, il brutto e il cattivo tempo (à l'un de ses enfants) Giù la testa, caro… Sei alla resa dei conti, ormai. Chi sono io, per te? Nessuno, ecco, il mio nome è nessuno. Tu devi metterti faccia a faccia con le tue responsabilità. Per queste creature ti danno un dollaro a testa, sei il mercenario peggio pagato di tutto il Texas, cangaceiro!, e noi siamo il mucchio selvaggio… Ma tu non vali nemmeno un dollaro bucato, e prima o poi finirai come quel bounty killer del Minnesota, Clay era il suo nome, ma poi lo chiamarono il magnifico… però ricordatelo, c’era una volta il west che dicevi tu: oggi, anche gli angeli mangiano fagioli, ma sì, corri uomo, corri! Altrimenti, ci arrabbiamo sul serio, e se Dio perdona, io no, perciò datti da fare, capito? (Elle gifle un autre de ses garçons) E tu smettila di fare il bestione! (Se retournant vers son mari) Vergognati, vergognati di fare vivere i tuoi bambini come dei barboni. Leone, questo devi diventare, se vuoi fare la rivoluzione nel mondo del west ».
Le sherif : « Ma che c’entriamo noi con la rivoluzione? »
La femme du shérif : « Avete sentito? Tanto di Ringo o di Django, sono sempre io che me lo piango ... »
06:48 Publié dans Cinéma, Curiosité, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/12/2010
Questionnaire Godard
Le Corbucci - Godard Blogathon
J'ouvre donc cet hommage collectif à Sergio Corbucci et Jean-Luc Godard par un soupir de soulagement. Vu la mortalité dans la profession ces derniers mois, j'aurais été terriblement mal à l'aise si JLG... enfin, bon, aux dernières nouvelles il va bien et ça me réjouis de célébrer un cinéaste bien vivant. J'ai même lu quelque part qu'il préparerait un nouveau film. Donc c'est partit. A ceux qui ont envie de se joindre à moi, je rappelle qu'il suffit de publier ou plusieurs articles sur votre blog, sur l'un ou l'autre de nos réalisateurs, et de me le signaler en commentaire. Je compilerais vos contributions ci-dessous.
Et pour se mettre en jambe, rien ne vaut un petit questionnaire JLG en 12 entrées :
Quel est votre plus vieux souvenir d'un film de Jean-Luc Godard ?
Mon souvenir n'est pas très assuré, mais je crois qu'il s'agit d'une diffusion télévisée de Masculin – Féminin (1966). Au cinéma, je ne suis pas plus sûr de moi, je pense que c'était Je vous salue, Marie (1985).
Et le plus récent ?
Film Socialisme à Cannes cette année.
Le plus beau plan ?
J'ai longtemps été fasciné par le plan de Raoul Coutard à la caméra dans l'ouverture du Mépris (1963) mais c'était avant de voir le film. J'ai un faible pour celui-ci, à cause (mauvaise excuse), de l'affiche en arrière plan.

Le plus beau son ?
Les anbiances de café dans Bande à part (1964) surtout avec les sons de flipper.
La plus belle réplique ?
"Après tout, j'suis idiot... merde !"
Le plus beau visage ?
Anna Karina dans n'importe lequel des films qu'ils ont fait ensembles.
Le plus beau geste ?
Le saut de Godard pour entrer dans la voiture de Soigne ta droite (1987)
Le plus beau livre ?
Le plus beau passage musical ?
Le plus beau paysage ?
La gare dans Éloge de l'amour (2001)
Le plus grand regret ?
Sa mauvaise opinion du cinéma de Steven Spielberg
Le film rêvé ?
Ce film sur les camps dont il a souvent parlé.
07:30 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : jean-luc godard | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/11/2010
Mario, Irvin et les autres... assez, assez.
11:47 Publié dans Cinéma, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mario monicelli, irvin kershner | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/11/2010
Ne l'appelez plus Shirley
14:25 Publié dans Acteurs, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leslie nielsen | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/11/2010
Chère Ingrid
Très chère Ingrid Pitt, quelle tristesse ce matin, parcourant l'un de mes blogs favoris, d'apprendre votre disparition ce mardi. Quelle vie romanesque vous avez eue. Vous avez peu tourné, chère Ingrid, mais vous avez marqué le cinéma fantastique d'une empreinte à nulle autre pareille. Avec vos grands yeux bleu d'acier, vos lèvres pleines d'une sensualité macabre, votre corps conquérant aux formes émouvantes, votre menton altier et votre maintient de reine de la nuit, vous avez gravé en nos cœurs l'image de la vampire implacable et désirable. Que j'eus aimé être perçé de vos dents délicates. En deux films, vous amenez l'érotisme vampirique à un nouveau palier. Que dire de votre façon d'étreindre les jeunes vierges de The Vampire Lovers, sinon que la façon dont vous consumez d'amour Kate O'Mara vaut bien les manières de Catherine Deneuve chez Tony Scott. Vous avez symbolisé, mieux qu'aucune autre, les films aux couleurs chaudes et écran large de l'horreur à l'anglaise, de cette libération des mœurs de la fin des années 60 qui n'excluait pas encore la poésie ni une certaine forme de naïveté. Mais combien vous nous avez fait rêver, en déshabillé transparent, parcourant d'un pas posé, fantomatique, les couloirs des anciennes demeures d'Europe Centrale. Vous êtes à jamais de ces icônes qui hantent les musées et les adolescents. Votre metteur en scène, Roy Ward Baker, est partit en avant, il y a un mois. J'aime à imaginer qu'il vous attendait, ayant préparé le studio, grands candélabres d'or, larges teintures pourpres, un château gothique au loin sur une toile peinte. Et puis au centre, une belle vasque de bronze pleine d'un bain laiteux, entourée de jeunes filles en voiles blancs prêtes au service de la comtesse sanglante. Dans un coin, à demi dans l'ombre, Peter Cushing crispe sa main sur un pieu de bois. Et vous entrez, chère Ingrid, dans la plénitude de votre beauté. Et j'en appelle au grand Will pour ce modeste hommage : Voici un noble cœur qui se brise. Bonne nuit, douce princesse de la nuit, que des essaims d’anges noirs vous bercent de leurs chants.
Photographie Famous Monsters of Filmland 121 (collection personnelle)
19:54 Publié dans Actrices, Courrier du coeur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ingrid pitt | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/11/2010
Le Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre
Peu s'en souviennent, mais le 2 décembre 1990 Sergio Corbucci succombait à une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Il y aura 20 ans jeudi prochain que le réalisateur de Romolo e Remo (Romulus et Rémus – 1962), Django (1966), Il mercenario (Le mercenaire - 1968), Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) et Chi trova un amico, trova un tesoro (Salut l'ami, adieu le trésor - 1981), a disparu. Venise l'a honoré en septembre sous la houlette de son admirateur Quentin Tarantino mais cet hommage ne saurait être complet sans celui d'Inisfree.

Nul ne l'ignore, le 3 décembre 1930 naissait Jean-Luc Godard qui soufflera donc ses 80 bougies. Film Socialisme a montré cette année que cet homme de passion n'était pas à bout de souffle même s'il fait plus que jamais bande à part. Les américains viennent de l'honorer d'un Oscar. Pouvons nous faire moins ? Non !

Célébrer la mémoire de l'un et la vitalité de l'autre, pour ce faire je vous propose, amis de la blogosphère et au-delà, un Corbucci-Godard Blogathon du 2 au 9 décembre 2010. Cela sera beau comme la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Qui sera le parapluie ? Qui sera la machine à coudre ? Mystère et caramel mou. J'admets que le rapprochement peut sembler incongru, sacrilège même pour certains admirateurs de l'un voire de l'autre. Les différences sont nombreuses entre le romain bon vivant, expansif, dont on disait qu'il ne venait tourner que vers midi, amateur de comédie et d'action, de personnages de prostituées aux cheveux roux et de décors de cimetières, à l'aise dans un système de production classique et dans le cinéma de genre le plus pur, populaire et commercial ; et le « plus con des suisses pro chinois » comme l'ont raillé les situationnistes, austère, génial, tourmenté, chercheur inlassable, avide d'expériences, curieux de toutes les techniques, bosseur, théoricien, aux rapports compliqués avec la production et bien d'autres choses, désireux avant tout d’indépendance au point de s'exiler au pays de son enfance pour y monter son propre atelier de fabrication d'images et de sons.
Ce qui les rapproche, parlons cinéma, n'est pourtant pas nul et peut se révéler excitant. Révélés au début des années 60, ils sont tous deux des créateurs de formes qui ont bousculé un cinéma établi, joué avec les figures classiques, imposé des regards neufs, décalés, iconoclastes, manié l'humour, la violence et l'érotisme de façon inédite, souvent provocatrice, inventé de nouveaux jeux de montage et de couleurs. Leurs cinémas, bien que différents, ont marqué leur époque et influencé de manière irréversible tout ce qui a suivi. Leur héritage est toujours bien vivant.
Le principe du blog-a-thon est simple : il s'agit d'écrire sur Sergio Corbucci ou sur Jean-Luc Godard, ou sur les deux éventuellement, entre le 3 et le 9 décembre. Je compilerais les diverses contributions. Ce sera comme un bouquet varié en l'honneur des deux réalisateurs. Vous pouvez, pour préparer la chose, vous inscrire en commentaire ci-dessous.
Photographies : capture DVD Canal + et Listal.com
23:42 Publié dans Blog, Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sergio corbucci, jean-luc godard, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/11/2010
Impact (Ella, Ella)

... Le film flotte quelques minutes puis Williams arrive dans une station service en pleine cambrousse. Il s'adresse à un mécano penché sur un moteur, qui se redresse. C'est Marsha Peters et Marsha, c'est Ella Raines. Choc ! J'en suis bouleversé et le film en est transformé. Il faut la voir, cheveux ramenés sous la casquette, en combinaison blanche délicatement tâchée, les mains dans le moteur. Et ce regard, ce gris des yeux verts en noir et blanc. C'est d'une sensualité inédite. Donné pour mort, Williams décide de le rester et de se refaire une vie dans ce petit morceau d'Amérique profonde, et Lubin de nous introduire au débotté dans cette Americana semblable à un film de John Ford ou à une chanson de Bruce Springsteen.
Symbolique à mon sens, la mère de Marsha est jouée par Mae Marsh, actrice de Griffith et pilier de la John Ford's stock company (17 films avec le maître borgne). Elle est une référence morale. La photographie de Laszlo s'éclaircit, devient chaleureuse, illuminant une nature bucolique, les maisons de bois blanc, les porches et les vieux tacots. Le film sent la tarte aux pomme et le café aux coquilles d'oeuf. On respire la douceur de vivre de l'idéal des pères fondateurs. Parallèlement, Lubin donne par petites touches des notations sociales. On revient de la guerre et le travail est rare, l'entraide est nécessaire, la communauté soudée. On exalte le travail manuel opposé au grand capitalisme des actionnaires décrit dans les scènes du début. Le sommet de cette partie, très libre, très belle, est la transformation de Williams en pompier volontaire et sa course folle en camion. Un homme heureux.
La Chronique compléte sur Kinok
La chronique de Francis Moury sur Ecran large
Photographie : capture DVD Wild Side
07:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arthur lubin, ella raines | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/11/2010
Les 12e Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice
Comme chaque année à l'automne, je suis plongé dans l'organisation des Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice. La manifestation phare de l'association Regard Indépendant ouvrira sa 12e édition le jeudi 18 novembre 2010 au Volume et se poursuivra jusqu'au dimanche 21 novembre au MUSEAAV et au cinéma Mercury, place Garibaldi.
Pendant ces quatre journées, la production régionale et indépendante sera mise à l'honneur à travers un format original qui fait un retour en force et dont je suis friand : le film super 8. Au programme, de nombreux courts métrages, des rencontres avec les auteurs, de la musique, des cartes blanches à des associations partenaires, et la désormais traditionnelle nuit du cinéma qui sera consacrée au péplum.
L’objectif de ce rendez-vous reste de permettre au public curieux de découvrir la production cinématographique régionale. Le public pourra ainsi découvrir les œuvres de Guillaume Levil, Loïc Nicoloff, Coralie Prosper, Philippe Cardillo, David Viellefon et bien d'autres encore. Nous accueillerons également Gérard Courant, cinéaste atypique et auteur d'une œuvre impressionnante, adepte du super 8 pour une carte blanche comprenant quelques-uns de ses fameux Cinématons, portraits filmés de gens illustres et moins illustres. Cette séance spéciale sera présentée par le bon Dr Orlof en civil qui a répondu très amicalement à cette seconde invitation.
Au menu des réjouissances, l'association présentera sa nouvelle collection de super 8 tourné-montés réalisés sur le thème La première fois. Cette année, quatre réalisateurs allemands de Köln en Allemagne ont été invités à se joindre aux créateurs de la région. Treize films seront présentés en présence des réalisateurs. Oserais-je l'écrire, j'ai réalisé un petit quelque chose que j'ai soigneusement mis hors compétition. Car compétition il y aura, acharnée, impitoyable, bref, comme à Cannes. On trouvera aussi une sélection excitante des Straight 8 anglais et une carte blanche au festival tourné-monté de Strasbourg.
Création également avec les passerelles que nous jetons vers d'autres arts, la musique avec les groupes Outcrossed, Les arbres qui marchent et Veines pour trois concerts et l'intégration de nos images, le théâtre avec l'expérience menée par Luc Bonnifay d'improvisation à partir de courts métrages.
La nuit du cinéma assouvira nos pulsions cinéphiles avec les courts métrages proposés par Héliotrope et deux longs métrages mythiques, deux péplums, Jason and the argonauts (Jason et les argonautes - 1963) de Don Chaffey avec les créatures fantastiques de Ray Harryhausen et le délirant Monty Python's Life of Brian (La Vie de Brian - 1979), relecture décalée de la vie du Christ.
Pour en savoir plus, tarifs, adresses, programme détaillé, photographies et vidéo, une seule adresse : le site de Regard Indépendant.
Pour tous ceux qui sont dans le coin, voyageurs ou autochtones, vous y serez les très bienvenus.
Visuel : Illys PoulpFiction
06:35 Publié dans Cinéma, Festival | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : regard indépendant, super 8, court métrage | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/11/2010
6 années d'Inisfree
Joyeux anniversaire (Voix suave)
Joyeux anniversaire (Voix encore plus suave)
Joyeux anniversaire mister blog (Soupir ému)
Joyeux anniversaire (Clap, clap, clap)

Photographie de Milton H. Greene (1953)
10:06 Publié dans Blog, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : inisfree, marilyn monroe | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/11/2010
Passage au long
14:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mikhael hers | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
09/11/2010
Les joies du bain : Gratte moi le dos
Joli petit noeud dans les cheveux et regard effronté, Joan Blondell sur une photographie posée de l'époque pré-code. Une véritable invitation au voyage. Source Movietone news.

09:35 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joan blondell | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/11/2010
Citizen Zuckerberg
Je me souviens d'un article de Philippe Manœuvre dans un numéro de métal Hurlant de 1983 à l'occasion de la sortie du troisième volet de la saga Star Wars. Il écrivait à propos de la publication concomitante d'une biographie de Georges Lucas que le bouquin mettait 400 pages à montrer que Lucas n'avait rien vécu hormis un accident de voiture à 19 ans. On peut écrire de même qu'avec The social network, David Fincher fait un remarquable film de deux heures qui montre que Mark Zuckerberg, l'inventeur de Face de bouc, n'a même pas eu l'accident de voiture. Que ce vide existentiel est à l'origine de sa création et que, comme Lucas, il en a tiré des profits extravagants.
Même si David Fincher n'est pas tout à fait Orson Welles, l'analogie frappe avec Citizen Kane (1941). Même structure virtuose d'un récit éclaté en flashbacks avec intervention des personnages clefs, même figure de héros ambigu devenu légende controversée de son temps, même thématique autour de la puissance des media (les journaux hier, Internet aujourd'hui), de la construction du pouvoir et de la solitude au sommet. Même portrait en creux d'un pays et d'une époque que l'action du héros aura contribué à modeler. Question cinéma, Fincher n'a ni les capacités d'invention ni les ambitions formelles de son aîné, c'est entendu. Mais il se débrouille bien. Très bien même en arrivant à faire un film passionnant avec un matériau de départ très relativement excitant : la création d'un site Internet. Il y réussi en s'inspirant des mécanismes de la comédie américaine de la grande époque. Certains ont noté que l'intensité des dialogues d'Aaron Sorkin rapprochait The social network de His girl friday (La dame du vendredi - 1940) du spécialiste du genre, Howard Hawks (tiens, un histoire de journalistes).
Qu'est-ce que Facebook ? Un site Internet. Fincher filme donc des adolescents alignant des lignes de code, des heures voire des jours durant, piratant des réseaux pour se distraire. Il fait le portrait d'un monde qui ne se sépare plus de son ordinateur portable ou de son i-phone, tapotant avec acharnement en cours, à table, en soirée, au réveil, un véritable postulat de science fiction devenu réalité.
Qu'est-ce que Facebook ? Un réseau. Ficher nous montre donc le réseau d'origine, celui des élèves de ces écoles américaines prestigieuses, Harvard en l'occurrence. Fraternités d'élèves, monde codé de copains et de coquins, obsédés par le pouvoir et la réussite. Il montre au sein de ce réseau le besoin fou de communication, d'être accepté, intégré, qui masque mal l'absence de véritables relations.
Qu'est-ce que Facebook (enfin) ? Du langage, des phrases et des idées jetées en vrac à ses « amis » (puisque tout le monde est ami sur Facebook). Une communication basique et forcenée, le plus souvent artificielle car réduite à sa plus simple expression : « Je suis à Paris », « Je vais me recoucher », « Je n'aime pas quand il pleut », « T'as vu le dernier Fincher ? »... Et les films de gladiateurs, tu les aimes ?
Bon, je persifle. J'utilise Facebook et il paraît que Fincher non. Les blogs ont séduit ceux qui écrivent, photographient ou dessinent. Les musiciens aiment bien Myspace. Facebook n'as peut être pas trouvé (encore) sa véritable voie. Mais je me pose la question : Qu'est-ce que Fincher pense de tout cela, au fond ? Le film ne répond pas à la question. Fincher montre, mais reste à distance. La réussite du film, c'est la traduction visuelle et sonore de l'essence de Facebook et de l'état d'esprit qui a présidé à sa conception. Les gens y parlent pour ne rien dire. La première scène est emblématique avec ses répliques qui défilent sur un rythme de mitraillette entre Zuckerberg et la fille qui va le plaquer. Les phrases, comme tirées de quatre conversations différentes, se chevauchent et se percutent sur un brouhaha de fond qui met l'attention à rude épreuve. Au milieu de ce chaos sonore, Fincher organise un impeccable champ/contre champ, merveilleusement posé, qui pénètre au fond des âmes perdues de ses deux protagonistes. Et quand Zuckerberg comprend finalement ce que lui dit sa compagne, c'est le début de l'histoire, la construction de la légende.
Le film va continuer à décliner ces formes de la parole, faisant se succéder les joutes verbales qui restent des monologues à plusieurs. On ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, on s'interprète mal, les livres (le code de conduite d'Harvard) n'a plus de sens, il faut une armée d'avocats pour se parler avec son vieil ami, son seul ami devenu un étranger. Les regards captés par Fincher disent les désarrois, les déceptions. « Ai-je votre attention M Zuckerberg ? » - « Non ». Et le grand gourou de la communication virtuelle, de l'amitié à grande échelle de regarder par la fenêtre, le regard perdu dans le vague, ailleurs. Mais où ? Nulle part parce qu'il est bien incapable de dire quelque chose.
Les acteurs font admirablement passer cet entre-paroles, aidés par un réalisateur qui a toujours eu la faculté de nous faire pénétrer dans des mondes intérieurs : la prison spatiale de Alien 3 (1992), la ville pluvieuse de Seven (1995), le mental schizophrène de Fight club (1997), l'univers ludique de The game (1999), après j'ai décroché. The social network se situe dans la continuité de ces films, sans doute des autres opus fincheriens, tout en étant cette fois plus rigoureux, moins dépendant d'effets, des artifices parfois fatigants du cinéma de genre, d'une esthétique trop tape-à-l'oeil. Joli sens du rythme avec le montage de Kirk Baxter et Angus Wall, musique étrange de Trent Reznor, photographie sophistiquée de Jeff Cronenweth dont l'artificiel colle au réel policé de la couche virtuelle de Facebook sur le monde.
David Fincher Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Inisfree Sais pas. Mais c'est pas mal pour conclure.
Mark aime ça.
Panoptique D'autres avis si tu cliques sur mon lien.
23:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : david fincher | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/11/2010
Mouvements du bassin sur TCM (dommage que je n'ai pas la télé)
22:07 Publié dans Acteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : john wayne | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/10/2010
De la mort - partie 2
Suite et fin du questionnaire proposé par Cinématique. Plein de réponses passionnantes sur les blogs à gauche, que j'imagine Ludovic va se faire un plaisir de compiler.
9 - Quelle séquence d'enterrement vous a semblé la moins convenue ?
Celui de la famille d'Ethan Edwards dans The searchers (La prisonnière du désert – 1956) de John Ford. Cela commence dans le plus pur registre fordien avant que John Wayne n'interrompe la cérémonie d'un « Put an amen to it » pour filer à la poursuite des comanches qui ont enlevé sa nièce.
10 - Quel est votre fantôme fétiche ?
L'héroïne de Carnival of souls (1962) de Heck Harvey jouée par Candace Hilligoss. Dans un registre plus léger, ceux de René Clair.
11 - Avez-vous déjà souhaité la mort d'un personnage ?
Souvent. Je vais mettre de côté les personnages pénibles parce qu'ils sont joués par des acteurs pénibles. Pour les autres, je suis souvent exaucé, le cinéma étant un art éminement moral. Restent les cas particuliers, ceux qui me laissent avec une terrible frustration et dont le plus emblématique est le Tigrero joué par Klaus Kinski dans Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) de Sergio Corbucci. Je suis condamné à souhaiter sa mort pour l'éternité. Photographie empruntée à Frédérique.

12 - A l'approche de votre mort, si vous aviez le temps de mettre en ordre vos affaires, quel film souhaiteriez-vous avoir la possibilité de regarder une toute dernière fois ?
Rio Bravo. Histoire de partir sur une bonne impression.
13 - Pour quel tueur en séries avez-vous de la fascination ou à défaut de l'indulgence ?
Franck, joué par Henry Fonda dans C'éra una volta il West (Il était une fois dans l'Ouest - 1968) de Sergio Leone qu'il serait dommage de ne pas citer quand on parle de mort au cinéma. Photographie DR source Time.

14 - Quel est votre vampire de chevet ?
Ingrid Pitt. Photographie Hammer Films.

15 - Quel film retenez-vous parmi tous ceux dont le titre (original ou traduit) évoque la mort ?
Coïncidence amusante, je viens d'acquérir deux films qui m'ont séduit par la musicalité de leur titre, deux gialli : La Morte cammina con i tacchi alti (1971) et La Morte accarezza a mezzanotte (1972), tous les deux de Luciano Ercoli avec la belle Nieves Navarro.
16 - Rédigez en quelques lignes la future notice nécrologique d'une personnalité du cinéma.
JLG n'est plus. C'est vraiment dégueulasse.
17 - Quelle représentation d'exécution capitale vous a semblé la plus marquante ?
L'exécution du cheminot dans La bataille du rail (1946) de René Clément.
18 - Quel est votre cimetière préféré ?
Tous les cimetières fordiens et Sad Hill du côté de la tombe d'Arch Stanton.
19 - Possédez-vous un bien en rapport avec le cinéma que vous pourriez coucher sur votre testament ?
Ma caméra. Et tout le bazar qui va avec.
00:09 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/10/2010
De la mort - Partie 1
Après l’érotisme, Ludovic de Cinématique nous propose un nouveau questionnaire tout à fait stimulant sur la mort au cinéma en 19 questions. Voici qui tombe à pic à l'occasion de ma période de ralentissement automnal.
1 - Quel est le plus beau meurtre cinématographique ?
Le meurtre inaugural du Suspiria (1976) de Dario Argento ayant été beaucoup cité, à juste titre, mon choix bien embarrassé se portera sur celui de Kuan Yu-lo joué par Ti Lung dans Bo sau (Vengeance – 1970) de Chang Cheh. Une scène aussi sanglante qu'excessive qui inspirera John Woo.
2 - Quel est à vos yeux le cinéaste le plus morbide ?
Steven Spielberg. C'est du moins l'une de ses nombreuses fascinantes facettes. (Photograhie Movieset).

3 - Et le film le plus macabre ?
Pat Garret and Billy the Kid (1973) la marche funèbre de Sam Peckinpah. (Photographie : DR).
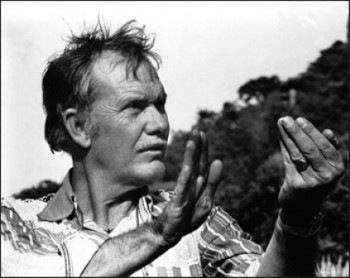
4 - Quel est le personnage dont la mort à l'écran vous a le plus ému ?
Setsuko, la petite fille dans Hotaru no Haka (Le tombeau des lucioles – 1988) de Isao Takahata. Je crois que je ne m'en remettrais jamais. (Photographie Animepaper).

5 - Celle qui vous a le plus soulagé ?
Celle de Mr Blonde dans Reservoir dogs (1992) de Quentin Tarantino, interrompant la plus éprouvante des séances de torture. (Photographie Thecia).

6 - Quel est votre zombi favori ?
Karen Cooper, la petite fille à la truelle qui aime si fort ses parents, jouée par Kyra Schon dans Night of the Living Dead (La nuit des morts vivants - 1968) de Georges Romero. (Photographie Examiner.com).

7 - Pour quelle arme du crime, gardez-vous un faible ?
Toutes celles dont ce n'est pas la destination première. Par exemple le gigot utilisé dans un épisode de Alfred Hitchcock présente : Lamb to the Slaughter (Coup de gigot). Photographie Wikipedia.

8 - Quelle personnification de la mort vous a le plus marqué ?
Django chez Sergio Corbucci.
22:59 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : questionnaire | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |


























