19/09/2010
Les joies du bain : hommage
Jacqueline Sassard (détail) dans la baignoire de Les biches (1967) de Claude Chabrol. Sur le genou, le regard de Stéphane Audran. Magique.

23:23 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/09/2010
Claude Chabrol 1930-2010
Ma première idée a été de faire un article un peu complet sur ma relation au cinéma de Claude Chabrol, et puis, en lisant l'hommage de Griffe à travers les textes qu'il avait déjà consacré au réalisateur, je me suis rendu compte que j'avais déjà écris cela. C'était en juin 2009, à l'occasion du Chabrol blog-a-thon lancé par Ray de Flickhead (qui publie un bel hommage aussi). Je ne vois rien à ajouter à ce texte, si ce n'est ce qui est venu depuis quinze mois enrichir ma connaissance du cinéma chabrolien. Il y a eu la découverte de Les biches (1968) et hier soir des Noces rouges (1973), une seconde vision de La fleur du mal (2002) qui m'a fait revoir le film à la hausse, nettement, et puis surtout le dernier, Bellamy (2009), sur lequel j'ai eu très envie d'écrire mais l'inspiration n'est pas venue et le temps a manqué. Je le regrette parce que c'est un film qui m'a beaucoup plu, tout à fait dans la dernière manière de Chabrol que j'aime beaucoup. Cette façon de filmer la masse de Depardieu envahissant l'écran, opposée à la silhouette fine de Gamblin, cette idée que l'enquête que l'on suit n'est pas celle qui est menée mais que, comme avec la lettre volée de Poe, elle est tout le temps devant nos yeux, cette assurance tranquille dans la mise en scène, épure que certains ont confondu avec légèreté, cette façon de filmer ses actrices, c'était du grand Chabrol et, au bout du compte, une belle façon de partir. Voici donc, et après avoir bu un excellent Médoc :
J'ai un peu hésité avant de partir sur un article d'ensemble tellement ma relation avec l'œuvre de Claude Chabrol est chaotique et présente de lacunes. Mais à la réflexion je me suis rendu compte qu'elle avait été présente tout au long de mon parcours cinéphile (on va dire ça comme ça) et surtout que certains de ses films, des images, des moments venus de ses films, me ramènent, sinon à l'enfance, du moins à l'entrée en adolescence. Ainsi Romy Schneider, allongée nue dans un parc, recevant sur son corps un cerf-volant et forçant de manière provoquant le jeune homme venu le récupérer à le prendre, est une de mes premières images érotiques fortes au cinéma. Jusqu'à ce que je retrouve l'extrait grâce à Internet, j'aurais été incapable de vous dire que c'était un film de Chabrol, Les Innocents aux mains sales (1975), ni même qui était l'actrice. Mais que l'on évoque cette histoire de cerf-volant et la scène revivait sous mes yeux. Je me souviens aussi très bien de l'impression que m'avaient laissés Le boucher (1970) et l'un des films avec le couple Stéphane Audran – Michel Bouquet, peut être bien Juste avant la nuit (1971), découverts à la télévision. Pour moi, vers 1974/1980, ces films représentaient un cinéma « adulte », que je ne comprenais, ni forcément appréciais toujours, mais qui m'ouvrait d'autres horizons que celui que je pratiquais plus naturellement, celui du western en particulier. Je découvrais des préoccupations d'adultes, des histoires plus sombres, des résolutions moins tranchées, des personnages plus quotidiens, au physiques « ordinaires » comme ceux incarnés par Jean Yanne ou Michel Bouquet. Avec le recul, je me rends compte que ce sont des acteurs que j'ai toujours aimé par la suite. J'avais aussi raconté il y a quelque temps, comment était né le désir de voir Nada (1974) à partir de simples photographies sur un programme de télévision, Et comment ce désir est resté lové dans l'inassouvissement jusqu'en 2007. C'est étonnant comme un cinéphile peut être têtu. Et comment certains films peuvent vous séduire par trois fois rien.

Mes parents, je crois, ont toujours apprécié le cinéma de Chabrol. J'ai très vite pris l'habitude d'aller au cinéma seul, j'ai donc un souvenir assez précis des quelques fois où j'y suis allé en famille ou avec l'un de mes mes parents. Pour Chabrol, je le rattache à une séance avec ma mère du Cheval d'orgueil, à sa sortie en 1980. nous avions été au Mélies, à Nice, un petit cinéma Art et Essai aux salles format poche typique de ce qui se faisait à l'époque. Il a disparu depuis, mais c'était le genre à garder un film comme Diva (1981) de Beineix pendant plus de deux ans. Le cheval d'orgueil est tiré du roman autobiographique de Pierre-Jakez Hélias sur son enfance bretonne et qui connu à l'époque un gros succès. L'histoire se déroule au début du XXe siècle. J'imagine que ma mère, qui avait aimé le livre et qui avait passé ses vacances enfant en Bretagne, était attirée par la reconstitution. De mon côté, j'avais aussi aimé le livre et je gardais un frais souvenir des nombreuses vacances passées là-bas. J'ajouterais perfidement que, exilé sur la Côte d'Azur, je regrettais les vastes plages de sable fin de la baie d'Audierne face aux douloureux galets de la promenade des anglais. Du film, je garde là aussi une impression d'ensemble, un rythme posé, presque lent donc inhabituel pour moi, peu de dialogues, le vert des paysages et le côté intimiste de scènes entre François Cluzet dans l'un de ses premiers rôles et Bernadette le Sachez qui jouait la mère, une actrice au physique très doux, à la rousseur pâle que j'ai regretté de ne pas avoir vue plus souvent. J'avais aussi été marqué par cette scène, très chabrolienne à la réflexion, où le marquis (Michel Robin), patron du grand père (joué par Jacques Dufilho) employé comme domestique, lui demande de lui cracher dessus pour se faire pardonner une insulte d'honneur. Cette façon de montrer les relations de classe est très proche de ce que Chabrol fera quinze ans plus tard dans La cérémonie.
Curieusement, je n'ai pas suivi Chabrol dans les années 80. J'avais pourtant aimé Violette Nozière (1978) et l'adaptation télévisée de Fantomas vers 80 dont Chabrol réalisé deux épisodes. J'y suis revenu avec L'enfer (1994) et surtout La cérémonie (1995). Ce dernier film, je crois, a été pour beaucoup une redécouverte de Chabrol. Peut être avait-il atteint une nouvelle maîtrise de son art. Peut être que j'avais atteint l'âge de l'apprécier pleinement mais dès lors, je suis devenu un fidèle, avec une véritable passion pour des films comme Au coeur du mensonge (1999) et La fille coupée en deux (2007). C'est qu'il n'est pas facile à suivre, Chabrol. Après un démarrage brillant au coeur de la Nouvelle Vague, entre Truffaut et Godard, il n'hésite pas à se tourner vers un cinéma très commercial, des films de genre comme les épisodes du Tigre avec Roger Hannin. Les biches en 1968 ouvre un premier âge d'or, une période riche de sa collaboration avec Stéphane Audran. Les années 70 seront plus chaotiques, avec des échecs, des incompréhensions, une rupture assez large avec la critique. Les années 80 poursuivent ce mouvement mais contrairement à ses camarades de la Nouvelle Vague (sauf Truffaut qui meurt), Chabrol négocie la transition avec le public, notamment à travers les films populaires mettant en scène l'inspecteur Lavardin. Le début des années 90 verront Chabrol retrouver l'appréciation de son travail de réalisateur avec un sommet, La cérémonie.

Il a désormais un statut bien établi, une image respectable et respectée, même si ses films ne manquent pas de mordant. Je pense qu'il n'en est pas dupe. Son sens de l'humour et sa conception de la mise en scène, influencée par deux de ses maîtres Alfred Hitchcock et Fritz Lang, masquent la force de son propos jusqu'à ce qu'il éclate brutalement au visage du spectateur. La violence qui éclate souvent à la fin de ses films est le résultat d'un patient travail de sape opéré tout au long du film. Chabrol, comme Lang et Hitchcock est un grand maître de la frustration, de l'irrésolu, de l'inassouvi, du manque. Ses personnages n'en sont pas toujours bien conscients, mais cela les ronge, jusqu'à la folie, jusqu'au mensonge, jusqu'au meurtre, jusqu'à l'absurde quand le vide des vies révèle l'étendue de sa béance. La scène la plus emblématique de cette révélation serait pour moi celle tirée de La femme infidèle (1969) qui exprime un si terrible désespoir. Face à ce vide la bonne conscience de la bourgeoisie se désagrège et provoque la violence. L'intelligence de Chabrol est d'avoir aussi montré que le recours à cette violence, dans un rapport de classe, mène à une impasse, celle des anarchistes de Nada comme celle des jeunes femmes de La cérémonie ou la réaction de Violette Nozière. L'intelligence de Chabrol est de l'avoir montré dans toute sa complexité, de chercher à comprendre sans jamais chercher à juger, mais sans jamais renoncer à son regard caustique. Aujourd'hui, l'oeuvre de Chabrol m'apparaîtrait plus riche et plus cohérente, globalement, même si elle n'a pas l'homogénéité de cette de Truffaut. De même sa mise en scène, discrète mais précise, se dissimule sous une certaine bonhomie et n'a pas les fulgurances de celle de Godard. Elle nécessite un peu d'efforts pour révéler ses beautés, le charme de ses mouvements, le sens des raccords, la sensualité des plans. Plus proche de Rohmer, il reste avant tout un conteur, mais il a le cinéma chevillé au corps. Chabrol est un pessimiste gai et son cinéma est toujours aussi précieux.
A lire aussi le texte hommage de Ran sur De son coeur le vampire
Photographies : Tout le ciné et Mo(t)saïques
00:15 Publié dans Cinéma, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/09/2010
Sumo ou le petit film sympathique

Certes, Sumo est un petit film sympathique. Mais qu'est-ce qu'un petit film sympathique ? Généralement c'est un film que le chroniqueur peut expédier en trois lignes, soit qu'il le juge indigne de son attention soutenue, soit qu'il ne sache comment aborder une mise en scène peu spectaculaire qui échappe à son analyse. Caractéristique du petit film sympathique, on y prend du plaisir. Pas un plaisir intense, pas une grande émotion intellectuelle, pas une bouleversante expérience spirituelle, non, simplement c'est un bon moment. Mais gardons nous de toute condescendance. Souvent, le petit film sympathique est drôle. Il n'est pas signé d'un réalisateur important, possédant une forte personnalité, un talent ou un style particulier. Quand un réalisateur important signe un petit film sympathique on parle de film mineur. Mais bon, il faut bien avouer que nombre de petits films sympathiques sont plus agréables à voir que maints chef d'œuvres certifiés mais il est beaucoup plus dur de trouver quelque chose à dire dessus. On revoit assez rarement les petits films sympathiques, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Quand cela arrive, la déception est souvent au rendez vous. Le petit film sympathique donne son maximum à la première vision. Il est fait pour cela. Il arrive parfois qu'on ne soit pas déçu, voire que l'on finisse par prendre un plaisir pervers à cultiver le petit film sympathique. On peut alors parler de plaisir coupable, comme moi avec Io sto gli ippopotami (Cul et chemise – 1980), petit film sympathique du duo Bud Spencer et Terence Hill signé du modeste Itallo Zingarelli. Pas facile donc d'aborder un film comme Sumo, mais à Kinok, nous n'avons pas pour habitude de reculer devant la difficulté.
A lire sur Kinok
Photographie : capture DVD Océans films
07:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sharon maymon, erez tadmor | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/09/2010
Et merdre !

12:23 Publié dans Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : claude chabrol | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
11/09/2010
Mauvais souvenirs - bonus
Je ne pouvais achever le récit de mes mauvais souvenirs en salle sans évoquer ma rencontre avec le cinéma de Marguerite Duras, souvenir revenu à la surface à l'occasion d'un commentaire de Ran. Je pourrais dire que je me suis ennuyé ce qui ne serait ni original, ni juste. Généralement, j'essaye d'aller voir toutes sortes de films de toutes sortes de réalisateurs, au moins une fois, même s'il s'agit de cinémas dont je ne me sens pas proche. Curieux, oui. Duras donc, pourquoi pas ? Me voici donc parti pour une séance de Baxter, Véra Baxter, tourné en 1977. Loin de me plonger dans la torpeur, le problème que j'ai eu avec ce film est qu'il a tendu mes nerfs comme une corde à violon. Le pire est que je ne me souviens de rien. Il y a Gérard Depardieu et Delphine Seyrig et je n'en ai aucun souvenir. Rien de rien sauf de la musique. Celle-là je ne risque pas de l'oublier. Elle est signée Carlo d'Alessio et en fait elle est bonne même si je ne suis pas tres amateur de flutes des Andes. D'Alessio en outre a composé la bande originale de India song (1975) qui est superbe et dont la chanson titre interprétée par Jeanne Moreau me transporte. Alors quoi ? Alors l'héroïne débarque dans la sation balnéaire normande, la musique d'Alessio commence, flûtes aigrelettes et guitares sud américaines qui moulinent. On nous dit que des musiciens répètent pour une fête. D'accord. La musique ne va pas cesser jusqu'à la fin du film, 90 minutes plus tard. Au bout de dix minutes, je m'agite, au bout de vingt je comprends que je suis soumis à une variante du supplice de la goutte. Et ça boucle, et ça bloucle, ça m'obsède au point que, voilà, je n'ai plus rien suivi du film. Sauf à un moment, un petit miracle. Véra Baxter téléphone à son mari (voix de François Périer). Coupe, plan sur le téléphone chez le mari. Miracle, le mari habite loin, Alessio n'est pas audible. Moment de silence, de grâce. Je souffle, les sens suspendus. Le téléphone sonne. Le mari décroche et qu'est-ce que l'on entend dans le combiné ? Gagné.
Nous n'étions pas nombreux dans la salle, mais tout le monde, au même instant, à éclaté de rire. Un vrai bon rire libérateur. J'ai poursuivi le film plus décontracté pendant un quart d'heure puis les boucles d'Alessiennes ont recommencé à me grignoter le cerveau jusqu'à la fin. D'une certaine façon, Duras rejoint ici Michael Bay dont les bandes sonores agressives saturent l'espace sonore, étouffent le film et me plongent dans un état de crispation que je n'apprécie guère.
17:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : marguerite duras | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2010
Mauvais souvenirs - Partie 2
On est parfois trahi par soi-même. Ma plus douloureuse expérience physique, je la dois à une séance hélas inoubliable du Casino (1996) de Martin Scorcese. C'était une séance du dimanche matin. Je tenais à voir le film mais, la veille, j'étais souffrant ou j'avais un peu trop bu, je ne me souviens plus. Ce dont je me souviens bien, c'est que j'avais les entrailles tordues pire que John Hurt dans le Nostromo. Le problème, c'est que le film dure pas loin de trois heures et qu'il est bon. Enfin, j'étais complètement accroché. Pas question donc de m'interrompre pour filer aux toilettes et manquer un plan. En fait, vu le montage de Scorcese, c'est un paquet de plans que j'aurais manqué à chaque interruption. Je me suis donc accroché, m'agitant dans mon fauteuil comme un ver, développant un mal de tête carabiné, les yeux brûlants, pleurants. Je suivais le film avec rage. Tenir, il faut tenir, comme un marines rampant sur Omaha Beach, j'ai tenu. A quel prix, je n'ose le dire. C'était une expérience limite dont je ne sais finalement pas trop comment elle a influencé ma vision du film. Mais maintenant, quand je suis malade, je reste chez moi.
Pour rester sur l'exploit physique, il y a eu, mais c'est devenu rare, l'état des fauteuils. A Nice, au milieu des années 80, nombre de petites salles ont fermé. Elles vivotaient et ne faisaient aucun investissement en terme de confort. J'ai un souvenir très vif d'une séance de C'era una volta il west (Il était une fois dans l'ouest – 1968) de Sergio Leone au cinéma Ritz sur la zone piétonne. C'était un cinéma avec trois salles, dont une était consacré au porno et les deux autres oscillaient entre semi-exclusivités et reprises parfois incongrues comme un peplum de Vittorio Cottafavi qui n'est pas à sa gloire. Cette fois là, c'était le Leone et un Leone en salle, ça ne se refuse pas. Problème, le Ritz avait des fauteuils assez anciens, épais, marrons, imitation cuir avec la rudesse d'un parpaing. Supporter les presque trois heures (encore) du film sur un tel fauteuil relève de l'exploit vertébral. Cette fois aussi, j'ai tenu (quel héros !) mais ce fut rude d'autant que la copie n'était pas de la première fraîcheur. Rayures, coupes sauvages, fin et début de bobines hachés, son pourri, de quoi se réjouir de voir le film dans la superbe édition DVD qui lui a été consacrée et renier ces fichues salles de quartier. Mais qu'est-ce que je dis moi ?!

Au seuil du multiplexe. Photographie source : Film reference
J'ai vécu l'enfer du multiplexe. Si. J'en avais eu un avant-goût en Belgique, pour une séance en IMAX, assez spectaculaire pour que j'oublie l'environnement. Mais mon expérience avec film s'est faite sur un redoutable navet. Je me suis laissé convaincre par ma compagne et sa soeur d'aller à une séance du samedi soir d'un multiplexe varois pour The Avengers, la version cinéma de Chapeau melon et bottes de cuir réalisée en 1998 par Jeremiah S. Chechik. C'étaient les vacances, nous étions en famille, je suis un admirateur de la série télévisée et des tenues cuir d'Honor Blackman puis de la divine Mrs Peel, je ne me suis pas trop fait prier. Le problème, c'est l'environnement. La salle est située au coeur d'une zone commerciale, le genre d'endroit que j'évite autant que possible. En face, un grand parking. De l'extérieur on dirait un hangar. A l'entrée, on se croirait face à une batterie de caisses d'hypermarché. Il y a des vigiles et j'imagine, des caméras de surveillance. J'ai surtout été heurté par la vision d'un vigile avec son chien, une de ces grosses bestioles que je déteste genre molosse. Mais qu'est-ce que ça vient foutre au milieu d'une salle de cinéma !? Dedans, c'est code couleurs a tous les étages, ça ressemble à tout, ça ne ressemble à rien. La salle est confortable, certes ce ne sont pas les sièges du Ritz, mais pour accéder à sa place, il faut marcher sur un tapis, un véritable tapis de pop-corn, de gobelets de papier, de sachets en tout genre. Immonde. En Hollande, je me souviens des canettes de bière en verre qui roulaient sous les sièges, mais il y avait une ambiance bon enfant et puis la salle était jolie. Misère. Avec ça, le film a été une déception terrible malgré Uma Thurman qui prenait la pose. Sean Connery cabotinait tant et plus, Ralph Fiennes était transparent, le film était raté dans les grandes largeurs. Jamais remis les pieds dans un endroit pareil. C'est peut être l'âge mais je m'y sens trop oppressé, l'odeur du pop-corn m'écoeure, l'horreur, l'horreur...
Ceci dit, on peut se heurter à d'autres problèmes dans les salles dignes de ce nom. Je ne compte plus les copies douloureuses, les mises au point hasardeuses, les lignes jaunes (blanches ou vertes) baladeuses et le son réglé comme il peut. Dans cette catégorie j'ai une affection toute particulière pour une projection de Dracula, prince of darkness (Dracula, prince des ténèbres – 1966) du grand Terence Fisher, projection à la cinémathèque de Nice que je vénère par ailleurs. Les films estampillé Hammer, c'est pas tous les jours que l'on a la chance de pouvoir les voir en salle, surtout en province. L'occasion était belle et si ce souvenir m'est pénible, c'est qu'il était associé à un grand espoir. Le film commence, grand écran, Techniscope sur toute la largeur, couleurs impeccables rendant pleine justice à la photographie de Michael Reed. Le film semblait avoir été tourné la veille. Pendant une vingtaine de minutes, c'est le bonheur. Deux couples se retrouvent dans un étrange château, l'un d'eux s'engage dans les couloirs sombres et puis patratas, Dracula est là, bagarre, Dracula tombe dans les douves gelées du château, il meurt, The end. Au bout de trente minutes ? Tiens non, nous revoilà ailleurs, Dracula ressuscite un peu plus tard. C'est le bon vieux coup de l'inversion de bobine. Sauf que cette fois, mis à part la première, aucune autre ne sera à sa place. Un vrai loto. Impossible de comprendre quoi que ce soit, pourtant, ce n'était pas non plus du Bergman. Un ami, un véritable fan, est ressortit en maudissant le projectionniste. Moi j'y suis retourné le dimanche suivant. Nous étions invités.

Pauvre bête ! (Photographie source Nova)
Parmi les mauvais souvenirs, il y a les films qui mettent mal à l'aise. Généralement, c'est voulu. Haneke le fait exprès. C'est pour secouer un peu le spectateur. Ça peut faire du bien mais il y a la manière. J'ai aimé être secoué par Oshima ou Pasolini et pourtant il y eu des séances terribles. Avec le temps, j'ai compris que je suis mal à l'aise quand il y a un brouillage entre la fiction et le réel dans le cadre d'une fiction. Typiquement, certaines scènes de sexe, quand je n'ai plus l'impression qu'elles sont jouées (hors films érotiques) peuvent me mettre mal à l'aise. J'ai beaucoup de mal aussi avec des scènes où les personnages se font faire une piqûre, que se soit pour se droguer, se soigner ou se faire tuer. Il faut dire que j'ai une sainte aversion pour les seringues. J'ai aussi un peu de mal avec la façon dont on traite les animaux. Le cafard de Leone et les poulets de Peckinpah (même si on les voit ensuite rôtis et mangés) me font tiquer. J'avais ainsi beaucoup souffert sur un film tchécoslovaque Konec srpna v Hotelu Ozon (Fin août à l'hôtel Ozone – 1966) de Jan Schmidt. On y suit les déambulation d'une dizaine de jeunes femmes dans un monde apocalyptique d'où les hommes ont disparu, ou presque. L'ambiance n'est pas folichonne mais bon. Le problème, c'est que les donzelles rencontrent au long du scénario divers animaux grandissant en taille et se rapprochant de l'homme (d'où allégorie) et qu'elles ont la sale manie de les tuer. La sale manie du réalisateur, c'est de le montrer en détail avec un sadisme d'autant plus gênant qu'il n'est pas truqué. Au début, c'est une mouche ou une araignée, on passe. Puis c'est un serpent écrasé par une pierre. Je m'agite un peu. Quand on passe à la vache puis au chien, ça commence à bien faire. J'imagine que c'était voulu mais j'ai passé un moment très pénible.
Je terminerais par un petit gars bien de chez nous, Gaspard Noé avec son incontournable Irréversible (2001). Là encore, j'imagine que le sale goût dans la bouche quand on ressort est prévu avec le film. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas tant le fond qui m'a gêné (j'en ai vu d'autres), que la forme. La scène du viol du personnage de Monica Bellucci aurait suffit à me faire détester le film, en partie à cause de ce que j'ai écrit dans le paragraphe précédent, en partie parce que c'est interminable et que, comme chez Haneke, je n'avais qu'une hâte, c'est qu'ils en finissent. Mais le plus éprouvant, c'est la première scène, celle du night club, encore une fois pas tant pour sa violence que pour son traitement. La musique techno à fond, les flashs rouges et les effets de stroboscope, c'est juste pas possible. Au bout de cinq minutes, j'aurais avoué tout ce que l'on voulait. C'est le film, en tant qu'objet, le plus agressif que j'ai jamais vu. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais endurer un truc pareil. J'ai rien fait, j'le jure. Mais je suis maso, j'ai repris un morceau de Noé dans le film à sketches Destricted (2006), même mise en scène avec les mêmes effets. Là, j'étais prévenu, j'ai réussi à me mettre dans un état second. De temps en temps, j'ouvrais un oeil et je vérifiais si le cauchemar ne s'était pas achevé.
08:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sergio leone, martin scorcese, jan schmidt, jeremiah s. chechik, terence fisher, gaspard noé | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/09/2010
Mauvais souvenirs - Partie 1
Pour changer un peu des listes des 10 meilleurs ceci et 15 meilleurs cela, je m'en vais vous narrer mes 10 plus mauvaises expériences au cinéma. Attention, j'ai bien écrit expériences et non pas film. J'ai vécu des moments douloureux, mentalement comme physiquement, avec de très bon films, voire des films que j'adore comme The searchers (La prisonnière du désert – 1956) de Ford. C'est une histoire que j'ai racontée en son temps. Je ne reviendrais pas non plus sur un autre souvenir traumatique lié à mon enfance et que je dois à Michel Lang, merci Michel, également raconté en ces colonnes. Donc voilà :
A tout seigneur, tout honneur. Ma profonde et totale aversion pour le cinéma de Michael Haneke date d'une séance cannoise de son premier long métrage, Der siebente Kontinent (Le Septième Continent) en 1989. Perturbé par la ressemblance avec les titres des films à monde perdu et grosses bestioles de Kevin Connor, je m'étais dis, sans rien en savoir : "Pourquoi pas ?". Et comme j'avais eu une place supplémentaire, j'avais entraîné avec moi une douce amie sur laquelle j'avais alors des vues. La pauvre... Le film, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le portrait d'une famille moyenne autrichienne, papa, maman et fifille, qui s'ennuient à mourir. Littéralement. Ils décident donc de se tuer et, avant de passer à l'acte, détruisent méthodiquement toutes leurs possessions, brisant les meubles, coupant les vêtements en fines lanières, jettant un à un les billets de banque dans les toilettes. C'est silencieux et interminable. Au bout d'une demi-heure, les sièges ont commençé à claquer, et jusqu'à la fin, ce fut l'exode dans la salle. Avec mon amie, nous avons commencé à regarder nos montres (j'en portais une alors) puis elle m'a demandé si je ne voulais pas sortir aussi. Je n'ai jamais eu autant envie de dire oui. Nous étions de plus en plus tassés dans nos sièges. Hélas, je mets un point d'honneur à ne jamais quitter un film en cours. On ne sait jamais. Il peut toujours y avoir un plan, un regard, un troisième rôle qui sauve in-extremis le film. Mais ceux qui étaient entrés ici devaient quitter toute espérance. Mon amie a été gentille, elle s'est laissé convaincre et nous avons tenu jusqu'au bout. L'agonie familiale s'étalait sur l'écran. Nous souhaitions leur mort plus rapide pour abréger notre supplice. Mais Haneke prenait son temps, la vache. Finalement, le père empoisonné bava, les yeux hagards, devant la neige sur l'écran de sa télévison. Noir. Lumière. Les quelques survivants dont nous faisions partie, hébétés, se sont extrait des vastes fauteuils pour sortir. Nous sommes allés manger une glace. Dehors, le monde était beau. Je crois que mon amie m'en a toujours un peu voulu quand même.

Photographie : Onlyne
Dans le registre interminable, Parsifal, le film de Hans-Jürgen Syberberg illustrant l'opéra de Wagner, a été le plus éprouvant. Déjà, je n'aime pas beaucoup la musique de Wagner, ou alors à petite dose sur fond d'attaque d'hélicoptères. Il se trouve qu'à l'époque, ma mère avait une amie et cette amie un fils un peu plus jeune que moi. Toutes deux s'étaient mises en tête que je pourrais aller au cinéma avec lui. Pour moi, le cinéma en salle, cela reste avant tout une activité solitaire. Je suis maniaque sur le choix de la place, je n'aime pas que l'on me parle pendant le film, j'aime pouvoir pleurer, rire ou m'énerver en paix. Pire que tout, je n'aime pas que l'on m'impose le choix du film. Et je n'avais aucune envie de voir Parsifal. M'y voici donc à contre-coeur, passablement remonté quand commence l'oeuvre. Pour ce que je m'en souviens, je n'ai guère apprécié les partit-pris de mise en scène de Syberberg et surtout j'ai détesté le héros. Maigrichon, la coiffure blonde frisée façon lagon bleu, cela n'est pas passé. Il chantait peut-être très bien, mais je l'ai trouvé pire que Lucchini chez Rohmer ce qui n'est pas peu dire. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à regarder ma montre et le film fait plus de quatre heures. L'enfer. Les yeux ont comencé à me brûler, la tête à me lancer. Avec Wagner, impossible de s'assoupir, d'ailleurs j'étais trop énervé pour y arriver. Je me tournais dans tous les sens sur mon siège. Parfois, je fermais les yeux et je pensais à Excalibur (1981) de John Boorman et je pleurais en silence.
Malgré cette terrible séance, j'ai cédé et remis cela avec mon jeune disciple. On a beau dire que la foudre ne frappe jamais deux fois un même endroit, cette deuxième tentative n'a pas été plus heureuse. L'olibrius m'a entraîné voir King Solomon's Mines (Allan Quatermain et les mines du roi Salomon ) réalisé (hem) par Jack Lee Thompson en 1985. Je me doutais que ce ne serait pas bon, j'ignorais que ce serait pire. Moi, grand vénérateur d'Indiana Jones, j'ai du supporter le pillage en règle des opus spielberguiens, le jeu grotesque de Richard Chamberlain, les cris de Sharon Stone débutante, les explosions d'arrière plan débordant sur les personnages d'avant plan, le saut à la perche dans la lave, les personnages caricaturaux et gesticulants, la musique de Jerry Goldsmith parodiant celle de John Williams, les transparences minables, les répliques lourdingues et l'incroyable scène où Quatermain et sa copine sont jetés par des cannibales dans une marmite géante et barbotent au milieu de légumes en plastiques. Le film semblait s'enfoncer sans fin dans une spirale de ridicule. J'ai souffert. Plus tard, j'ai lu le très beau roman de H.H.Ridder Haggard et j'ai soupiré.
En salle, l'enfer, c'est les autres. Les ronfleurs, les tousseurs, les renifleurs, les commentateurs, les froisseurs de papier de bonbon, désormais les croqueurs de pop-corn, une seule de ces engeances peut transformer votre séance en cauchemar. Je m'étais rendu ce soir là dans la petite salle art et essai que j'aimais fréquenter sur la place Garibaldi. Pour une raison inconnue, on reprenait Excalibur. La salle est très petite mais ça ne se refuse pas. J'entre, je suis seul, le film commence, c'est royal. Débarquent alors quatre personnes qui vont se révéler très vite s'être trompés de film, de salle, de cinéma, sans doute même de quartier. Après les remarques ironiques sur la rusticité de la salle, le film a été systématiquement moqué tout du long, avec rires gras et plaisanteries associées sans aucun égard pour ma petite personne. Je pense qu'ils ne m'ont même pas vu, enfoncé que j'étais au second rang. Bien sûr, je n'ai rien dit, je suis un garçon réservé et puis j'ignorais leur carrure. Prudence. Ce qui est terrible avec ces échappés de multiplexe, c'est que l'on finit très vite par voir le film comme eux. Ainsi, c'est la première fois que j'ai remarqué le tuyau qui fait jaillir la fumée de la bouche de Morgane jouée par la belle Helen Mirren. Mais c'est dur, très dur. Je les les ai maudits et s'ils se reconnaissent, qu'ils sachent bien que ma malédiction court toujours. Ils auraient pu partir, j'aurais dû sortir. Pour me consoler, j'ai revu le film plusieurs fois depuis et je me suis mentalement excusé auprès de John Boorman. Quelques années plus tard, à une séance de Cannes Classic de San duk bei do (La rage du tigre - 1971), le même phénomène s'est produit mais quelqu'un que je ne serais jamais a lancé un sonore "Fermez vos gueules !" et la poésie de Chang Cheh a triomphé. Ce souvenir est aimablement dédié à Père Delauche.
(à suivre)
12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : michael haneke, jack lee thompson, chang cheh, hans-jürgen syberberg, john boorman | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/09/2010
Les joies du bain : (une autre) bulle
La piquante Jeanne Crain fait des bulles de bien ludique manière dans Margie (1946) de Henry King. Il existe plusieurs variantes de ce bain mémorable, à vous d'explorer la Toile. En 1955, elle sera dans une autre baignoire fameuse pour King Vidor, une autre joie à venir.

Photographie : Source Life (recadrée)
11:52 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jeanne crain, henry king | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/09/2010
Sorties cannoises
Poetry a également suscité une polémique inattendue : le Kofic (Korean Film Council), l'organisme national de soutien au cinéma, note les scénarios de films et décide ensuite de les financer, ou pas. Le scénario de Poetry a obtenu la note zéro. Les médias ont raconté qu'en agissant ainsi, le gouvernement se vengeait contre l'ancien ministre de la culture que j'étais. Et puis j'ai eu le Prix du scénario à Cannes !
Extrait de l'entretien de Lee Chang-dong sur Le Monde, propos recueillis par Clarisse Fabre

Cette semaine sont sortis deux des films les plus remarquables de la sélection cannoise cru 2010. Je vous en ai parlé en mai mais le temps passe et si les écrits restent, il est possible de vous rafraîchir la mémoire sur Poetry de Lee Chang-dong et Lung Boonmee Raluek Chat (Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures) de Apichatpong Weerasethakul. Sur le premier, je ne saurais trop vous inciter également à lire l'article du bon Dr Orlof. Si vous avez un peu de temps devant vous, il y a également un entretien sur France Culture avec Apichatpong Weerasethakul.
23:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : apichatpong weerasethakul, lee chang-dong | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/09/2010
La Sandrelli
16:30 Publié dans Actrices, Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stefania sandrelli, pietro germi | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
31/08/2010
Crime d'amour
Quelqu'un devrait se dévouer pour dire à Alain Corneau (1) que l'image de son nouveau film, Crime d'amour, est moche. Numérique et moche ce qui est, d'une part bien dommage parce que le film en lui-même est plutôt réussi, d'autre part désolant venant de l'homme qui nous a donné les belles ambiances de polar de Police python 357 (1976), Le choix des armes (1981) ou Série noire (1979), et réalisé Tous les matins du monde (1991) dont la photographie raffinée marchait sur les traces du travail de John Alcott et Stanley Kubrick pour Barry Lyndon (1975). C'est peut être l'évolution actuelle de l'image de cinéma qui finit par ressembler à l'image de télévision mais je ne trouve là-dedans rien de réjouissant. J'avais déjà eu ce problème, nous dirons de goût, sur Lady Jane (2007) de Robert Guédiguian dont les scènes de nuit étaient aussi plutôt moches. Moches comment ? Leur grain fait ressortir leur aspect vidéo. Une image froide, plate, aux contours mal définis. Des couleurs fades, des noirs qui manquent d'intensité, une sorte de halo qui uniformise tout. Il y a aussi comme des traînées lors des déplacements des personnages ou de la caméra. Toute cela manque de contraste et la projection en salle, sur grand écran, accentue ces défauts qui passent presque inaperçus chez soi. Il faut dire aussi que l'on s'habitue à ces images immondes des nouvelles télévisions que j'ai beaucoup de mal, personnellement à regarder sans m'énerver.

Sur Crime d'amour, les scènes de jour ou les intérieurs bien éclairés font illusion. La première scène entre les deux héroïnes est même plutôt réussie question ambiance. Mais dans un film noir ou l'atmosphère est essentielle et délicate, beaucoup de choses ne passent pas. Il faudrait peut être se pencher sérieusment sur le travail de Jean-Luc Godard sur Film socialisme qui arrive, lui, à des choses magnifiques avec la même technologie. Chez Corneau, non seulement beaucoup de scènes nocturnes en extérieur passent mal, mais les plans de Ludivine Sagnier dans la salle de gymnastique ressemblent à ceux d'un mauvais film publicitaire. Certains gros plans des visages manquent d'un je-ne-sais-quoi, comme une sorte de voile qui ternirait les regards des actrices. Nous vivons un temps bien étonnant.
Le film lui, disais-je, est plutôt pas mal. Le scénario d'Alain Corneau et Nathalie Carter propose un exercice de style bien construit qui ramène tant à l'un des maîtres de Corneau, Fritz Lang et Beyond a Reasonable Doubt (L'invraisemblable vérité - 1956) qu'à Police Python 357. Toute la partie où s'accumulent les preuves à grand coup d'ellipses sur un rythme soutenu fonctionne, de manière inversée, comme la descente aux enfers que vit le personnage du policier naguère joué par Yves Montand. La jeune femme jouée par Ludivine Sagnier lui ressemble par bien des côtés, acharnée au travail, vivant dans un environnement dépouillé, déterminée, maîtrisant la douleur sur son propre corps, professionnelle, froide mais capable d'une humanité tout au fond. Ici, c'est juste un peu plus vicieux mais cela tient en haleine comme à la grande époque. La musique du lointain Orient de Pharoah Sanders est originale dans le contexte et fonctionne bien. Je suis moins convaincu par les décors, l'arrière plan urbain de tours de verre et d'acier, les couleurs froides, qui donnent dans le symbole classique si ce n'est convenu, et rappellent surtout le début de Matrix. La description du milieu de travail où évoluent les personnages me laisse avec la bonne vieille question : dans cette fichue Word company quelconque, comment arrivent-ils à gagner tant d'argent en se passant des dossiers toute la journée ? J'imagine que c'est dans l'intention critique de Corneau mais cela manque de crédibilité.
Côté acteurs, les actrices sont superbes. Kristin Scott Thomas est toujours aussi belle, raffinée et vénéneuse comme il faut. Patrick Mille est assez convenu en loup d'entreprise manipulé, mais Guillaume Marquet est une belle surprise en cadre dévoué à son supérieur hiérarchique. Ludivine Sagnier ne se déshabille presque pas, ce qui pourra en frustrer certains, mais elle joue de mieux en mieux, toujours plus assurée, plus nuancée, sobre comme il faut. Elle est aussi bien que chez Chabrol. Quand je songe qu'en d'autres temps, elle aurait été filmée comme Anne Baxter ou Gene Tierney... assez, je me fais mal.
Photographie © Pascal Chantier (Source : Allociné)
(1) : Écrit hier matin, dans le train, donc quelques heures avant d'apprendre la disparition du cinéaste. J'ai préféré ne pas retoucher le texte, personne ne dira rien à Alain Corneau. Je reste avec mes regrets photographiques mais pas mal de bons souvenirs, notamment comment il filmait la Deneuve. Finalement, de Police Python 357 à Crime d'amour, il y a comme une boucle qui se referme.
07:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : alain corneau | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/08/2010
Les joies du bain : dans le marbre
Glacé et sophistiqué comme dirait Gotlib : la belle Alice Taglioni dans la classieuse baignoire de Notre univers impitoyable (2008) de Léa Frazer.

16:25 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alice taglioni, léa frazer | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/08/2010
Tristesses
Patricia Neal était habituée aux bras des géants. Gary Cooper dans The foutainhead (Le rebelle – 1949), incroyable film de King Vidor, John Wayne dans Opération Pacific (Opérations dans la Pacifique – 1951) de Georges Waggner puis In harm's way (Première victoire – 1965) d'Otto Preminger où elle était deux fois lieutenant, et Michael Rennie dans le classique de la science fiction The day the earth stood still (Le jour où la terre s'arrêta – 1951) de Robert Wise, film où elle se faisait également porter dans les bras de l'immense robot Gort. Vue également chez Elia Kazan, Michael Curtiz ou Martin Ritt, elle a joué l'émouvante 2-E qui entretenait le personnage de Georges Peppard dans Breakfast At Tiffany's (Diamants sur canapé – 1961). Encore un peu de la légende de Hollywood qui s'éteint.

Photographie Dr Macro
La disparition de Bruno Cremer m'inspire à peu près l'inverse de celle de Bernard Giraudeau. Outre que j'aimais beaucoup son visage tourmenté et sa présence entre nonchalance et intensité, sa filmographie se révèle éclectique et excitante, traversant des horizons très divers du cinéma français, de ses débuts avec José Bénazéraf à sa fidélité à Pierre Schoendoerffer, de ses expériences avec quelques francs-tireurs comme René Allio, Anne-Marie Mieville, Edouard Niermans et surtout ses trois films avec Jean-Claude Brisseau, de ses rôles marquants pour Claude Sautet, Bertrand Blier, Yves Boisset, Costa-Gavras (il était L'homme de trop), Patrice Chereau ou René Clément (il est très bien en colonel Rol Tanguy), du meilleur film de François Ozon où sa présence absente hante tout le métrage en passant par le cinéma populaire de Labro ou Lelouch, sans oublier ses incursions dans un cinéma plus international avec Luchino Visconti, Vincente Aranda et assez marquant en ce qui me concerne, le rôle de Victor Manzon dans Sorcerer (Le Convoi de la peur – 1977) de William Friedkin. C'est à son image, ça a de la gueule.

Photographie DR
Je sais, j'avais dit que je préférais nettement Hayao Miyazaki à Satoshi Kon, mais quand même. Apprenant via Raphaël la disparition à 46 ans des suite d'un cancer du réalisateur et dessinateur japonais, cela me fait un peu mal. Je connais et apprécie quand même énormément Perfect blue (1997) et Paprika (2006). A son âge, un cinéaste n'en est qu'à se débuts (ou presque) même si Kon avait une très belle carrière derrière lui, déjà. C'est très triste parce que, contrairement aux deux précédents, il n'y a pas le sentiment d'un achèvement mais celui de promesses qui ne se réaliseront jamais.

Photographie DR
23:42 Publié dans Actrices, Panthéon, Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : satoshi kon, bruno cremer, patricia neal | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/08/2010
Le goût des belles choses





Livres anciens, tissus, sculpture, meubles, objets rares, peinture, architecture, en quelque sorte le musée idéal de Dario Argento dans La terza madre (2007). Captures DVD Seven 7.
15:59 Publié dans Cinéma, Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dario argento | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/08/2010
Dario Argento années 2000 - Partie 2
Non ho sonno a été une sacrée surprise car il est lui largement réussi. Composé quasiment intégralement de scènes qui ont motivé le maestro, il bénéficie en outre de la très belle composition de Max Von Sydow en inspecteur Ulisse Moretti, rattrapé par une affaire qui n'avait pu résoudre vingt ans plus tôt. Idée géniale du scénario de Dario Argento, Franco Ferrini et Carlo Lucarelli , Moretti subit les premières atteintes de la maladie d'Alzheimer. La recherche des traces du passé devient ainsi une plongée dans la mémoire fuyante de l'inspecteur et l'enquête se double d'une méditation sur le souvenir. Quand Argento ouvre son cinéma à des thèmes bergmaniens, cela donne une intensité peu commune à la sempiternelle quête du tueur. Sur cette base solide, le réalisateur se livre à de brillantes variations sur ses plus belles obsessions.

Le film s'ouvre sur une longue séquence de près de vingt minutes qui vous laisse à genoux. Trois parties. Une prostituée découvre par hasard qu'elle est tombée sur un bien macabre client et échappe à son appartement avec un dossier bleu électrique bourré de preuves. LA scène du train, huis-clos affolant, digne des meurtres inauguraux de Profondo rosso et Suspiria (à condition d'accepter le fait que les chemins de fer italiens roulent ainsi à vide !). Suspense intense, surprises à tiroir, caméra lancée à toute vitesse dans les couloirs des wagons, gros plans saisissants, utilisation au maximum de l'espace sur la longueur du train puis sur l'épaisseur des soufflets de séparation des wagons, réinvention du principe de la vitre qui isole la victime : du grand art. Et puis histoire de ne pas souffler, un passage de relais de la victime à celle qui n'a pu la sauver qui rappelle des souvenirs, avec un ultime rebondissement que je ne vous raconte pas. Quand même. Ambiance nocturne sous une pluie battante, la photographie de Ronnie Taylor, britannique à la belle carrière, est sophistiquée comme il faut, donnant aux extérieurs une allure de studio (la gare sous la pluie est splendide) et la musique des Goblin, fidèles au poste, enveloppe la musicalité du montage remarquable de Anna Rosa Napoli . Rien à dire de plus, nous sommes dans le tout meilleur Argento.

Le film ne retrouvera pas vraiment une telle intensité mais reste constamment inventif. Témoin une autre très belle scène, un plan séquence composé d'un lent travelling le long d'un tapis rouge dans un théâtre, strictement cadré sur des paires de chaussures qui vont et viennent dans un brouhaha de voix de coulisses. Jusqu'à cette paire de ballerines soulevées de terre sur un râle d'agonie. Magistral. Flashback traumatique remontant à l'enfance, témoin forcé et impuissant d'un meurtre, lourd secret familial, recherche de preuves codées dans de vieilles demeures, peur du noir et surgissement de la peur en pleine lumière, Non ho sonno était une bien belle façon pour Argento d'entrer dans le nouveau millénaire. Les pérégrinations de Moretti, (l'Odyssée d'Ulisse est un symbole transparent) qui tente de recoller les morceaux de cette vieille histoire servent au réalisateur à revisiter son cinéma. Variations sur quelques motifs éprouvés, Non ho sonno, peut aussi se voir comme métaphore d'un cinéma perdu. A commencer par celui du réalisateur lui-même. Le cinéma dont il cherche à retrouver la trace, comprendre comment il a disparu et avec lui le succès, le talent peut être, la faculté de faire vibrer les foules. Toutes choses qui se confondent ici avec l'art de l'enquêteur à l'ancienne et sa faculté à résoudre l'énigme. Pointe d'orgueil de la part du maestro, il brocarde à travers le regard de Moretti les méthodes actuelles et affiche son pessimisme sur la transmission possible de son art. Le film baigne ainsi dans une ambiance mortifère, nostalgique d'une époque révolue, tout en affirmant encore une fois l'alpha et l'oméga du cinéma de son auteur qui refuse de céder un pouce de terrain. Position tordue voire obtuse qui se révèle pour l'occasion fructueuse.
De Giallo, le petit dernier en attendant son film hommage à Dracula à venir (en 3D ai-je lu), il convient de dire qu'il repose sur un malentendu par ailleurs cyniquement entretenu. Le giallo, faut-il le rappeler, est à l'origine la littérature policière éditée en Italie sous des couvertures jaunes (giallo), devenu dans les années 60 un genre cinématographique des plus excitant. Qu'en 2008 Dario Argento tourne un film appelé Giallo, voilà qui annonce un programme précis. La série de couteaux sur l'affiche est tout aussi explicite. Pourtant, cette couleur jaune a un sens bien différent dans le film, sens que je vous laisse découvrir et Giallo n'a pas grand chose d'un giallo classique, et encore moins de ceux, classieux classiques de la première partie de carrière du maestro. Assez perfidement, je puis écrire que si je n'avais pas su que le film était d'Argento, je ne l'aurais pas forcément deviné. A ce stade, les admirateurs, s'il en reste, sont effondrés. Pourtant Giallo n'est pas un mauvais film. Simplement, c'est un solide thriller, sans éclat, carré, ressemblant à des dizaines de films de tueurs en série post Silence of the lambs (Le silence des agneaux - 1990) de Johnathan Demme. J'ignore les dessous détaillés de l'affaire, mais le film était conçu à l'origine par Argento pour sa fille Asia et Vincent Gallo. Les vicissitudes du cinéma étant ce qu'elles sont, L'un puis l'autre ont du renoncer. Auréolé de son oscar chez Polanski, Adrian Brody est entré dans le projet comme co-producteur et comme vedette, avec un double rôle pour faire bonne mesure.

Tu la vois ? Hop ! Tu la vois plus... Ecco.
Pour revenir à ce que j'écrivais plus haut sur les acteurs, il semble que Brody a mis la main sur le film et qu'Argento s'est artistiquement désengagé du film, faisant refluer son talent de Giallo comme le sang d'un organisme. Il a fait œuvre de mercenaire, ne laissant qu'une carcasse, solide certes, mais sans rien de lui-même. C'est ce qui m'a frappé à la vision du film. J'ai pris un certain plaisir à cette chasse au tueur fou dans Turin menée par la sœur d'une victime enlevée et un inspecteur un peu borderline, mais elle aurait pu être menée par n'importe quel autre cinéaste, ou presque. Un exemple significatif : le tueur nous est montré assez vite. Dans le giallo canonique, sa découverte tient le fil narratif jusqu'à la fin. Le tueur est une abstraction, le plus souvent masqué, cadré façon puzzle, de manière fétichiste : les mains gantées de noir (toujours jouées par Argento soi-même), le dos en amorce, la bouche soufflant sous la cagoule, les chaussures s'avançant dans l'ombre. Le tueur est une incarnation du mal absolu, ne dévoilant son visage qu'au dernier moment, si possible après quelques coups de théâtre bien sentis. Pas ici. De même la violence et les tortures infligées par l'abominable sont plus proches des jeux sadiques de la série Saw que des excès grand-guignolesques à dimension opératique qui sont la marque de Dario Argento. Intensité calculée et aucun véritable débordement. Comme si, après les envolées gores de La terza madre, Argento avait voulu montrer qu'il pouvait tuer comme tout le monde mais que cela n'avait aucun intérêt. J'avoue aussi un certain plaisir pervers à la prestation d'Adrian Brody. Dans son vaste bureau en sous sol, il est filmé avec une distance ironique, comme une caricature du héros tourmenté qu'il incarne, prenant des poses sophistiquées. Il faut le voir jouer de son regard de cocker avec de petits coups d'œil en coin comme s'il guettait la venue du cinéma d'Argento, un coup d'éclat de son réalisateur. Mais c'est le désert des tartares et Brody, stoïque, assume jusqu'au bout. A ses côtés, Mathilde Seigner se débrouille correctement mais la plus intéressante est Elsa Pataky dans le rôle de Céline, la sœur séquestrée, très belle comme toute victime argentesque, elle crie, souffre et se débat, cavale dans de sinistres couloirs artistiquement maculée de sang, digne héritière de quarante années de meurtres sexys.
Me restent à découvrir Ti piace Hitchcock ? tourné pour la télévision et Il cartaio (2004) qui ne devraient pas modifier de beaucoup l'idée d'une décennie inégale mais passionnante d'un cinéaste qui force le respect par sa fidélité à des formes définies au début des années 70. Aristocrate hautain qui préfère lacérer ses toiles plutôt que de céder à l'eau tiède, tournant envers et contre tout, refusant le silence forcé d'un John Carpenter, Argento n'a certainement pas dit son dernier mot.
Photographies : Copyright Medusa Films (captures DVD) et Horreur.net
08:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : dario argento | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/08/2010
Dario Argento années 2000 - Partie 1
La roche Tarpéienne est proche du Capitole. Voici une formule qui s'applique bien au cinéaste d'origine romaine Dario Argento. Argento ! Combien ce nom fut dans les années 70 synonyme de la peur la plus pure. Combien nous ont hantés, avec un h comme Halimi, ses lames d'acier luisant, ses éclats de verre sanglants, ses mouvements de caméra sinueux, ses rouges profonds, ses bleus vifs, ses grands espaces mortels et les deux yeux qui surgissent des ténèbres devant la fenêtre de Suspiria (1976). Continuateur de Mario Bava, Argento repousse les limites du travail sur les couleurs, le mouvement, les échelles de plan, la musique, et mène le giallo dans des territoires cinématographiques inédits. Pays de toutes les peurs, de tous les déchaînements sauvages, de toute poésie macabre. Dario Argento, comme à la même époque Lucio Fulci, John Carpenter, Georges Romero ou Brian DePalma impose un cinéma très personnel, tourmenté, obsédé, au sein du cinéma de genre et ouvre de nouvelles voies qui seront empruntées avec plus ou moins de fidélité dans les décennies qui suivent.

Autant commencer par le plus délicat. La terza madre, nul n'est censé l'ignorer, se veut le troisième volet de la trilogie des mères comprenant Suspiria et Inferno (1980). Chacun des films est centré sur un lieu maléfique, une demeure au sein d'une grande ville (Fribourg, New-York puis Rome) abritant une sorcière redoutable. Après Mater Suspiriarum et Mater Tenebrarum, c'est donc la mère des larmes, la terrible Mater Lachrimarum dont les méfaits sont mis en scène. Asia Argento prend la suite du personnage de Jessica Harper dans Suspiria et, bien malgré elle, perce le secret de la sorcière tandis que les cadavres s'empilent autour d'elle. A cause de ce lien très fort avec les films de la grande époque, La terza madre pouvait apparaître comme le film de la rédemption, le film du retour en force, le film qui pouvait encore réveiller l'attente des admirateurs, le film qui devait bénéficier de l'orgueil du maestro, forcément motivé par l'envie de clôturer en beauté sa trilogie. C'était sans doute mal connaître le bonhomme. Non, Argento n'est pas revenu aux délires baroques des années 70. Non, il n'a rien cédé à la nostalgie des façades bleues et rouges. Non, il n'a pas réussi son film. Mais, oui, c'est toujours complètement du Argento. C'est tellement du Argento que La terza madre synthétise les qualités et les défauts de tous les autres films passés et sans doute à venir. Cette fois comme amplifiés, malheureusement plus du côté des défauts.

Le premier, qu'il partage avec nombre de ses collègues du cinéma de genre, c'est le manque de direction d'acteur. Attaché à la mise en scène pure, Argento a toujours privilégié les mouvements d'appareils, les prouesses techniques (les très gros plans de Profondo rosso, l'utilisation de la Louma sur Tenebrae), l'ambiance soignée de façon maniaque, le montage à venir et le jeu avec le spectateur, l'idée cinématographique de la scène. L'acteur là-dedans n'est qu'un paramètre, souvent une silhouette qui doit prendre sa place entre scénographie complexe et effets spéciaux, tout comme les dialogues très souvent platement informatifs. Ce qui compte pour l'acteur c'est de savoir regarder (généralement un meurtre terrible) et éventuellement de bien crier. Dans ce système, la distribution des rôles est essentielle. Il faut des acteurs solides capables d'apporter par eux mêmes un supplément d'âme nécessaire pour que, quand même, il y ait un minimum d'empathie. Cela fonctionne avec Daria Nicolodi, Jessica Harper, Tony Franciosa, Karl Malden, Asia Argento, Giuliano Gemma, Max von Sydow ou David Hemmings. Du solide, pas des stars qui ne sauraient assez se fondre dans la mise en scène. Mais si l'acteur est mauvais, c'est la catastrophe parce que Dario Argento ne pourra pas l'aider. Dans La terza madre on trouve quelques prestations terribles. La jeune mannequin israélienne Moran Atias qui joue la fameuse mère censément diabolique a une poitrine sublime qui défie les lois de la gravité mais joue comme une endive. Elle n'est pas la seule. Le jeune premier est fadissime et les disciples de la mater semblent recrutés au sortir d'une boîte de nuit new wave si cela existe encore. Ainsi tout ce qui devrait glacer le sang dans les veines amuse ou désole, au choix. Cet aspect est renforcé dans ce film par la mise en scène même d'Argento. Particulièrement peu inspiré par certaines scènes qui semblent pourtant essentielles, il filme les catacombes où se déroulent les messes noires comme dans un mauvais peplum des années 60, photographie laide, décors et costumes fauchés sans une idée pour les sublimer. Cet aspect miteux étalé dans l'indifférence se retrouve dans les scènes censées illustrer les déchaînements de violence qui embrasent Rome. Trois figurants, deux flammèches, un peu de verre brisé, cette l'apocalypse est sûrement ce qu'Argento a filmé de plus mauvais dans toute sa carrière. A croire qu'il a refilé le boulot à un second assistant ou au fantôme de Bruno Mattei. L'impression de gâchis est douloureuse.

Pourtant, tout n'est pas perdu. Au je-m'en-foutisme de ces éléments répond dans le même temps le talent buté, rageur même dans les explosions de violence, d'un cinéaste qui jette sur l'écran comme une poignée de perles, des éclairs du cinéma qui l'a toujours intéressé. La terza madre est un « best of » Argento avec sa façon de filmer de vastes espaces clos en somptueux cinémascope (la série de portes du musée romain d'antiquités), sa faculté à faire naître la peur d'abord par la caméra qui semble prendre vie, sa mise en scène des mises à mort avec sa fascination pour le tranchant et l'expression d'un visuel sadique mêlant érotisme et souffrance. L'assassinat de Valeria Cavalli et de sa compagne est un beau morceau de bravoure éprouvant qui rappelle le meurtre des deux lesbiennes de Tenebrae. On retrouve bien entendu l'obsession du meurtre que l'on est obligé de voir en étant impuissant et reste originale la vision qu'Argento a de sa fille Asia, ici d'une sobriété identique à celle de l'héroïne de La sindrome di Stendhal. Et puis, sa façon de se rattacher à toute une culture, européenne et italienne. Un certain goût de la beauté. Argento s'attache à filmer les palais anciens, les bibliothèques, les beaux livres, les statues, les peintures, tandis qu'Asia jette symboliquement son portable par la fenêtre d'une voiture d'un geste méprisant. Une attitude que l'on peut qualifier de passéiste mais qui se rattache à toute une tradition du cinéma italien, de Visconti à Fellini, de Bolognini à Leone en passant par les Bava, Fulci et Martino, le plaisir de filmer des œuvres et des objets avec une histoire, objets rares loin des produits de série. Manière de signifier à quel monde on appartient. C'est là, si l'on est prêt à l'indulgence sur le reste, que se trouve le plus touchant de ce film sacrément malade.
(à suivre)
Photographies La terza madre source Cineblog
08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : dario argento | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
24/08/2010
Quatre films de Mauro Bolognini
08:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/08/2010
De retour
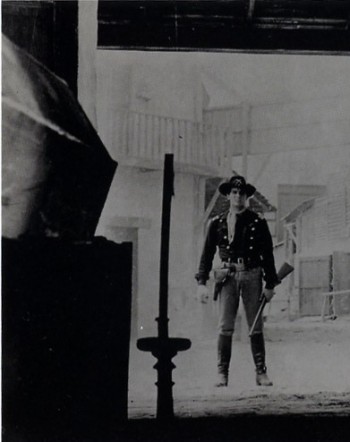
Phorographie : source Poetreated
13:29 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : duccio tessari, giuliano gemma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/08/2010
Les joies du bain : mélancolie
La grande Catherine dans la vaste baignoire noire de Pola X (1999) vue par Leos Carax. La grande bourgeoise dans son univers froid comme une tombe egyptienne. Le bain laiteux rappellera celui de Jeanne Moreau chez Losey.

Photographie DR
23:13 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leos carax, catherine deneuve | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/08/2010
Les joies du bain : circulaire
Une autre forme d'exotisme, Sally Forrest dans Son of Sinbad (Le Fils de Sinbad) film d'aventures orientales réalisé par Ted Tetzlaff en 1955.

23:08 Publié dans Les joies du bain | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ted tetzlaff | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |

























