07/03/2007
Le grand sourire
Je crois que je me souviendrais toujours de l'effet que me fit le final du Grand silence, le film de Sergio Corbucci. A ceux qui ne l'ont jamais vu et en ignorent tout, je conseille de lire une autre note de ce blog. Les autres me comprendront. C'était donc au début des années 80, à la télévision, un après midi. Je me souviens en être resté choqué, littéralement, d'avoir appelé un ami pour lui dire : « Mais tu as vu ce film, là, il manque pas un morceau ? ». C'était cela l'idée générale : je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Je ne voulais pas le croire et, pendant le générique de fin, j'espérais encore que quelque chose de normal allait se passer. Et je me souviens très bien que j'étais persuadé que le shérif, joué par Franck Wolf, allait surgir et régler son compte à l'abominable Tigrero, joué avec délectation par Klaus Kinski. C'était dans la logique du western classique. Je crois que, sur le coup, j'ai véritablement haï le film. Détesté son réalisateur, son scénariste, ses acteurs et toute son équipe. Plus tard, j'ai appris à apprécier l'ironie de tout cela et, petit à petit, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris aussi qu'une fin alternative avait été tournée pour le film, pour les États-Unis semble-t'il, une fin positive qui rendait bien compte de l'ampleur de la transgression de Corbucci. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette fin. Elle a été éditée dans le DVD de Canal+ et, voici quelques jours, je l'ai découverte sur Youtube. Et bien, figurez vous que c'est bien mon idée qui était la bonne. C'est bien le shérif qui surgit pour sauver la mise à Silence – Trintignant ! Étonnant non ? Voici donc ce morceau culte, hautement improbable, virant à la parodie avec ce superbe sourire de Trintignant et le clin d'oeil au final de Pour une poignée de dollars de Léone.
Tepepa avait joliment écrit que l'on pouvait voir ces images comme l'ultime rêve de Silence, la façon dont il aurait voulu que ça se passe. C'est surtout le fantasme du spectateur qui, comme moi habitué à des dizaines de duels remportés quelques soient les difficultés par les bons, se refuse à accepter la victoire totale du mal et cherche la moindre échappatoire pour son imagination. Et je crois que Corbucci a intentionnellement laissé planer le doute sur le sort du shérif pour laisser ouverte cette soupape à son public. Et mieux asséner son final nihiliste. On aura beaucoup écrit et parlé autour de cette fin. Foin de métaphysique et de politique, Corbucci a, avec humour, vengé des générations de méchants de James Bond, de romains d'Astérix, de Daltons, d'apaches attaquant les diligences, d'Iznogoud, de Shérif de Nottingham, tous qui malgré les plans les plus sophistiqués ont toujours fini par échouer. Et de répondre à la question que l'on se pose tous : « Et s'ils gagnaient pour une fois à la fin ? ».
Bonus : Jean-Louis Trintignant parle du film sur une archive de l'INA
04:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : western, Sergio Corbucci, document | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/03/2007
Temps oubliés
Le bon Dr Orlof n'hésitant pas à plonger dans les tréfonds du cinéma bis, voire ter, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice du regard critique sur ces films qui, sans nous, seraient à jamais couverts du sombre voile de l'oubli. The people that time forgot (Le continent oublié, 1977) de Kevin Connor, est la séquelle directe de The Land that time forgot (Le sixième continent, 1975) et le troisième volet d'une tétralogie inspirée des écrits d'Edgar Rice Burroughs (avec un peu de Jules Verne quand même) comprenant également At the earth's core (Centre terre, septième continent, 1976) et Warlords of Atlantis (Les sept cités d'Atlantis, 1978). Le premier de la série est un film qui a marqué mon enfance avec son sous marin découvrant un monde perdu au milieu de la banquise, monde peuplé de dinosaures en caoutchouc, d'hommes préhistoriques, de volcans en éruption, de héros inoxydables et de sauvageonnes charmantes. Ce film que je n'ai jamais revu, typique d'un cinéma fantastique pré-Star Wars, avait tout pour réjouir l'enfant de 10 ans que j'étais alors. Il avait également eu pas mal de succès et donc une première suite fut mise en route.

A suivre les nombreuses péripéties, je me dis que le scénariste Patrick Tilley a du soigneusement étudier Le secret de la planète des singes, la première séquelle du chef d'oeuvre de Franklin J. Schaffner réalisée en 1969 par Ted Post. On retrouve donc un nouveau héros (Ici Patrik Wayne fils de son père) partit en expédition à la recherche du héros du film précédent (Doug McClure). Arrivé dans le monde perdu, il retrouve la trace de son collègue grâce à une belle femme préhistorique et leur périple les amène dans une étrange cité de mutants vénérant une puissance dévastatrice (une bombe H ici, un volcan là). Les deux héros se retrouvent dans la prison des mutants et s'évadent. La puissance dévastatrice fait tout péter, monde perdu comme planète entière, mais l'essentiel des héros du continent oublié s'en sortent ce qui fait du film de Connor un film moins pessimiste que celui de Post. Mauvaise pioche pour le scénariste, le second volet des histoires simiesques est d'assez loin le plus mauvais, un authentique navet label rouge. Tilley et Connor en reproduisent malheureusement avec application les incohérences et naïvetés, la moindre n'étant pas la facilité avec laquelle le héros (le nouveau je veux dire) rencontre la sauvageonne au milieu de toute cette jungle. Le film perd avec dignité toute crédibilité par paliers. Au premier étage, le premier dinosaure, une sorte de stégosaure utilisé comme treuil. Second étage, la rencontre avec la belle Ajor, dont le décolleté sublime, la coiffure impeccable et le teint délicieusement halé la hissent à la hauteur des prestations similaires de Raquel Welch, Martine Beswick ou Victoria Vetri. Troisième étage, la découverte des mutants qui fait basculer le film dans le carnavalesque avec leurs armures japonaises et leur palais façon Conan. En passant, c'est David Prowse qui joue l'exécuteur, Prowse qui n'a pas joué que Dark Vador dans sa vie. Dernier étage, le combat avec le monstre de la caverne, grand moment de n'importe quoi qui force le respect par le sérieux manifesté par les acteurs. Pourtant...

Pourtant, le film dégage encore un certain charme. Il est facile d'ironiser sur les effets spéciaux et j'imagine que ceux qui n'ont connu que les prouesses du numérique disqualifieront aisément les monstres statiques de ce monde oublié. Mais les décors de la première partie, la banquise dans la brume, le vieil hydravion, fonctionnent bien. L'atterrissage catastrophe rappelle ceux du film de Howard Hawks, Seuls les anges ont des ailes. La musique de John Scott est une belle réussite, ample, aux sonorités tout à tour épiques ou étranges dans la lignée du travail de Jerry Goldsmith sur La planète des singes. Kevin Connor a un certain sens du rythme et une scène comme l'attaque du ptérodactyle est habilement montée. Il est aussi nettement plus à l'aise dans les extérieurs (tournage aux Canaries) que dans les décors de carton pâte qu'il peine à faire exister un minimum. Reste que j'apprécie toujours que les acteurs prennent leurs rôles au sérieux dans de telles conditions et ne succombent pas au second degré facile. Patrick Wayne est un héros correct qui marche sur les traces de son père dans le style célibataire bourru un poil machiste, Sarah Douglas campe une héroïne émancipée avec humour, ce qui lui vaudra, j'en suis resté surpris, une nomination aux oscars. Dans les seconds rôles, outre David Prowse, il faut mentionner Thorley Walters, pilier de la Hammer Films, en savant forcément farfelu, Doug McClure en héros invité et, surtout, surtout, la très belle Dana Gillespie dans le rôle du fantasme adolescent, Ajor, femme des cavernes à la sensualité nature. Pour elle, il sera beaucoup pardonné à ce monde perdu en mode mineur.
Photographie : capture DVD MGM et meekermuseum
Une belle série de photographies sur Monster Island
Critique sur DVDcritiques
Critique sur scifilms (en anglais)
Critique sur 100misspenthours (en anglais)
Critique sur Monster Hunter (en anglais)
Le DVD
15:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Fantastique, Kevin Connor | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/02/2007
Petit coup de nostalgie

Il ne faut jamais revenir
aux temps cachés des souvenirs
du temps béni de son enfance.
Car parmi tous les souvenirs
ceux de l'enfance sont les pires,
ceux de l'enfance nous déchirent.
06:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : souvenir, Walt Disney | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/02/2007
Les défaitistes de tout poil vous saluent bien
Il y a quelques jours, le dépliant publicitaire Métro publiait un entretien avec notre ministre de la culture RDDV. Extraits (Entretien intégral ICI) :
Je suis très heureux de voir qu’il y a un public de plus en plus nombreux pour le cinéma français. Il y a un nombre de films produits tout à fait considérable, 203 en 2006, et la part du cinéma français en salles est plus considérable que jamais. Ce qui montre aux défaitistes de tout poil qu’on peut ne pas subir une domination extérieure dans le domaine du cinéma.
[...] je crois que tout le système français est bâti au maximum pour épauler les indépendants.
Un risque de formatage ? Mais jamais le cinéma d’auteur n’a été aussi vivant ! Il rencontre un grand succès public, même s’il y a de l’inquiétude sur l’audience du cinéma à la télévision, concurrencée par les séries américaines.
Passablement énervé, j'ai commencé à ruminer un texte et puis, ce matin, Libération publie le texte du discours de Pascale Ferran aux Césars. Ca me semble bien comme réponse.
Nous sommes nombreux dans cette salle à être comédien, technicien ou réalisateur de cinéma. C’est l’alliance de nos forces, de nos talents et de nos singularités qui fabrique chaque film que produit le cinéma français.
Par ailleurs, nous avons un statut commun: nous sommes intermittents du spectacle. Certains d’entre nous sont indemnisés, d’autres non; soit parce qu’ils n’ont pas travaillé suffisamment d’heures, soit, à l’inverse, parce que leurs salaires sont trop élevés pour être indemnisés dans les périodes non-travaillées. C’est un statut unique au monde. Pendant longtemps, il était remarquable parce qu’il réussissait, tout en prenant en compte la spécificité de nos métiers, à atténuer un peu, un tout petit peu, la très grande disparité de revenus dans les milieux artistiques. C’était alors un système mutualisé. Ils produisaient une forme très concrète de solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de fabrication d’un film, et aussi entre les générations.
Depuis des années, le MEDEF s’acharne à mettre à mal ce statut, en s’attaquant par tous les moyens possibles à la philosophie qui a présidé à sa fondation. Aujourd’hui, il y est presque arrivé. De réformes en nouveau protocole, il est arrivé à transformer un système mutualisé en système capitalisé. Et cela change tout. Cela veut dire, par exemple, que le montant des indemnités n’est plus calculé sur la base de la fonction de son bénéficiaire mais exclusivement sur le montant de son salaire. Et plus ce salaire est haut, plus haut sera le montant de ses indemnités. Et on en arrive à une absurdité complète du système où, sous couvert de résorber un déficit, on exclut les plus pauvres pour mieux indemniser les plus riches.
Or, au même moment exactement, à un autre bout de la chaîne de fabrication des films, d’autres causes produisent les mêmes effets. Je veux parler du système de financement des films qui aboutit d’un côté à des films de plus en plus riches et de l’autre à des films extrêmement pauvres.
Cette fracture est récente dans l’histoire du cinéma français.
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, ce qu’on appelait les films du milieu - justement parce qu’ils n’étaient ni très riches ni très pauvres - étaient même une sorte de marque de fabrique de ce que le cinéma français produisait de meilleur. Leurs auteurs - de Renoir à François Truffaut, de Jacques Becker à Alain Resnais - avaient la plus haute opinion des spectateurs à qui ils s’adressaient et la plus grande ambition pour l’art cinématographique. Ils avaient aussi, bon an mal an, les moyens financiers de leurs ambitions. Or, ce sont ces films-là que le système de financement actuel, et en premier lieu les chaînes de télévision, s’emploient très méthodiquement à faire disparaître.
En assimilant les films à vocation artistique aux films pauvres et les films de divertissement aux films riches, en cloisonnant les deux catégories, en rendant quasi impossible pour un cinéaste d’aujourd’hui le passage d’une catégorie à une autre, le système actuel trahit l’héritage des plus grands cinéastes français. Et leur volonté acharnée de ne jamais dissocier création cinématographique, point de vue personnel et adresse au plus grand nombre. Ce faisant, il défait, maille après maille, le goût des spectateurs; alors même que, pendant des décennies, le public français était considéré comme le plus curieux, le plus exigeant, le plus cinéphile du monde. Ici comme ailleurs, la violence économique commence par tirer vers le bas le goût du public puis cherche à nous opposer. Elle n’est pas loin d’y arriver. Les deux systèmes de solidarité - entre les films eux-mêmes et entre ceux qui les font -, ces deux systèmes qui faisaient tenir ensemble le cinéma français sont au bord de la rupture.
Alors peut-être est-il temps de nous réveiller. Peut-être est-il temps de nous dire que notre amour individuel pour le cinéma, aussi puissant soit-il, n’y suffira pas. Peut-être est-il temps de se battre, très méthodiquement nous aussi, pour refonder des systèmes de solidarité mis à mal et restaurer les conditions de production et de distribution de films qui, tout en donnant à voir la complexité du monde, allient ambition artistique et plaisir du spectacle. Nous n’y arriverons pas, bien sûr, sans une forme de volonté politique d’où qu’elle vienne. Or, sur de tels sujets, force nous est de constater que celle-ci est désespérément muette.
Mais rassurons-nous. Il reste 55 jours aux candidats à l’élection présidentielle pour oser prononcer le mot «culture».
18:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : césars, ministre, Pascale Ferran | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2007
Hommages
L'esclave libre
Photographie : IMDB - Paul Hesse

Un ange passe...
Photographie : IMDB

05:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, actrice, musique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/01/2007
Copinage
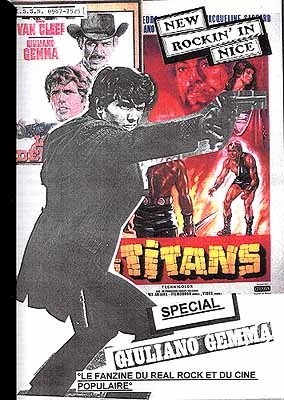
15:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma, Giuliano Gemma, fanzine, revue | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/01/2007
Quintessence du marxisme
17:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, Marx brothers, comédie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/01/2007
Notes sur quelques films français en 2006
Ici Najac, à vous la terre de Jean-Henri Meunier est caractéristique de ces documentaires qui partent d'expériences personnelles et sont de plus en plus présents sur les écrans. Comme si ces films entendaient démontrer que la réalité dépasse bien la fiction, et qu'ils sont mieux à même de passionner les foules sur des sujets puisés au coin de la rue. Voire plus près. Ici, Jean-Henri Meunier s'est installé il y a une dizaine d'années à Najac, petit village de l'Aveyron, et tout est partit de l'envie de filmer son voisin. Un premier film sort en 2004, La vie comme elle va dont Ici Najac, à vous la terre constitue la suite. La force et l'intérêt ce ce film est qu'il n'aurait pu être qu'un pamphlet altermondialiste de plus mais que tous les clichés attendus sur ce sujet sont dynamités par la personnalité peu banale du fameux voisin, Henri Sauzeau, le poète de la mécanique. Le film est d'abord un éloge de ceux qui sont encore maîtres de leur temps, une sorte d'éloge de la paresse si l'on est sensible à la pensée de Lafargue. Et de ce temps maîtrisé, les habitants de Najac font ce qu'ils veulent sans dogmatisme et sans se transformer automatiquement en militant. Il y en a bien un ou deux qui sont dans cette démarche, mais ils semblent bien pâles face à l'obstination du poète de la mécanique qui met en avant la passion de son ex-métier, lui qui entasse machines et carcasses automobiles pour les retaper par pur plaisir de l'activité. Plus encore que le chef de gare hédoniste, il est le pivot de cette chronique construite comme une fiction autour de ses démêlés avec ceux qui ne comprennent pas cette poésie. Car au delà, il y la valeur d'une certaine forme de travail, la dignité d'un homme et l'absurdité d'un système ou le gaspillage (tous les gaspillages) est roi.
Je me suis rendu à Changement d'adresse de Emmanuel Mouret sur les conseils de Pierrot qui avait écrit dessus avec enthousiasme en août. La surprise a été totale car, n'ayant pas la télévision, j'ignorais tout de Frédérique Bel. Quel ravissement ! Comme Karin Viard, Sandrine Kimberlain ou Jeanne Balibar, elle dégage tout à la fois humour, sensualité et vivacité. On a beaucoup écrit sur les liens entre cette comédie pétillante avec certains films de la Nouvelle Vague, surtout François Truffaut période Doinel. Je lui ai surtout trouvé une très proche parenté avec les comédies de Bruno Podalydes, Versailles rive-gauche en particulier, pour son adresse à tirer partie d'espaces très réduits pour en faire le moteur de la comédie. Placer un couple en devenir dans 12 mètres carrés, c'est donner à chacun de leurs gestes, chacun de leurs déplacements, une dose de suspense sensuel chargé d'érotisme. Sur un canevas on ne peut plus éculé (un garçon rencontre une fille), Mouret montre une nouvelle fois que la réussite d'une comédie tient au rythme, à la mise en scène de l'espace et à la mystérieuse alchimie que l'on fait naître entre les comédiens.

Partir pour mieux revenir, c'est un peu ce que j'ai pensé du Voyage en Arménie de Robert Guédiguian. Quitter l'Estaque et son petit monde confortable pour illustrer magistralement les derniers moments de François Mitterrand. Revenir l'espace d'une scène d'ouverture pour repartir sur les traces de son passé dans l'Arménie moderne. Retrouver une fois encore sa troupe pour les faire partir dans de nouvelles directions. Une grande part du plaisir que j'ai pris à ce voyage ne tient pas tant au côté « recherche de ses racines » mais à la prestation de Gérard Meylan en général arménien improbable et aux déambulations d'Ariane Ascarides. Tentation du cinéma de genre qui affleure parfois chez Guédiguian (film noir, comédie musicale, western), quand Ariane s'empare d'un revolver et tire dans le tas pour aider la jeune esthéticienne imprudente, j'ai pensé à la Gloria de Cassavetes. Guédiguian, c'est flagrant depuis La ville est tranquille, maîtrise parfaitement son art et s'en délecte. Ses films ont de la majesté et de la simplicité. De la classe.
Philippe Lioret, dans un autre registre, c'est un peu pareil. Je vais bien, ne t'en fait pas ne semble pas avoir intéressé grand monde. Tant pis pour eux. J'aime le cinéma de Lioret. J'ai toujours aimé les classiques. Mademoiselle et L'équipier étaient deux beaux classiques dans le registre de la comédie et du mélodrame. Son petit dernier est plus compliqué. Construit comme un film de Shyamalan en bien moins roublard, il a pourtant une apparence des plus réaliste. Mais il ne cesse de bifurquer, explorant quelques figures classiques du cinéma français actuel pour mieux les expédier et rebondir sur autre chose. L'héroïne a une dépression ? Ce qui ferait un film entier chez certains est réglé en vingt minutes. Le film élimine cliché après cliché, piste balisée après certitude de spectateur blasé pour nous obliger, lors de l'émouvant final à reconsidérer tout ce que l'on a vu. Plus que ce que l'on a vu (comme disons chez Shyamalan) ce que l'on a ressentit. Face à ce genre de films, j'ai toujours envie de retenir mon emballement et d'attendre une seconde vision, histoire de voir si ça tient la route. Patience, donc et, il faut le dire, Mélanie Laurent est superbe.

Deux regrets cette année, Dumont et Brisseau. A vrai dire, je voulais les voir parce que l'on en beaucoup parlé dans les blogs de mes petits camarades. J'aurais voulu discuter sur du solide. Je ne pense pas que ce soit un acte manqué, mais ça ne s'est pas fait. Dumont, je le crains un peu et je suis un peu tordu parce que je veux voir ce qu'il fait pour m'en débarrasser, comme je me sens débarrassé de Hanneke depuis La pianiste. C'est la pire des raisons pour voir un film mais on ne se refait pas. Brisseau, c'est autre chose. J'ai suivi « l'affaire » et, au début, je pensais comme Pierrot qu'il fallait le défendre, défendre le cinéaste et sa conception du cinéma. Puis j'ai lu la position de mes amis de la Maison du Film Court et j'ai nettement nuancé mon avis. Il y a la vision de Brisseau et la vision de ces jeunes femmes et qui suis-je pour aller juger ? Je ne pense pas que l'Art justifie n'importe quel comportement. Mais que s'est-il passé vraiment ? Mystère et boule de gomme. Bon, Brisseau a fait de sa vision un film (et les jeunes femmes feront peut être un livre). J'espère le voir un jour mais j'ai pu découvrir entre temps son précédent, l'objet du délit comme on dit : Choses secrètes. J'avoue que j'ai été déçu. La mise en scène est élégante, la photographie chaude et les corps filmés avec sensualité. Mais la plupart des acteurs jouent mal. Le vilain fils à papa pervers est à la limite du ridicule. Et le pauvre cadre bafoué ! Ca démoli un peu tout. Et sur le fond, j'ai trouvé tout ça bien sage. Ce n'est pas Bunuel, ni Kubrick, ni Oshima, ni Suzuki, ni pas mal de monde. Brisseau, ici en tout cas, ne manie pas le sexe comme un étendard révolutionnaire, comme un scalpel dans la chair de la société, comme un cri. Tiède le film. Heureusement qu'il y avait les yeux de Coralie Revel.
Photographies : Allociné
00:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma français, Philippe Lioret, Robert Guédiguian, Jean-Henri Meunier, Emmanuel Mouret | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2006
Quelques réflexions sur le questionnaire
Sur la traduction, je rappelle que j'ai fait une grossière erreur sur la question 2. « Cinématograher » signifie « Directeur de la photographie » et non « cinéaste ». D'autre part, sur la passionnante question philosophique numéro 23, je pense que la notion de supériorité est de trop et qu'il s'agit plutôt de ce qui est spécifique au cinéma en tant qu'art. Ceci dit et pour répondre d'une certaine façon à Ludovic là-dessus, sans vouloir aujourd'hui y mettre une notion de supériorité, aucun autre art n'a eu sur moi l'effet du cinéma. D'autant que, littérature mise à part, je suis venu aux autre formes artistiques par son entremise. Je me suis peut être bien laissé entrainer par mon enthousiasme naturel.
J'ai été quelque peu surpris que le cinéma de Hal Ashby, que je pensais un peu oublié, soit resté vif dans les mémoires (mais après tout il s'agit des réponses de cinéphiles pointus !). Par contre il semble que cet étrange culte voué à Joe Don Baker et Bo Svenson n'ait pas traversé l'Atlantique. Juste pour mémoire (et pour répondre aux derniers commentaires sur Cinématique), ce sont deux seconds rôles devenus célèbres pour des rôles de « grandes gueules », shérifs ou militaires. On a pu croiser Don Baker chez Peckinpah, Scorcese, Siegel ou Edwards ; et Svenson chez Tarantino, Eastwood ou Castellari. Ils ont tous les deux incarné une icône des polars des années 70 : le violent shérif Buford Pusser dans les deux Walkin' tall (Justice sauvage) qui n'ont guère impressionné le public français.
Un dernier mot sur Fay Wray dont Hyppogriffe notait avec raison que l'on ne voyait plus guère ses films, outre qu'elle est la sublime Ann Darrow du premier King Kong, elle était dans Les chasses du comte Zaroff des mêmes Schoedsack et Cooper, chez Walsh, La Cava, Minelli, Conway et Hawks. Et voici son visage:

Les réponses de Ludovic sur Cinématique (en commentaires : Pascal, Jacques Layani, le ulhan, Montalte,)
Les réponses de Pierrot alias Dr Orlof (en commentaire : Casaploum)
Les réponses d'Imposture derrière le paravent suédois
Les réponses d'Hyppogriffe sur Notre musique
Les réponses de Ludo sur Série Bis
Photographie : Dr Macro
14:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, questionnaire, cinéphilie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/12/2006
Paternité (à suivre)

07:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinema, John Ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/12/2006
Questionnaire (une fois n'est pas coutume)
Les questionnaires sont la tarte à la crème des blogs. Néanmoins, je vous en propose un, signalé par Flickhead, en provenance de Sergio Leone and the infield fly rule. J'ai trouvé intéressantes les questions et je me suis amusé un moment à y répondre. D'autre part, il donne une idée des cinéphiles américains et de leur intérêt toujours vif pour le cinéma français de la nouvelle vague. J'ai traduit tout seul comme un grand, que les anglophones me pardonnent. En illustration, une photographie publiée par Flickhead, grand admirateur de Chabrol. Il s'agit de Stéphane Audran dans La femme infidèle et je la trouve d'une très grande sensualité. Les jambes des femmes arpentent le monde...

1) Quel est le dernier film que vous ayez vu en salle ou en DVD et pourquoi ?
No Room to die (connu sous les titres La corde au cou et Une longue file de croix) de Sergio Garrone, parce que j'avais entendu la chanson thème et qu'elle me plaisait beaucoup (voir la note petit morceau).
2) Citez le cinéaste dont vous attendez le plus le prochain travail et donnez un exemple de ce qu’il fait de mieux
Steven Spielberg. Je suis un grand admirateur et son dernier, Munich, m'a emballé.
3) Joe Don Baker ou Bo Svenson?
Plutôt Joe Don Baker, mais il ne m'a guère marqué.
4) Citez un moment dans un film qui vous a fait sursauter (horreur, surprise, révélation…)
Le massage cardiaque dans The Thing de Carpenter. Presque tout le film, en fait.
5) Votre film préféré à propos du cinéma
La Nuit américaine de François Truffaut.
6) Votre film préféré de Fritz Lang
Difficile. M sans doute, et ses deux premiers américains, Fury et J'ai le droit de vivre.
7) Décrivez la première fois où vous vous êtes reconnu dans un film
La garçonnière de Billy Wilder peut être. Mais le plus marquant, c'est le personnage de Denis Podalydes dans Dieu seul me voit. C'est mon portrait.
8) Carole Bouquet ou Angela Molina?
Plutôt les deux.
9) Citez un film qui rachète la notion de nostalgie au-delà d’une facilité commerciale.
N'importe lequel des films de John Ford.
10) Quelle est votre apparition préférée d’un sportif dans un rôle joué ?
Johnny Weissmuller dans Tarzan
11) Votre film préféré de Hal Asby ?
Bienvenue Mr Chance
12) Citez les titres du premier double programme que vous diffuseriez pour l’inauguration de votre propre salle art et essais ?
Rio bravo de Hawks et L'homme tranquille de Ford
13) Quel serait le nom de cette salle ?
Inisfree !
14) Humphrey Bogart ou Elliot Gould?
Bogart, Bogart, Bogart.
15) Votre film préféré de Robert Stevenson.
L'ile sur le toit du monde, toute mon enfance.
16) Décrivez votre passage favori dans un film qui soit mémorable pour son utilisation du son.
L'ouverture de Il était une fois dans l'Ouest de Léone sans hésiter.
17) Pink Flamingo, oui ou non ?
Oui, je ne l'ai pas encore vu.
18) Votre BO favorite
Difficile aussi, il y en a tant. Disons, historiquement, L'empire contre-attaque de John Williams, la première que j'ai achetée et écoutée à en creuser les sillons.
19) Fay Wray ou Naomi Watts?
Fay Wray à jamais.
20) Y a-t’il un film qui vous amènerait à questionner le jugement et/ou le goût d’un critique, bloggeur ou ami s’il s’en faisait l’avocat ?
Tous les films de Michael Hanneke mais ce n'est pas limitatif
21) Créez une nouvelle catégorie pour les Oscars et citez son premier vainqueur…
Je ne suis pas trop cérémonies et récompenses.
22) Votre film préféré de Paul Verhoeven.
La chair et le sang
23) Qu’est-ce qui, pour vous, est supérieur dans les films que dans les autres formes artistiques ?
Le montage
24) Peter Ustinov ou Albert Finney ?
Albert Finney, pour Two for the road.
25) Quel est votre logo de studio favori, tel qu’il apparaît avant les films ?
Le pylône de la RKO
26) Citez le livre qui est le plus important sur le cinéma pour vous.
Hitchcock – Truffaut du second
27) Citez le film qui ait le meilleur retournement de situation finale (twist ending)
Casablanca, « raise the usuals supects »
28) Votre film préféré de Francois Truffaut.
La sirène du Mississipi
29) Olivia Hussey ou Claire Danes ?
Olivia Hussey
30) Racontez votre plus mémorable rencontre avec une célébrité.
Tsui Hark qui était dans la salle qui projetait Cinéastes à tout prix à Cannes en 2004
31) Quand avez-vous réalisé pour la première fois que les films étaient réalisés ?
La première fois ou j'ai eu la conscience aiguë de la mise en scène, c'était lors d'une projection de Rio Bravo, lors de la scène initiale. Mais je savais depuis de nombreuses années ce qu'était un metteur en scène.
06:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : cinéma, questionnaire | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2006
Bond, James etc.
Mon premier contact avec James Bond en salles, ce fut une séance estivale, en vacances à la montagne, je devais avoir 14 ans. C'était le premier, James Bond contre Dr No réalisé par Terence Young. Je connaissais déjà les bouquins et j'avais vu des photographies comme des extraits. Je n'avais pas été déçu. Aujourd'hui encore, quand je revois le film, j'apprécie son côté série B des années soixante. Pas encore de gadgets, une bande son exotique, le bikini d'Ursula Andress, son accent, et la tarentule sur le poitrail velu de Sean Connery. Par la suite, j'avais des amis dont l'un d'eux avait, chose merveilleuse et rare, un magnétoscope. C'était ce que l'on appelle un bondophile, un vrai fan et je cois qu'il l'est toujours. Il appréciait aussi John Steed et le prisonnier. C'est amusant cette fascination qu'ont pu avoir certains pour cette image de l'espion britannique. Bref, pendant quelques mois, nous nous cotisions pour louer (les vidéos étaient hors de prix à l'époque) les aventures de Bond. Passé un moment, déjà très cinéphile, j'avais essayé d'influer sur la programmation (mémorable séance de Délivrance de Boormann mais c'est une autre histoire). Bond restait maître du terrain et je suis partit fréquenter la cinémathèque.
Sans être devenu bondophile, je n'en ai pas moins développé une certaine affection pour les films un peu en marge de la série officielle, pour ces « James Bond déficitaires » dont parlait François Truffaut (quoique les films dont il sera question ne l'ont pas été). Au sein de la série officielle, j'aime Au service secret de sa Majesté, réalisé en 1969 par Peter Hunt, monteur des trois premiers films. Je l'aime parce que Diana Rigg y est belle, parce que « ce n'était jamais arrivé à l'autre type », parce que Diana Rigg qui sortait de la série Chapeau melon et bottes de cuir y est crédible quand elle fait le coup de poing, parce que l'élégance de la mise en scène de Peter Hunt, parce que Diana Rigg épouse Bond à la fin, parce que les expressions mélancoliques de Georges Lazenby, parce que c'est Louis Armstrong qui chante cette fois, et parce que l'on trouve cette fin si triste et si douce que l'on imagine pas jouée par aucun autre des interprètes de Bond.

L'autre Bond dont j'ai un fort souvenir, c'est l'alternatif Jamais plus jamais mis en scène par Irvin Kershner en 1983. Parce qu'il joue (un peu) sur l'age de bond qui est envoyé en cure de repos au début du film, parce que Connery a une jolie scène de danse avec Kim Basinger sur un sol en damiers et puis il se fait presque violer la méchante brune jouée par Barbara Carrera, parce que le baiser un rien baveux de Klaus Maria Brandauer à kim Basinger. Brandauer est un méchant assez original dans ce cadre, élégant, proche et pourtant avec des éclairs de folie très crédibles. Je garde le souvenir d'un film vif, décontracté et sophistiqué avec la patte des meilleures réussites de Kershner, réalisé à une époque où ceux fait avec Roger Moore étaient franchement pitoyables.

Mais le Bond des Bonds, c'est celui qui provoque chez les purs bondophiles un mouvement arrière dégoûté. C'et Casino Royale. Pas celui qui sort que l'on nous promet « différent » (on dit toujours ça avant), mais le film quelque peu branque réalisé en 1967. Casino Royale est à jamais un des films les plus loufoques jamais réalisés, quelque part entre Hellzapoppin' de H.C.Potter, The party de Blake Edwards et 1941 de Steven Spielberg. Un OVNI qui a eu les moyens et qui n'a reculé devant rien, pas même devant le mauvais goût, l'emblème d'une époque et d'un état d'esprit, celui de la vague psychédélique des années 60, le swinging London et toutes ces sortes de choses. L'histoire de ce film est déjà gratinée : un producteur en fuite qui achète les droits par superstition, un second qui devant l'impossibilité de faire un film sérieux décide de jouer à fond la parodie et envisage un moment de faire jouer Bond par Susan Hayward. Cinq metteurs en scène (Val Guest, John Huston, Robert Parrish, Ken Hughes, Joseph McGrath), défi à toute théorie des auteurs, une dizaine de scénaristes dont Woody Allen qui écrira ses dialogues, Billy Wilder, Ben Hecht, Val Guest et Peter Sellers qui tripote son rôle. Une distribution d'ici jusque là bas avec l'homme dont Fleming rêvait pour jouer Bond : David Niven. A ses côté, Orson Welles, Ursula Andress, Peter Sellers, Woody Allen, Charles Boyer, Déborah Kerr (exquise), William Holden et même Jean-Paul Belmondo en légionnaire bilingue avec pour faire bonne mesure quelques unes des plus belles femmes de l'époque, outre Andress et son accent suisse, Joanna Pettet, Jacqueline Bisset, Barbara Bouchet et la sublime Daliah Lavi.

De l'histoire, pas la peine de s'étendre dessus, le film est un pied de nez à la cohérence et à la continuité. On y trouve des James Bond vrais et faux, hommes, femmes, chiens et otarie, une soucoupe volante, une aspirine atomique, un français à l'accent écossais, le fille de Mata Hari, des indiens, Georges Raft et sa pièce de monnaie, un concours de lancer de boulets, j'en passe et des meilleures. La musique est typiquement pop, sautillante comme il se doit, un des sommets de Burt Bacharach avec le standard The look of love. La photographie comme la direction artistique multiplient les chocs visuels, mariant sans sourciller l'esthétique de la série officielle à un magnifique passage expressionniste à Berlin, un ballet hindou et quelques délires psychédéliques dans le repaire du Spectre. Casino Royale est une oeuvre somme qui inclus les arts visuels, la décoration, l'architecture et la mode. A cette énumération digne de Prévert, on peut se dire que le film est un véritable foutoir. C'est exactement cela, un foutoir joyeux, irrespectueux, une création collective, un happening friqué avec ses sommets, ses moments obscurs, ses passages limites. C'est un joyau impérissable que certains peuvent trouver lamentable. Qu'ils aillent rejoindre Jimmy Bond « to a place where it's terribly hot ».
Georges Lazenby, une étude de John Buss (en anglais)
Un entretien avec Georges Lazenby (en anglais)
Les magnifiques posters de Casino Royale
Le site du fan club de James Bond français
Un site anglais très bien fourni (la photographie de Diana Rigg en vient)
Casino Royale sur DVDClassik
Le DVDde Casino Royale
Le DVDde Au service secret de sa majesté
Le DVDde Jamais plus Jamais
08:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, James Bond | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2006
Encore un peu de travelling
Ce fut décidément le sujet de l'année. Un long article de Stéphane Bou dans le dernier numéro de la nouvelle revue Panic revient une nouvelle fois sur le travelling du film de Gillo Pontecorvo, Kapo. Ses réflexions sont fouillées, notamment une mise ne parallèle avec le film La dernière étape de Wanda Jakubowska. Et j'aime assez son interprétation du fameux plan :
Le travelling de Kapo est le mouvement épique qui accompagne un acte de révolte d'un personnage contre l'idée de sa défiguration. Wanda Jakubowska dessinait le tableau pudique du « naufragé anonyme » (Primo Levi) de la déportation. Le recadrage final de Pontecorvo veut composer la fresque grandiose et pathétique d'une martyre héroïque comme s'il s'agissait de sauver son honneur.
Autour de Kapo
Stéphane Bou
Panic N° 5
22:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, critique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2006
C'est quoi un film politique ?
23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinema | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/11/2006
Disparitions
La première vient de tomber, c'est le décès de Robert Altman. Grande carrière, grand bonhomme, grand style, le sens d'un mouvement large englobant de nombreux personnages, le goût des histoires chorales et le désir de relever des défis techniques purement cinématographiques comme avec le fameux plan-séquence de Short cuts. Je connais finalement mal sa première partie de carrière et si un titre me vient spontanément à l'esprit, c'est Un mariage. Altman était une voix singulière et de plus en plus rare dans le cinéma américain d'aujourd'hui. Elle vient de se taire et il reste les films.
J'adorais Jack Palance. Le psychopathe atteint de la peste noire dans Panic in the streets (Panique dans la rue d'Elia Kazan) m'avait marqué quand j'étais petit. Il y eu bien sûr Palance chez Aldrich, Palance en archétype du tueur de western avec ses gants noirs dans Shane (L'homme des vallées perdues de Georges Stevens), Palance en gueule de superproductions historiques (les Mongols, Austerlitz, Barabbas...), Palance, plus tard encore, chez Godard dans Le mépris. Mais j'ai regretté que dans les divers articles qui lui ont été consacré, on ait un peu oublié le Jack Palance du cinéma plus populaire, celui qui joua chez Sergio Corbucci deux méchants gratinés, Curly dans Le mercenaire en 1968, qui mourrait au centre d'une arène, regardant le sang rouge s'écouler de son oeillet blanc à la boutonnière, près du coeur. Et John main-de-bois, l'homme au faucon de Companeros ! En 1970 qui ne séparait jamais de l'animal qui lui avait sauvé la vie en lui mangeant la main. Il y a eu aussi le Jack Palance du cinéma fantastique, incarnant un étonnant Dracula pour la télévision en 1973, jouant dans l'injustement oublié Welcome to Blood City (Peter Sasdy en 1977) ou encore cabotinant dans le réjouissant Alone in the dark de Jack Sholder en 1982 aux côtés de Martin Landau et Donald Pleasence. Là encore une longue et belle carrière (une centaine de films), pas forcément homogène mais qui ne saurait se limiter à quelques figures reconnues.

Le 8 novembre disparaissait plus discrètement encore Basil Poledouris, compositeur pour le cinéma. Pour ceux qui se sont passés et repassé les musiques de Conan (John Milius en 1982) ou Flesh + blood (La chair et le sang de Paul Verhoeven en 1985), c'est une triste nouvelle d'autant qu'il avait tout juste 61 ans. Sa carrière restera marquée par ses collaborations suivies avec Milius et Verhoeven, pour lesquels il aura su faire ressortir le caractère épique de leurs univers tout en laissant passer un supplément d'émotion et d'humanité bienvenu. Il n'est que de se souvenir des accents du Love thème de la saga médiévale de Verhoeven ou du morceau qui accompagne la mort de la mère de Conan enfant pour comprendre l'apport essentiel ce créateur qui n'aura pas toujours pu donner le maximum de son talent. Je vais me remettre du Poledouris sur ma platine.
20:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/11/2006
What seems to be the trouble, Captain ?
François Truffaut émis sa fameuse théorie du « Grand film malade » à partir de Marnie (Pas de printemps pour Marinie – 1964) d'Alfred Hitchcock dans son fameux livre d'entretiens qui ne quitte guère mon chevet. Afin de rendre un juste hommage au maître du suspense dans le cadre du blog-a-thon, je vais vous faire part de ma théorie du « petit film en pleine forme » à partir de l'un de mes films fétiches : The trouble with Harry (Mais qui a tué Harry ? – 1955). Le « petit film en pleine forme » est une oeuvre qu'un réalisateur à la carrière brillante, du moins reconnue, travaillant dans un système rôdé, arrive à faire un peu à côté de ce système pour son propre plaisir, sans ambition affichée, sans gros budget le plus souvent et donc avec un maximum de liberté. C'est une oeuvre d'apparence modeste mais qui possède en elle l'élégante simplicité dont seuls peuvent faire preuve les grands artistes. C'est un film qui semble presque une récréation mais qui exprime une facette très personnelle de son auteur. C'est un film qui ne fait généralement pas succès à l'exception des véritables admirateurs du réalisateur qui chérissent l'oeuvre et peuvent aller jusqu'à la tenir comme plus estimable que bien des chef d'oeuvres célébrés et indiscutés. C'est un film enfin ou quelque chose d'intime et de délicieux se joue entre le réalisateur, le petit film en pleine forme et son public. C'est la petite musique de chambre d'un grand chef d'orchestre symphonique. C'est Wagonmaster (Le convoi des braves) de John Ford, c'est Prince of darkness (Prince des ténèbres) de John Carpenter, c'est Prova d'orchestra de Federico Fellini, c'est Toni de Jean Renoir, c'est Chungching express de Wong Kar-wai, vous avez sûrement les vôtres.

The trouble with Harry répond point par point à cette tentative de définition. En 1955, Alfred Hitchcock est au sommet de sa carrière hollywoodienne, il vient de signer des « grands » films comme Rear window (Fenêtre sur cour) ou To catch a Thief (La main au collet) avec les plus grandes star du moment et s'apprête à son remake de The man who knew too much avec James Stewart et Doris Day. Entre ces grosses machines, il a le créneau pour quelque chose qui lui tient à coeur depuis un moment, l'adaptation d'un roman de Jack Trevor Story à l'humour délicieusement anglais. Obtenant quasiment carte blanche de la Universal, il envisage sans doute le film comme l'occasion d'aller prendre des vacances et de profiter des tables renommées du Vermont, un peu comme John Huston était partit filmer en Afrique pour le plaisir de l'aventure et de la chasse. Contrairement à ses habitudes, Hitchcock compose une distribution de seconds rôles solides et de débutants qui va se révéler parfaitement homogène. The trouble with Harry est le premier film de la jeune Shirley MacLaine et John Forsythe n'a guère fait que de la télévision avant. Ils seront le couple vedette, elle en jeune veuve avec son charmant fiston et lui en peintre nonchalant et altruiste. A leurs côtés, l'un des couples les plus délicieux de l'histoire du cinéma, la fordienne Mildred Natwick et Edmund Gwenn, la vieille fille frémissante et le jovial capitaine à la retraite. Leur idylle est tout simplement touchante et il faut voir la séquence où elle l'invite à prendre le thé, toute en délicatesse, en non-dits, en retour tardif de sensualité. Il faut mesurer à une telle scène tout l'immense talent et toute la terrible sensibilité d'Alfred Hitchcock.

The trouble with Harry est aussi la première collaboration entre Hitchcock et celui qui va devenir son alter ego musical : Bernard Herrmann. Emporté par l'euphorie de cette histoire si légère où il est question d'un cadavre que tout le monde croit avoir tué et que l'on enterre et déterre avec bonne humeur, Herrmann, conscient peut être qu'il y avait là le meilleur de l'homme Hitchcock, compose une pièce délicieusement raffinée, enjouée, pleine d'humour comme chez certains morceaux de Satie. Il en fera plus tard une réorchestration qu'il appellera « Portrait of Hitch ». The trouble with Harry c'est aussi l'admirable photographie de Robert Burks, autre collaborateur essentiel du maître. Je crois que c'est ce qui m'a le plus soufflé quand j'ai découvert le film pour la première fois. Rarement les teintes dorées de l'automne ont été si parfaitement rendues à l'écran. Rarement la quiétude de la nature, dans ce qu'elle peut avoir de plus bouleversant, a été si simplement mise en images. The trouble with Harry, c'est comme un monde parfait, un monde de cinéma comme le Monument Valley fordien, un monde hors du temps et hors de cette violence du monde vrai qui est au coeur du reste de l'oeuvre hitchcockienne. C'est son île paradisiaque. Bien sûr, il ne marcha nulle part, sauf en France. Mais aujourd'hui, après avoir vu et revu tant de fois ses plus grands films, sa période muette, sa période anglaise et ses « grands films malades », je n'ai toujours aucune hésitation à repartir suivre son joyeux quatuor du Vermont dans ce petit film pétant de santé.

Photographies : DVD Universal
Le Hitchcock blog-a-thon
Les participants :
L'initiateur : The film vituperatem
Flickhead (superbes reproductions d'affiches françaises)
If Charlie Parker Was A Gunslinger
En bonus :
Le DVD
Un bel article sur DVDclassik
00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Alfred Hitchcock, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/10/2006
Danse
08:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/10/2006
Domaine public
Internet, on ne le répétera jamais assez, peut être une formidable fenêtre ouverte sur le domaine public. Le domaine public, c'est cet endroit imaginaire où viennent échouer les oeuvres qui ont perdu leurs droits, c'est à dire celles qui ont acquis leur indépendance de la notion de « valeur », loin des chaînes de l'économie. Ce sont des oeuvres qui peuvent s'échanger, se copier, être éditées, se diffuser en toute liberté. Elles font partie du patrimoine commun et appartiennent donc à tout le monde puisqu'elles n'appartiennent plus à personne. Don Quichotte est dans le domaine public. Tout Shakespeare aussi, les poésies de Lamartine pareil.
En matière de cinéma, c'est un petit peu plus compliqué. D'une part parce qu'un film fait appel à différents ayant-droits (la musique, le scénario, le film lui-même). D'autre part, le cinéma est un art jeune, à peine plus de cent ans, et un copyright américain tombe aujourd'hui au bout de 90 ans après la mort du dernier ayant-droit. En France, le droit d'auteur s'exerce jusqu'à 70 ans après la mort du dernier créateur reconnu.
Il existe pourtant pas mal d'exceptions et de nombreuses oeuvres, du fait du temps et de sombres points juridiques, sont tombées dans le domaine public. Jusqu'à récemment, il était difficile d'avoir accès à ces oeuvres parce qu'elles n'intéressaient plus personne mis à part les cinéphiles sur certains grands noms. Avec l'ère numérique et le DVD, certaines sociétés se sont fait une spécialité d'exploiter les films du domaine public. Mais avec Internet, ces films peuvent en toute légalité être mis à disposition, chargés et copiés.
C'est ainsi que j'ai découvert ce site : public domain torrents qui propose en téléchargement quelques centaines de films du domaine public et, surprise, quelques oeuvres remarquables. Le site propose des fichiers torrents qui permettent de récupérer le film via un logiciel type Azureus.
Derrière le titre Any gun can play se cache le premier western d'Enzo G.Castellari : Vado...L'ammazzo e torno (Je vais, je tire et je reviens, 1967) qui emprunte son titre à une fameuse réplique de Le bon, la brute et le truand de Léone, comme il lui emprunte cette histoire d'un trio à la chasse au trésor. Rythmé et plein d'humour, avec notamment une excellente scène d'ouverture, ce western italien qui réunit Georges Hilton, Gilbert Roland et Edd Byrnes vaut le détour et la copie est honnête. Dans le même style, le superbe La mort était au rendez vous (Da uomo a uomo, 1967) de Giulio Petroni et l'amusant Boot Hill (La collina dei stivali, 1969) de Giuseppe Colizzi avec le duo Hill et Spencer.
La même conclusion peut s'adapter à Horror express sortit chez nous sous le titre Terreur dans le Shanghaï-Express. Réalisé en 1973 par l'espagnol Eugenio Martin, le film réunit les deux ténors du fantastique classieux : Christopher Lee en anthropologiste qui a découvert un bien curieux fossile et Peter Cushing, médecin qui va lui donner un coup de main à combattre la curiosité en question. Unité de temps, de lieu et d'action puisque tout se passe en une nuit à bord du transsibérien et que le fossile, vous vous en doutez, ne reste pas de glace et décime les passagers du train tout en les possédant, à la manière des zombies. Du fantastique sérieux comme on en faisait sur les traces de la Hammer à l'époque avec une seule fausse note, la prestation très cabotine de Telly Savalas en capitaine cosaque.
Dans la catégorie fantastique, on trouve aussi, outre La nuit des morts-vivants de Romero, la première version de The house of Haunted Hill de William Castle et celle de Last man on earth d'après Richard Matheson avec Vincent Price.
Toujours dans le cinéma de genre, l'un des meilleurs peplums : Hercule et la reine de Lydie de Pietro Francisci avec Steve Reeves, là encore une assez bonne copie, ce qui n'est hélas pas le cas des autres titres du même genre.

La surprise, c'est la découverte dans la catégorie western du Judge Priest de John Ford. C'est le premier des trois films réalisés par Ford avec Will Rodgers avant la disparition de l'acteur dans un accident d'avion. Datant de 1934, c'était l'un des films préférés de Ford, au point qu'il en fera une nouvelle version en 1952, The sun shines bright (Le soleil brille pour tout le monde). C'est un petit bijou dans la veine de ces films simples et chaleureux que sont Young Mr Lincoln (Vers sa destinée, 1939) ou Wagonmaster (Le convoi des braves, 1950). On y retrouve son amour des petites communautés, sa nostalgie d'un Sud à la vie tranquille et une grande liberté de ton et de style comme dans cet inoubliable plan séquence où le juge, tout en remplissant des papiers, entonne un gospel en duo avec sa servante noire jouée par Hattie McDaniel. Un poil de paternalisme sans doute, mais un film à découvrir d'autant qu'il n'est pas édité en DVD sauf erreur de ma part.
Voilà, voilà. Il y a encore beaucoup à découvrir. Je ne sais pas si la notion de domaine public est vérifiée avec toute la rigueur nécessaire, mais cette initiative est un bel exemple, comme l'Internet Archive, de ce qu'il est possible de faire pour valoriser cet immense patrimoine. Bonne ballade.
Image : movieposters
05:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/10/2006
L'Art de Ford
Quelque chose que j'aime bien avec les blogs cinéma, c'est qu'au fil des lectures et des discussion, non seulement on peut découvrir de nouveaux films mais encore avoir envie d'en revoir certains que l'on pensait bien connaître et qui nous sont tout à coup présentés sous un jour tout à fait différent. On peut ainsi réévaluer tel film que l'on n'avait pas aimé où se retrouver impuissant à défendre tel autre.
C'est ainsi que l'autre jour, j'ai été pris de l'irrésistible envie de revoir Rio Grande, le film de John Ford, suite à une note plutôt assassine de Tepepa. Outre que je me suis surpris moi même du côté impérieux de cette envie, je me suis bien trouvé de l'expérience puisque je crois n'avoir jamais autant apprécié le film. Je dois avouer que j'étais resté, depuis ma dernière vision il y a quelques années, sur une impression assez proche de celle du chroniqueur. Et puis là, balance, j'ai découvert des tas de petites touches éminemment fordiennes qui m'ont ravi.
Le film résulte à la base d'un arrangement entre Ford et Republic Picture qui accepta de donner le feu vert au réalisateur pour faire L'homme tranquille à condition qu'il leur livre un western avant. La « trilogie de la cavalerie » qui comprend Le massacre de Fort Apache en 1948 et La charge héroïque en 1949 est donc une trilogie par nécessité. Rio Grande est tourné assez vite entre juin et juillet 1950 pour une sortie en octobre, ce qui laisse rêveur sur les délais de l'époque. Le film est assez mal aimé, tenu comme le plus faible de la série. Il y a pourtant la troupe de Ford, les thèmes de Ford et le style de Ford. Il est clair que le réalisateur avait déjà la tête en Irlande à préparer son projet suivant qui lui tenait tellement à coeur. Il a envisagé le film comme une récréation, injectant des séquences musicales et de comédie par simple plaisir et négligeant les réflexions philosophiques et historiques qui avaient donné leur poids aux deux opus précédents. Revenant au noir et blanc de Bert Glennon dans Le massacre de Fort Apache et Wagonmaster, il ne renouvelle pas non plus les fulgurances de la photographie en couleur de La charge héroïque.

L'intérêt du film est ailleurs. Ford a utilisé ce film de commande pour s'entraîner à réaliser L'homme tranquille. Rio Grande, c'est l'histoire d'un couple qui se crée et d'une famille qui se reforme. Le couple est un couple de cinéma, Rio Grande c'est la rencontre de John Wayne, le déjà mythique (dans le rôle d'un colonel nordiste luttant contre les apaches) et de Maureen O'Hara, la rousse la plus explosive (dans le rôle de sa femme sudiste). Ils se sont séparés voici 15 ans parce que le colonel, obéissant aux ordres, a brûlé la plantation familiale de sa femme. Elle lui en veut bien sûr à mort. Ils ont un fils. Le fils après avoir échoué à West Point vient de s'engager dans les troupes de son père. La mère revient pour le reprendre. Voici pour l'enjeu familial. Ford était assez angoissé à l'idée de tourner une simple « histoire d'amour entre adultes » comme il définissait L'homme tranquille. Le voilà donc qui teste son couple dans ce film sensément d'aventures, observant comment fonctionne l'alchimie des corps, les jeux de regards, les frôlements de doigts. Et ça fonctionne. Les deux grands acteurs créent un ensemble de moments intenses qui sont du meilleur Ford et qui seront poussés à leur paroxysme l'année suivante. Par exemple le baiser, premier baiser passionné depuis 15 ans : Wayne revient d'une mission de secours épuisante. Il pénètre dans sa tente, c'est la nuit. Il allume une lampe à pétrole et, à peine au fond de la tente, quasiment tapie dans l'ombre, la silhouette de O'Hara se devine, il se tourne, éclaire ses yeux, elle a les lèvres qui tremblent et ils se jettent fougueusement dans les bras l'un vers l'autre. Pas un mot n'est échangé, c'est tout l'art du cinéma muet, l'art du cinéma pur.
Plus célèbre, il y a cette scène dans laquelle Wayne et O'Hara ont dîné ensemble le soir même de l'arrivée de la femme. Jusque là, c'est fleurets mouchetés. La fanfare de la troupe vient leur donner la sérénade. Ils chantent I'll take you home again Kathleen, chanson irlandaise traditionnelle (mais il parait qu'elle a été écrite par un allemand !) dont la traduction est : « je te ramènerais à la maison, Kathleen ». Elle s'appelle Kathleen. Elle est troublée mais on sent qu'elle apprécie, il apparaît un peu de buée sur ses yeux. Ca dure. Il ne sait plus où se mettre tellement il pense se faire rembarrer. Il se tortille; légèrement en retrait, il n'ose la regarder, attendant l'orage. C'est du grand Wayne, digne de James Stewart quand il joue les embarrassés. Mieux encore, parce qu'il est John Wayne quand même. Finalement il se lance « Je ne suis pour rien dans le choix de cette chanson ». « C'est dommage, Kirby, ça m'aurait fait tant plaisir ». Et j'imagine Ford, son mouchoir aux lèvres, assis sous la caméra, jubilant intérieurement en se disant « ça marche, bordel, ça fonctionne ». Ce sont de grands moments. Voilà, c'est ça Rio Grande, la naissance d'un couple de cinéma qui fonctionne. Le reste, bien sûr, ne peut pas faire le poids. La problématique avec les indiens, Ford l'a déjà traité, ce n'est pas le lieu, il s'en contrefiche. Du coup certains ont trouvé ce film raciste ce qui est idiot. Les scènes d'actions sont bien emballées, le final est quasi abstrait, mais Maureen O'Hara n'y est pas alors on se dépêche de retourner au fort, avec un Wayne blessé. C'est sa contribution à l'équilibre familial puisque elle, elle pardonne et reste finalement.
Un dernier petit truc que je n'avais jamais remarqué. Wayne a une conversation avec son fils qu'il n'a plus vu depuis 15 ans lui aussi. C'est militaire. Quand le fiston sort, Wayne repère un trou dans sa toile de tente et s'en sert pour évaluer la taille de son rejeton. Il a alors un petit éclair de fierté dans l'oeil.
Le DVD
Le Bouquinde Patrick Brion que je viens de terminer. Joli pavé avec beaucoup d'illustrations.
Photographie : Speakesy.org
22:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : western, john ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
17/09/2006
Jerry fois trois



23:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |























