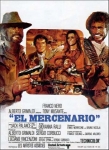24/05/2005
J'ai pas pu résister...
23:55 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Marilyn Monroe, photographie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2005
Westerns all'dente
11:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, Sergio Corbucci, Sergio Sollima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2005
Que la force, etc.
Lucas a eu tort d’arrêter si longtemps pour reprendre si tard. Nous n’avons plus 15 ans et ce que nous acceptions alors, ça passe moins bien aujourd’hui. C’est sans doute pour avoir oublié ça qu’il s’est lourdement planté avec l’épisode I, que nous ne sommes plus aussi sincères dans l’attente des épisodes II et, aujourd’hui, de cette Revanche des Siths. Et que l’on ne me dise pas que nous avons vieillis. Enfin, si, on est plus vieux, mais quand je regarde King Kong, Rio Bravo ou Indiana Jones, je retrouve toujours mon « âme d’enfant ». Et quand je regarde les deux premiers épisodes, ceux historiques, je marche toujours. Parce qu’alors, Lucas , qui ne savait pas encore bien où il allait, était encore capable de partager son innocence avec nous. Parce que les effets spéciaux, un peu imparfaits, participaient de la naïveté de l’entreprise. Parce que Leight Brackett et Lawrence Kasdan avaient écrit le scénario de L’Empire Contre Attaque et qu’ils savaient écrire des films d’aventure et de science fiction.
Difficile aujourd’hui de regarder un des nouveaux Star Wars autrement que comme le nouveau « blockbuster ». Fini le temps du film exceptionnel qui repoussait les limites de l’imaginaire. Dès le Retour du Jedi, Lucas est devenu prisonnier de sa réussite. C’est un peu pathétique de le voir, aujourd’hui, essayer de raccrocher les wagons en élaborant à posteriori une philosophie globale pour les 6 épisodes. Dans la première trilogie, on riait pas mal avec les héros, des héros avec lesquels on pouvait s’identifier. Dans la seconde série, on ri peu, avec une créature virtuelle moche comme un pou, et le héros, censé nous ressembler, reste trop lisse. Ah ! Où sont la maladresse de Solo, les timidités de Luke, les crises d’autorité de Leia ?
Ce qui est amusant aussi, c’est tout le baratin que l’on fait sur le côté sombre et pessimiste qui dominerait la série. Comme si l’ensemble de la saga n’était pas d’un optimisme avéré. Lucas ne fait qu’appliquer les règles de bases de la dramaturgie : plus la chute est profonde, plus le mal est puissant, plus le mérite des héros est grand.
Il pourrait rester les films, mais non ! Même pas depuis que Tonton Georges a cru bon de les reprendre et de les tripoter. Ca, c’est vache. Retirer comme cela une part d’enfance à ses fans… Mais bon. Pas le choix. J’irais quand même voir la fin du début de l’histoire. Il parait que c’est pas mal. Avant, si j’ose dire, c’était merveilleux.
10:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Georges Lucas, Star Wars | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/04/2005
Caen : 5 jours tout courts
Pour commencer, je serais du 3 au 8 mai au festival du court métrage de Caen : 5 jours tout courts. Il y aura un hommage à Chris Marker, du Tex Avery, 5 programmes de compétition et une thématique autour du court métrage belge. Je vous laisse le plaisir de découvrir le programme sur leur site.
Caen, je ne connais pas. Le festival, 8e du nom, est organisé par l'Atelier du film court, l'association Lezardus et le cinéma Lux. Depuis le temps que je rencontre leurs responsables à Vendôme ou Clermont, j'avais vraiment envie de leur rendre visite. Ca devrait être plus conforme à l'idée d'une manifestation décontractée, festive et pleine de découvertes, un peu comme à Nice il y a trois semaine.
Je vous raconterais ça à mon retour.
13:20 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Festival, Caen, Court métrage | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/04/2005
Marilyn
22:25 Publié dans Actrices | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Marilyn Monroe, blog | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2005
La théorie du bon navet
Attention à l’importance des expressions !
Série B se réfère à un phénomène économique, celui des films de « première partie », plus courts, au budget réduit. Une série B peut être un grand film. Et dans l’absolu, on ne fait plus de série B depuis plus de 30 ans sauf John Carpenter.
Série Z ne correspond à rien, si ce n’est une façon de dire que le budget comme les intentions sont particulièrement misérables. Mais si l’on recrute de bons navets dans les séries Z, on y trouve surtout des films insignifiants, ennuyeux et simplement mal fichus.
Alors, attention, un bon navet, tout d’abord, c’est rare. Pour approcher d’une définition, je dirais que le bon navet est d’abord réjouissant et généralement pas dans le sens que le réalisateur et son équipe ont voulu lui donner. Un bon navet est souvent drôle, mais involontairement. Un bon navet ne pratique pas le second degré, puisque c’est dans le décalage entre les intentions et le résultat que le spectateur va trouver son plaisir. Un bon navet doit se prendre, un peu, au sérieux et c’est pour cela que les comédies ne donnent qu’exceptionnellement de bons navets. Une comédie est faite pour faire rire. Si elle échoue, c’est qu’elle n’est pas drôle, donc elle devient nulle et ne suscite que l’affligement.
Le bon navet relève très souvent du cinéma de genre ou cinéma d’exploitation, peplum, fantastique, western, polar… mais pas toujours. Un film ambitieux qui se plante peut donner un joli navet. Ce n’est pas non plus un problème de budget, il existe de superbes navets qui ont coûté la peau des fesses.
Bon, alors, ce navet trois étoiles ? Et bien, c’est un film dont l’un, plusieurs ou totalité des éléments constitutifs est complètement à côté de la plaque. C’est un acteur particulièrement mauvais jusqu’au risible (Brigitte Nielsen dans Red Sonja), un scénario plein de trous et de clichés (Le Pacte des Loups, pas un film fauché, hein ?), des dialogues qui laissent sans voix (Les Guerriers du Bronx, au hasard), un doublage surréaliste (Le zozotement du héros de Doc Savage Arrive !), des effets spéciaux touchants de naïveté (le Sixième Continent et ses suites), ou un peut tout ça à la fois (Godzilla contre Megalon qui est une perle).
J’insiste sur le fait qu’il est difficile de faire un bon navet, car il faut tenir la distance et ne pas perdre le spectateur susceptible de sortir en se disant qu’il perd son temps et sa vie devant une daube. Non, il faut de la constance dans le ridicule, du renouvellement dans les situations improbables et, quelque part, une certaine foi dans le cinéma. Et c’est pour cela qu’on peut aimer le bon navet. D’autant que la part de naïveté inhérente au genre peut donner d’étranges moments de poésie pure comme chez Ed Wood.
Assez de philosophie, des actes ! Quelques photos (sous copyright) pour illustrer mon propos et un lien indispensable (merci à Yohan) : www.nanarland.com
Ce site est non seulement indispensable si vous voulez tout savoir sur Max Thayer et la version turque de Star Wars, mais il est hilarant, plein d’extraits vidéo et audio, de photographies et de chroniques et même de philosophie. Un « must » comme on dit outre manche.
En anglais, donc, un autre site tout aussi fourni avec de nombreuses vidéos : www.badmovies.org
Allez-y, vous n’en reviendrez pas
13:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, navets, site internet, théories | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Images lointaines



12:15 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : souvenirs, christian-jaque, john ford, jacques tourneur, victor halperin | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/04/2005
Le Cauchemard de Darwin
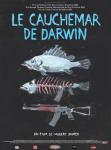
A travers l'histoire de l'introduction de la perche du Nil, un poisson introduit dans le lac Victoria (Tanzanie) il y a quelques dizaines d'années, le film est une dénonciation glaçante des ravages de la mondialisation et devrait vous inciter à changer de menu.
Pour plus de renseignements : le site ADN
11:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, ADN, Hubert Sauper | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/04/2005
Rendez-nous leurs bobines ! Un festival de cinéma pour Florence et Hussein

Après Raymond Depardon qui proposait La Captive du désert, Tony Gatlif qui a présenter un western de Robert Aldrich : El Perdido. Une rareté qui ressortira le 20 avril en copie neuve dans les cinémas Action, une reprise proposée ici en avant-première.
Un festival pas comme les autres (celui-ci aspire à durer le moins longtemps possible…)
Rendez-nous leurs bobines ! n'aspire pas à faire réfléchir sur le sort des otages, mais fonctionne sur un principe simple : celui d’un point de ralliement. Chaque dimanche, un réalisateur vient offrir un film, en avant-première ou en reprise, drame ou comédie, peu importe... Le tout étant d’être là pour se retrouver, gamberger, et continuer d’en discuter au bord du canal de l’Ourcq. En les attendant...
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Dimanche 10 avril à 11h : Kes de Ken Loach présenté par Jacques Audiard
Dimanche 17 avril à 11h : avant-premiere du nouveau film de Michel Deville, Le fil a la patte avec Emmanuelle Béart
Pour le comité de soutien,
Philippe Piazzo (06 64 15 79 78) pour la programmation et la présentation des séances
FAITES PASSER LE MESSAGE
18:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : information | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/04/2005
Eastwood, donc
Cet univers, Eastwood y est comme chez lui. Ce n'est certainement pas son intrigue et les péripéties de son entraîneur sur le retour qui décide de se mouiller une nouvelle fois en devenant le manger d'une jeune boxeuse qui innove. Non, on est en terrain connu, celui des salles de gym, des vestiaires minables, des combinaisons louches, l'univers déjà visité par Robert Wise, Stanley Kubrick ou Mark Robson. L'anecdote du poulain tocard qui va s'élever jusqu'aux sommets, c'est du classique aussi. Du classique au sens Fordien ou Hawksien. Quoique que pour le coup, nous sommes ici plus chez Ford (l'échec, les valeurs) que chez Hawks et son professionnalisme décontracté.
Mais à ce classicisme de la narration, on marche. On marche par c'est ce qui permet de mettre le spectateur dans le bain très vite et de l'emmener ailleurs. Un ailleurs de cinéma, du cinéma pur et du plus beau. Ce cinéma, c'est d'abord celui des acteurs, de l'émotion qui passe au niveau de cette relation de vieux couple entre Eastwood et Freeman, nouvelle variation de leur relation d'Impitoyable. Émotion du rapport entre l'entraîneur et sa boxeuse, Hillary Swank, terriblement attachante. D'ailleurs, et c'est sans doute un élément fondamental chez Eastwood, il reprend une nouvelle fois cette problématique de la relation père-enfant, souvent marquée par l'échec ou la mort, comme avec sa fille dans Jugé Coupable, le jeune soldat de Josey Wales ou le tueur débutant d'Impitoyable. Eastwood doit aimer ces personnages rongés de culpabilité, voyant leur échapper la transmission d'une génération à l'autre. C'est peut être ce qui agace certains dans son cinéma. Lui, le réalisateur comblé, lui l'interprète sûr de lui de Harry et autres héros de Léone, adore se mettre en scène en perdant, souvent, il faut le dire, magnifique.
Tout le monde est magnifique dans ce film et c'est cette justesse dans le jeu, cette apparente simplicité qui donne vie aux personnages et qui fait que l'on se passionne pour leur destin, même s'il est écrit d'avance, que l'on s'accroche à cette histoire comme si l'on vous la racontait pour la première fois.
Là où Eastwood va plus loin, là où il se révèle un grand metteur en scène, c'est dans sa démarche esthétique. Je suis resté cloué par la beauté de ses images comme devant celles, encore un fois de Ford ou de Hawks. Ce n'est pas une beauté virtuose, sophistiquée, mais au contraire, de cette simplicité qui ne s'obtient qu'avec la plus grande des rigueurs. Rigueur des cadres, rigueur des compositions, un exercice sur la lumière et les couleurs, ou plutôt sur un noir et blanc en couleurs, qui donne à son histoire une dimension quasi mystique. Le traitement du son appelle les mêmes éloges. La voix off dite par Freeman (pas de VF par pitié !) est l'une des plus belles que l'on ait entendue depuis longtemps. Musicale, comme un vieux blues, elle est autant sens dramatique que participante à l'atmosphère.
Bon, allez, je m'arrête, j'ai envie de faire des belles phrases pour vous parler de ce beau film. C'est idiot. Il se voit et il s'écoute. C'est du Cinéma.
23:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Clint Eastwood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2005
Million Dollar Baby
18:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : clint eastwood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/03/2005
Licence textes
22:40 Publié dans Licence | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Blog, licence | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Assaut, Rio, Bravo !
Chance, c’est surtout le nom du personnage joué par John Wayne dans le Rio Bravo de Howard Hawks. Ce pseudonyme, c’est un acte de filiation. On connaît l’admiration de Carpenter pour Hawks, et, au sein de son œuvre, pour ses thématiques, son sens de l’espace et le dispositif minimaliste qui élève Rio Bravo au rang des grandes tragédies classiques.
Ce qui est moins connu, c’est que la véritable inspiration d’Assaut, c’est un autre western, moins aboutit, plus ancien, réalisé en 1953 par John Sturges : Fort Bravo, dans lequel des nordistes avec leurs prisonniers sudistes sont coincés dans un trou en plein désert, assiégés par une horde d’indiens invisibles qui les bombardent dans un silence coupé de sifflements par une multitude de flèches. Si on prend la peine d’analyser les situations des trois films, on voit bien qu’Assaut a bien plus à voir avec le Fort qu’avec le Rio.
Alors, ça me fait un peu marrer, à l’occasion de la sortie du remake d’Assaut, d’entendre parler tout le monde de la filiation avec Rio Bravo. Du remake, rien à dire, je ne l’ai pas vu et puis j’irais pas. Comme pour L’Aube des Morts et Massacre à la Tronçonneuse, il s’agit de versions édulcorées, aseptisées, formatées, de grandes œuvres subversives des années 70. Roméro, Hooper et Carpenter faisaient de la vraie série B, des films engagés qui passaient par le fantastique et l’horreur pour s’attaquer violemment à la société de l’époque. Aujourd’hui, ils sont presque tous réduits au silence. Mais leur oeuvre est toujours très présente et le meilleur hommage que l’on puisse leur rendre, c’est de s’abstenir d’aller voir leur tristes clones qui seront oubliés dans deux ans.
13:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : John Carpenter, Howard Hawks, remake | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2005
Les aventures maritimes de Steve Zissou
Incarné par Bill Murray, Steve Zissou et son équipe sont les héros du nouveau film de Wes Anderson, réalisateur assez indépendant à qui l'on doit un premier film réalisé avec les frères Wilson : Bottle Rockett, inédit chez nous. En 1998, il se fait connaître avec l'original, Rushmore, histoire d'un étudiant atypique, avec déjà Bill Murray et La famille Tenenbaum avec, encore, Bill Murray au sein d'une distribution imposante.

Néanmoins, sa dépression latente ne l'empêchera pas de repartir une nouvelle fois à l'aventure, déterminé comme Achab à se venger du monstre aquatique, entouré de son équipe à toute épreuve parmi laquelle on compte un second germanique (Willem Dafoe), un cameraman hindou (Waris Ahluwalia), un guitariste brésilien qui joue Bowie ( Seu Jorge), deux dauphins albinos idiots et une horde de stagiaires bénévoles corvéables à merci. Pour simplifier, il se greffe un pilote qui est peut être son fils (Owen Wilson) et une journaliste enceinte (Cate Blanchett).
On l'aura compris, le film est une comédie un peu complexe. Sa ligne dramatique principale linéaire est constamment parasitée par une foule d'intrigues secondaires basées sur les rapports entre les différents personnages, rapports marqués par des interrogations telles que le rapport de filiation, la réussite, l'échec, le couple, la mort...
Je n'ai personnellement pas été tout à fait convaincu que cet ambitieux programme fonctionne. Le film n'est pas aussi drôle que l'on pouvait s'y attendre. Il fonctionne plus sur un humour décalé, proche de la bande dessinée avec de nombreuses ellipses. Le film a des ruptures de rythme parfois brutales et semble parfois chercher sa direction, à l'image de son personnage principal. Parfois, le dérapage dans la folie tombe à plat comme lors de l'évacuation musclée des pirates par Zissou, seul contre tous. Mais souvent, il se dégage en contrepartie une poésie bienvenue, les intermèdes musicaux par exemple, ou les petits animaux farfelus dessinés par Henry Selik, complice de Tim Burton, ou encore les plans séquences virtuoses du bateau, en coupe, qui rappellent ceux de la pension de jeunes filles filmée par Jerry Lewis dans Le tombeur de ces dames.
Le film emporte quand même l'adhésion, si l'on accepte son ton original, parce que c'est tout sauf un film bateau (facile !), parce qu'il est ambitieux et volontaire, parce que Wes Anderson aime faire du cinéma et que ça se voit, et enfin par l'excellence de sa distribution, visiblement motivée par l'aventure, Murray en tête, dans une prestation digne de ses grands moments.
23:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, Wes Anderson | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/03/2005
Tire encore... si tu peux !
Barney, un métis incarné avec beaucoup de charme par Thomas Millian, organise un hold up avec une bande moitié américaine, moitié mexicaine. Au moment du partage, les Américains, laissant ressortir leurs instincts racistes, exécutent les Mexicains et s’enfuient à travers le désert. Barney s’en sort miraculeusement. Il est recueilli par deux indiens qui rappellent étonnamment celui de Dead Man de Jim Jarmush, et qui acceptent de l’aider à se venger à condition qu’il leur raconte ce qu’il a vu « de l’autre côté », lui qui a été si proche de la mort. Entre temps, la bande américaine arrive dans un village à l’ambiance très étrange, ambiance que l’on retrouvera dans High plains drifter (L’homme des hautes plaines - 1973) de Clint Eastwood, une ambiance de corruption et de dépravation assez impressionnante. A partir de là, tout le film bascule. L’intrigue brasse nombre d’éléments classiques du western italien en les décalant systématiquement, mêle des réminiscences baroques et fantastiques, tant sur le fond que dans le style.

Question de style, Se sei vivo, spara surprend tout d’abord par ses premières séquences. Le générique, porté par la musique superbe de Ivan Vandor, alterne les plans d’inspiration fantastique de Barney s’extirpant de la fosse ou l’ont jeté ses ex-associés, puis étant soigné par les deux indiens philosophes, avec des images de l’exécution, montées très rapidement (c’est carrément du Eisenstein !), contrastant par leur lumière blanche de désert à midi, avec celles du « ressuscité », nocturnes et bleutées.
Gulio Questi, le réalisateur, n’a guère fait de films, et celui-ci est son unique western. Il s’en donne à cœur joie, même si certaines scènes paraîtront un peu pâles (l’attaque du début), il se rattrape par un montage très original, jouant sur le temps (la construction en flash back du début, les ellipses radicales) et l’espace (l’exécution des Américains, la mise à mort du chef). Il excelle surtout dans l’établissement de son climat baroque, à base de jeu sur les couleurs (les ambiances du saloon, les costumes noirs et blancs des « ragazzi » et de compositions étonnantes, dans un esprit très proche du surréalisme ou de Bunuel (l’arrivée des truands américains dans la ville est typique d’étrangeté). Sans multiplier les exemples, Se sei vivo, spara est un film hypnotique, un peu déstabilisant mais toujours surprenant.
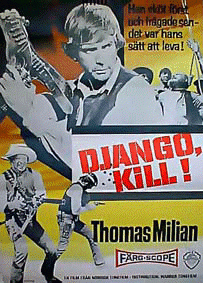
Question de fond, enfin, le film est assez virulent et, comme Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) de Sergio Corbucci, surprendra par son ton acide, un peu cynique et un peu amoral, aux antipodes de la « morale » des westerns américains. Ici pas de fin heureuse, ici, le massacre de innocents se déroule sous les yeux impuissants de l’anti-héros dégoûté. Ce n’est pourtant pas là que le film est le plus original, les meilleurs westerns italiens (Leone, Damiani, Corbucci…) se sont toujours fait une spécialité de transposer dans cet univers si spécial des préoccupations politiques et sociales très européennes et souvent très « à gauche » (exploitation du Tiers-Monde à travers les personnages de Mexicains, dénonciation du gros capitalisme à travers les américains, réflexions sur la guerre du Vietnam, critique de l’église…). Se sei vivo, spara ne déroge pas à la règle et Barney est un parfait héros libertaire, leader à la Che Guevara d’une bande de Péons trahis par l’Occident.
22:45 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, giulio questi, tomas milian | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/03/2005
Guédiguian et Mitterrand
L’une des forces du film de Robert Guédiguian est de ne pas donner de réponse, ce dont je lui suis gré. Il donne des pistes, des éléments, mais son film n’est ni un portrait à charge, ni une absolution, ni un cours d’histoire, ni une étude politique. C’est une tentative d’approcher l’homme à un moment clef de sa vie.

Il y a dans ce film quelque chose de Fordien, quelque chose de Vers sa destinée ou Lincoln n’est pas seulement Lincoln président légendaire, mais un jeune avocat de province avec les soucis, les joies et les peines d’un jeune avocat de province. Ce qui n’empêche pas le film de participer à la légende mais il lui donne un intérêt humain de premier plan.
Le Mitterrand de Guédiguian est un vieil homme au seuil de la mort et il se pose les questions de tout homme dans sa condition. Sans doute la légende est présente comme en filigrane. Comme le dit un des personnages du film, « Tu es comme les autres, tu finis par l’aimer », Guédiguian, comme tant d’autres, cède à la fascination de François Mitterrand, « dernier des grands présidents ». Mais Guédiguian reste aussi le réalisateur de l’Estaque, l’ancien communiste qui s’est interrogé dans son œuvre, depuis 1980, sur les désillusions de la classe ouvrière et l'impuissance du socialisme à changer la vie.
Il arrive à faire de son personnage historique un archétype que je rattacherais encore à Ford, à celui de La dernière fanfare, un de ses derniers films avec Spencer Tracy dans le rôle d’un politicien qui s’engage dans sa dernière élection, un homme qui n’a pas pris la mesure des changements du monde et qui meurt, lui aussi, à la fin.
Il y a beaucoup de points communs avec ce film. A commencer par le fond politique. Car si le film de Guédiguian n’est effectivement pas une analyse ou une critique politique littérale, il fait passer avec beaucoup d’intelligence une idée forte sur l’échec du socialisme incarné par Mitterrand : celle du décalage avec son époque. Arrivé peut être trop tard, il aurait perdu prise avec les grands mouvements du monde moderne. On voit constamment dans le film que Mitterrand est un homme inscrit dans l’Histoire, connaisseur de l’Histoire, lettré citant Duras, Lamartine, De Gaulle et Blum, héritier d’une époque qui n’a plus rien à voir avec le présent. Et cela, c’est encore plus vrai aujourd’hui qu’en 1995.
Quand le journaliste lui parle de mondialisation, il répond que l’Europe est en paix depuis 14 ans. Mitterrand vient d’une Europe en guerre : guerre mondiale, guerre civile, guerres coloniales. Quelles sont ses réponses pour une génération, bientôt deux, qui n’ont connu que la guerre économique ? Il n’en a pas.
La force du film, c’est de donner une forme cinématographique à cette idée. Guédiguian met en place un dispositif, comme souvent inspiré de son goût pour théâtre, où Mitterrand est isolé entre le témoin qu’il s’est choisi, le jeune journaliste (bien plus jeune que son modèle réel, Georges-Marc Benamou, et donc encore plus lointain des références du président) et quelques silhouettes : secrétaire, docteur, chauffeur, garde du corps. Guédiguian se refuse à montrer et même à nommer les autres protagonistes de ces années : vous ne verrez ni Chirac, ni Rocard, ni Jospin, ni personne. Seule Mazarine, sans doute pour la dimension humaine et inclination pour la littérature, est citée.
Mitterrand est aussi constamment inscrit dans le paysage de la France « éternelle », parcourant villes et villages symboles de siècles d’histoire. Scène inaugurale dans la cathédrale de Chartres, scène proustienne où le président parcours les gisants de rois oubliés. Scène mélancolique entre les cartons pleins de souvenirs lors du départ de l’Elysée. Scène fordienne encore dans le petit cimetière puis, plus tard, scène ultime dans l’église où il s’allonge. Il est déjà un fantôme quand il monte l’escalier de pierre, déjà avec ses morts comme Truffaut dans La Chambre Verte.
Les livres enfin, irriguent tout le film. Mitterrand amoureux des livres, c’est le Mitterrand le plus sympathique. Les livres sont de (presque) tous les plans. Pas les livres produits à la chaîne d’aujourd’hui, écrits par ce que l’on ose appeler un écrivain (dont le journaliste fait partie, d’une certaine façon). Mais les livres avec un grand L. Cervantès, Duras, Lamartine, Hugo, Valéry, Lévi, j’en oublie sûrement. Des livres que l’on caresse comme des femmes, des livres que l’on possède, des livres compagnons, des livres qui sont, comme chez Truffaut, notre plus bel héritage.
L’attachement à cette culture de la littérature est un fossé de plus entre Mitterrand et les générations de l’image et de l’ordinateur. Elle est pourtant une ultime possibilité de communication : maladroite lors de l’épisode du livre choisi pour l’anniversaire, porteuse d’espoir lorsque le journaliste fait le rencontre d’une… bibliothécaire. On a là de nouveau un très beau motif de cinéma, enchâssé dans la trame du film et riche de signification.
Symboliquement, Guédiguian met en avant l’affaire Bousquet comme révélatrice de ce fossé. A l’indignation du jeune journaliste qui « n’avale » pas les relations ambiguës du président avec le régime de Vichy, répond l’obstination du vieil homme : « Vichy n’était pas la France », l’excuse de sa jeunesse et d’un contexte plus que troublé. Guédiguian ne tranche pas, n’accuse ni n’excuse, mais laisse plusieurs personnages (la vieille résistante, la jeune bibliothécaire) faire la part des choses.
Là encore, le personnage du journaliste, joué avec beaucoup de sobriété par Jalil Lespert, incarne les doutes et les questionnements des nouvelles générations. C’est sans doute pourquoi il éprouve le besoin d’aller visiter Vichy pour se rendre compte qu’il n’y a rien à voir, rien que puisse apprendre le Vichy de 1995 sur celui de la collaboration. Le « tu n’as rien vu à … » de Duras s’applique à tous ces lieux que nous avons chargés d’Histoire mais qui, par eux même sont incapables de nous parler aujourd’hui.
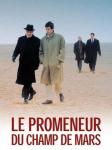
Pour terminer, la question qui s’est posée quand on a su que ce serait le cinéaste de l’Estaque qui porterait ce sujet à l’écran, c’est comment allait-il passer d’un cinéma du soleil à un cinéma de la grisaille. Réponse : en beauté. Beauté de l’image de Renato Berta revendiquée par une tirade pleine de chaleur de Bouquet-Mitterrand en forme d’ode au gris (entendre le noir et blanc cinématographique). Le film est une succession de noir et blanc en couleur, du sable des plages du nord aux ardoises des villages, des ors passés de l’Elysée au fameux manteau et chapeau présidentiels, des gris infinis de Paris aux gris illimités des champs de province.
En relevant le défi d’un sujet à priori anti-cinématographique et éloigné de son univers marseillais, Robert Guédiguian s’en sort avec talent et honneurs. Comme quoi il faut se méfier des a priori. Ce projet qui pouvait lui sembler si étranger, il en a fait, d’une certaine façon, l’un de ses films les plus personnels de part les réflexions qu’il développe, synthétisant et prolongeant celles de ses plus belles réussites ; et l’un de ses films les plus réussis de part sa grande maîtrise de son art : celui du cinéma.
Photographies : © Pathé Distribution
19:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma, Robert Guédiguian | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2005
Assassination tango
Il y joue un tueur à gage dont on ne saura jamais s'il travaille pour une agence occulte ou pour le crime organisé. Toujours est-il que c'est l'un de ces tueurs qui a une éthique de son métier (un peu comme le personnage d'Eastwood dans LA SANCTION). Il vit avec une femme qui a une petite fille. Le tueur et la fillette s'adorent. Le tueur est aussi danseur de salon.
Quand on l'envoie pour une mission à Buenos Aires, il ne manque pas de visiter les salles de danse et rencontre Manuela, superbe danseuse dont le tango le fascine. Bien sûr, il y a un grain de sable dans la mission et notre héros aura tout le temps de s'initier à la sensualité technique du tango argentin. Manuela ne le trouve pas trop vieux et elle a, elle aussi, une petite fille.

Je n'en dirais pas plus. Le film est d'une facture originale, d'un rytme inhabituel pour le cinéma américain moderne, sachant prendre son temps, mais soumis à de vives accélérations, un peu comme un morceau de tango, quoi. Et Luciana Pedraza est incroyablement belle.
Le DVD
19:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma, Robert Duvall | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2005
Musique à l'italienne
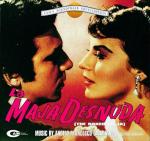
Passez visiter leur site : CAM Original Soundtrack il y a plein d’extraits à écouter.
18:00 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, musique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/01/2005
Courts métrages

Et puis, le court, c'est riche. Voir dix films en deux heures, c'est chouette. Mis à part les deux sélections, française et internationale, il y a du numérique, de l'animation, des rétropectives (Truffaut l'an dernier, très belle), des programmes spéciaux, parfois incroyables, bref, de quoi s'occuper toute la journée et la soirée. Ensuite, place aux afters...
Clermont existe depuis plus de vingt ans et ils ont fait énormément pour la reconnaissance du court. Malgré les critiques, comme la polémique de l'an dernier, cela reste le meilleur endroit pour découvrir les auteurs à venir du monde entier. Les programmations ont lieu dans toute la ville, toutes les salles, les amphis des facultés, les cinémas du centre et de la périphérie. C'est la fête.
Et puis, les gens sont agréables et compensent en chaleur humaine le froid qui peut être, en janvier, redoutable.
Les dates de cette année : 28 janvier - 5 février
le site
23:20 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, court métrage, festival, Clermont Ferrand | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/01/2005
Affiche
Je trouve que cela relève d’un certain culot. Pourquoi ? Parce que, pour se limiter au cinéma, je ne me souviens pas avoir vu des affiches similaires pour dénoncer les atteintes au statut des intermittents du spectacle, autrement plus graves en ce qui concerne la création. Parce que je ne me souviens pas avoir vu d’affiches dénoncer le désengagement de Canal+ dans le financement du cinéma. Parce que je ne me souviens de rien pour alerter le public du danger des multiplexes, ces hypermarchés du film. Parce que rien sur la défense de l’exception culturelle.
C’est culotté et hypocrite, insultant pour les spectateurs et assez malvenu. Pourquoi ? Parce que, en ce début d’année, on nous annonce une année cinéma exceptionnelle. La meilleure depuis 1987 ! Parce que les ventes de DVD explosent et, comme le fait remarquer Antoine de Baecque sur son « chat » de Libération, les DVD donnent envie aux spectateurs de retrouver le chemin des salles. Etonnant non ? Parce qu’il ne faut pas oublier, même si les films qui fonctionnent le mieux sont des films commerciaux, que le système d’aide français fait qu’automatiquement, les entrées en salle induiront une augmentation des aides aux films français, quelqu’ils soient.
Alors, ça veut dire quoi cette façon de culpabiliser les spectateurs ? Qu’est-ce que c’est que cette façon d’accueillir le public ?
Bien sûr, d’accord pour les pirates qui filment en salle (quoi qu’on les voit rarement filmer le dernier Kiarostami !) OK pour ceux qui revendent des copies, ce n’est pas élégant… Mais pour le reste, il est largement temps de redéfinir la notion de copie privée et cesser de vouloir gratter le beurre, l’argent du beurre et le sourire du cinéphile. Les majors du cinéma se foutent de nous quand ils revendent à prix d’or leurs catalogues amortis depuis 40 ans. Surtout quand il n’y a aucun travail éditorial autour (et je salue ici les éditions de Wild Side, HK vidéo, MK2, là au moins, il y a une véritable valeur ajoutée).
Que les salles se prêtent à cette pitrerie est désolant quand on sait que leur malheur est venu de la télévision et de sa démission en matière de propagation de la culture cinématographique. Une petite affiche sur le sujet, peut être ?
Personnellement, je ne charge pas de films. Ce qui m’intéresse dans le DVD, ce sont les possibilités de la VO et du sous titrage. Et puis, surtout, je n’ai pas de télévision, je me souviens de la phrase de Godard (qui d’autre !) qui dit à peu près que quand on a vu un film à la télévision, c’est comme si on disait avoir vu un tableau alors que l’on n’en a vu qu’une mauvaise photocopie. Et oui, le DVD, comme le CD, ce ne sont que des copies de copies des œuvres originales. Ben merde lors !
Au lieu de hurler au pirate, il serait plus normal de rappeler que l’endroit pour découvrir, voir et revoir un film, c’est la salle. Qu’il n’y a pas assez de salles et pas assez de programmations. Que ce n’est pas en inondant de milliers de copies les écrans avec le dernier « blockbuster » que l’on va défendre le cinéma. Et que celui-ci, si on le pirate, ce n’est vraiment pas bien grave.
« A la télévision, on baisse la tête pour voir le film, au cinéma, on la lève ».
23:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, droits | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |