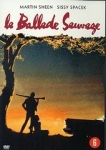17/09/2005
Le territoire des morts
La critique française se sent visiblement à l'aise avec les morts vivants de Georges Romero. Elle y plaque un discours post 11 septembre, alimenté par la réplique : « We do not negotiate with terrorists! » du personnage de Kaufman, joué par Dennis Hooper. Je pense que nombre d'entre nous aiment cette image que l'Amérique nous envoie d'elle-même. A la vision du film, cela ne m'a pourtant pas paru si essentiel. Bien moins que dans La Guerre Des Mondes de Spielberg par exemple.
Cet aspect y est bien sûr, mais le coeur reste le discours social, une lecture politique moins nationale, plus large, dans la continuité des trois oeuvres précédentes : La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants. Outre les peurs fondamentales liées à la mort et les valeurs attenantes (respect des morts, famille, enchaînement des générations) que véhiculent les morts vivants, Romero me semble s'être toujours attaché à décrire avec humour une certaine aliénation sociale engendrée par nos modes de vie occidentaux. Quel symbole plus fort que celui du centre commercial de Zombie ? Les morts y reviennent parce que c'est tout ce dont ils se souviennent de leur vie passée. Dans Le Jour des Morts Vivants, on assiste à la dégradation des relations sociales entre vivants (militaires et scientifiques ce qui n'aide pas) tandis que l'on essaye de recréer ces mêmes relations avec les morts. Ces tentatives vouées à l'échec se feront certes avec de la musique classique, mais surtout avec des objets aussi symboliques qu'un rasoir et un téléphone pour se terminer par un revolver.
Aujourd'hui, le quatrième film nous montre une nouvelle fois les morts vivants attirés irrésistiblement, non seulement par la chair fraîche, mais par un nouveau symbole de la "belle vie" occidentale : le bulding rutilant de Kaufman avec son conseil d'administration, ses riches désoeuvrés et son...centre commercial. Il n'est pas innocent, je suppose, que chacun des zombie se distingue par des vêtements qui traduisent son métier et trimballe jusque dans la mort ses outils de travail et les gestes qui vont avec (couperet du boucher, clef du mécanicien, pompe du garagiste, tondeuse du jardinier.). Aliénation par le travail mon cher Marx ! Tous ces morts qui marchent ne semblent chercher qu'à reproduire grotesquement une organisation sociale basée sur cette valeur. Là où Romero est subversif en diable, c'est que cette reproduction des comportements des vivants est totalement inutile : a quoi bon aller au centre commercial ? A quoi bon travailler ? Et les héros des films, tous, n'ont qu'une envie, se trouver un coin tranquille pour se laisser vivre. Le summum étant le final délicieux du Le Jour des Morts Vivants avec son héroïne enceinte sur une plage des Caraibes. Et que dire de la façon dont il traite l'argent, le sacro-saint dollar ! Ah, Romero, vous me faites plaisir.
Georges Romero fait partie de cette génération de cinéastes arrivés entre la fin des années soixante et le début des année soixante dix qui ont démarré dans leur coin avec des tout petits films d'horreur ayant largement contribué à révolutionner la représentation de la mort et de la violence au cinéma. Je pense à John Carpenter, Tobe Hooper, Wes Craven, Bob Clark. Leur cinéma se caractérise par une esthétique et des ressorts de série B combinée à cette vision sociale acide et un sens visuel très graphique. Leurs personnages se définissent avant tout par ce qu'ils font sans trop de psychologie. Les choix musicaux visent à l'efficacité. Le rythme est soutenu avec des montages serrés ce qui donne des films courts allant à l'essentiel. Avec les changements de Hollywood dans les années quatre vingt, il leur a fallu se soumettre où rester en marge. Carpenter est peut être celui qui s'en est le mieux tiré tandis que Craven et Clark rentraient dans le rang. Romero aura payé son intégrité de longs silences entre ses films. Aujourd'hui, il est ironique de voir ainsi saluer son retour. Mais il est plaisant de voir qu'il n'a rien renié de ses façons de faire. Land of the Dead est un film de genre de grande classe qui me fait penser aux derniers films de John Carpenter, Los Angeles 2013 et Gosts Of Mars en particulier. C'est fou ce que le camion blindé de Roméro ressemble au train de Carpenter. Juste un bemol pour terminer : Romero aurait pu se fouler un peu plus avec le personnage d'Asia Argento, elle restera la moins intéressante de ses héroïnes.
Le DVD
08:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Georges Romero, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/09/2005
Birdy Num Num
Allons y carrément, écrire sur The Party de Blake Edwards, c’est Écrire sur l’un des films les plus drôles du monde. Enfin, pour moi déjà et c'est déjà ça. Toutes considérations personnelles mises à part, ce film qui date de 1968 est la quintessence de la collaboration tumultueuse mais si riche entre le réalisateur Blake Edwards et l’acteur Peter Sellers. Ce dernier, Lolita et Folamour l’ont montré, est un génie du travestissement. Il campe ici un acteur indien (des Indes), complètement naïf, avec une très jolie voiture à trois roues, venu à Hollywood tourner un remake de Gunga Din. Ayant accumulé plusieurs catastrophes sur le tournage et détruit le décor, il est mis sur liste noire par le producteur du film.

Edwards déploie une mise en scène sophistiquée, contrôlant le lent mais sûr dérapage vers le chaos. Une mise ne scène toute au service de cet acteur d’exception qu’est Peter Sellers. Ses mimiques, son air embarrassé de gamin égaré dans un monde guindé qui la dépasse sont irrésistible. Il se confronte à tous les gadgets en vogue, révélant leur vacuité, voire leur nocivité. Sellers se déchaîne avec la fontaine d’intérieur, les WC, le système de hauts parleurs, comme avec le désormais célèbre perroquet (Birdie Num Num !). Venant d’un pays de tradition millénaire, un pays de spiritualité et de philosophie, il est révélateur, au sens chimique du terme, du vide de la civilisation américaine, mal masqué sous une technologie sophistiquée. Il fera exploser, comme le fortin du début, cette moderne forteresse du producteur hollywoodien, lieu d’un pouvoir dérisoire, pour y faire enter des barbares sympathiques (avec leur éléphant !), avant de repartir, malgré tout, avec la fille au volant de son étrange voiture. Musique très swing de l’ami et collaborateur de toujours, Henri Mancini. The Party est un vrai film culte, une vraie comédie et un vrai chef d’œuvre.
22:50 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Blake Edwards, Peter Sellers, comédie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
28/08/2005
The kid stays in the picture
Le film aurait aussi bien pu s'appeler "Une histoire Américaine", "Evans le magnifique" où "le Dernier Nabab", tant Robert Evans fait penser au Monroe Stahr campé par Robert De Niro dans le film de Kazan.
Mais finalement, tout est dans le titre : The Kid Stays In The Picture (le gamin reste dans le film) le Cinéma, l'autorité, le coup du destin, le côté protecteur, la revendication de l'instinct dans le choix, la morale américaine grand public et la jouissance du pouvoir qui repose dans les mots du producteur hollywoodien tel que le veut la légende.
Evans, Robert Evans, est bien une légende. Il est le producteur du Parrain et de Cotton Club de Coppola, de Rosemary's Baby et Chinatown de Polanski, de Love Story d'Arthur Hiller, du Conformiste de Bertolucci, de 100 $ Pour Un Shériff qui valu son unique oscar à John Wayne. Evans est le jeune play-boy bronzé qui commmença par une carrière d'acteur vite avortée (il est le toréro dans Le Soleil se Lève Aussi) qui va devenir patron de la Paramount à la fin des années 60 et enfoncera les records de recettes avec quelques uns des films sus-cités.
Le documentaire nous retrace tout ceci avec un commentaire de la voix même d'Evans. L'ensemble est enlevé, précis, passionnant, traçant le portrait d'un homme et de son époque. Une époque clef dans l'évolution d'Hollywood. Celle qui voit le système traditionnel achever de s'effondrer et la montée en puissance de la nouvelle génération, celle de Coppola.
Le film est aussi un mélange de sincérité (confession touchante sur Ali Mac Graw) et d'habiles ommissions. Ainsi le mystère sur le travail du producteur hollywoodien reste entier. Mis à part une séquence où l'on voit notre héros potasser un script de Robert Towne au bord de sa piscine, le fond de son activité professionnelle reste obscur. Discuter, négocier, baratiner, très bien mais encore ? Quand il dit avoir travaillé cinq ans sur Chinatown, j'aurais bien aimé savoir à quoi faire. On retrouve là cet espèce de complexe du producteur qui refuse d'être un simple rouage financier ou logistique, mais revendique une part de la création même.
Je ne nie pas cette part, particulièrement réelle dans le système hollywoodien, mais j'aurais aimé qu'il se livre plus là-dessus. Serait-ce de la pudeur ? Ou encore une façon de préserver la légende ? Imprimez la légende !
Le DVD
Photographie : Offoffoff Film
16:15 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, Hollywood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/07/2005
Burton, Kubrick et chocolat
Qu'attendre, à priori, d'une nouvelle adaptation de Charlie et la Chocolaterie, adaptation d'un classique de la littérature enfantine écrit en 1964 par Roald Dahl ? Attendre Burton et ne pas avoir d'à-priori, ce n'est pas beau.
Dans ce film, c'est une nouvelle fois le côté étrange de Tim Burton qui fonctionne, ce côté étrange que l'on a aimé dans Beetlejuice ou Edwards aux Mains d'Argent, ou Ed Wood. Ce côté qui fait qu'un jeune illustrateur veut entrer à tout prix chez Disney pour y faire un film comme Vincent, avec une star des films d'horreur (Vincent Price pour ceux qui n'ont pas vu ce petit bijou). Disney remerciera vite le jeune illustrateur. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Chez Burton, si, on peut s'amuser de tout. Des têtes coupées, des chiens raccommodés, des réalisateurs à pull angora.
Charlie et la Chocolaterie est un délice de double niveau. Au premier étage, un conte édifiant à la manière de James et la Pêche Géante (c'est aussi un conte de Dahl). Un monde coloré façon Oz, des numéros musicaux épatants, de l'humour, une morale familiale sans bavure. Au second étage, Burton se lâche comme rarement lors de la visite de cette usine sinistre extérieurement, angoissante à l'intérieur, construite en cercles comme l'Enfer de Dante. Ca commence avec ces marionnettes de cire qui se mettent à fondre comme dans le film avec... Vincent Price. Ca se poursuit avec l'apparition de Willie Wonka, Johnny Deep au mieux de sa forme, changeant d'expression toutes les secondes, qui m'est apparu comme une sorte de Michael Jackson, avec son visage blafard, inhumainement lisse, ses gants violets qu'il ne quittera jamais. Wonka-Jackson qui fait visiter son palais à des enfants, mais prudence, accompagnés d'un parent. Difficile de ne pas y penser. Wonka-Deep, c'est un peu le grand méchant loup de Tex Avery : on voit les dents. Ou plutôt, dans le contexte, la petite fêlure dont on ne sait jamais où elle va l'emmener. Tout cela nous met délicieusement mal à l'aise. Comme avec ces références insistantes à l'univers de Kubrick. Pas vraiment une référence pour enfants, non ? C'est pourtant avec les mots d'Orange Mécanique que Wonka-Deep répond à un sale gosse prétentieux. C'est pourtant autour d'une séquence de 2001 qu'est construite l'une des séquences clefs du film, critique en règle, bien que convenue, de l'influence de la télévision sur les enfants. Mal à l'aise, enfin, avec ces étranges Oompa Loompa , drôles, certes, mais quelque peu curieux, avec leur unique visage à la limite du zombie.
Convenue disais-je, oui, parce que le film, toujours en décalage, joue avec ce qu'il dénonce. On torture gentiment les enfants mal élevés, mais, au final, on construit sa fortune sur leurs envies. Comme dans nombre des films de Burton, on est toujours en équilibre entre la tentation de la franche déviance (Edwards, Wood, Jack...) et une morale bien sage (la famille, la communauté...). Frankenstein chez Disney, on n'en sort pas. Il y a une scène qui me semble révélatrice à ce sujet : La fillette gâtée qui se voit entourée par les écureuils me fait irrésistiblement penser à celle de la scène d'ouverture du Monde Perdu de Spielberg. Elle aussi se retrouve entourée de « gentils» dinosaures gros comme des... écureuils. La différence entre les deux fillettes, c'est que celle de Spielberg est dévorée vive. Hors champ, il ne faut pas exagérer.
08:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Tim Burton, Stanley Kubrick | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/07/2005
Guerre des Mondes
De fait, je ne suis pas loin de penser comme Tlön que La Guerre des Mondes est un film important, pour le cinéma de Spielberg et pour le cinéma américain d'aujourd'hui. Tout ce qui a été écrit autour du motif de l'oeil et du regard me semble juste et je n'y ajouterais rien. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'il m'apparaît comme le double inversé de Rencontres du 3e Type, retournant systématiquement les propositions de ce film de jeunesse. Le film d'une époque et d'un age d'enthousiasme et d'optimisme laissant place à une noirceur qui, après AI et Minority Report, fait froid dans le dos. Est-ce l'âge ou la marche du monde qui plonge ainsi Spielberg dans le pessimisme ? Sans doute un peu des deux. La Guerre des Mondes, très fidèle en cela au roman originel, est le récit d'une fuite, d'une terreur, d'une panique que rien ne saurait arrêter. Même le petit acte de bravoure du héros semble dérisoire face à l'ampleur destructrice de la menace extra-terrestre.
Il y a , comme dans Rencontres... un héros quelque peu immature, ouvrier de profession (électricien / grutier), petit de taille (incroyable comme Tom Cruise semble aussi jeune que son fils) mais cette fois, la famille est éclatée et la violence est présente dès le début avec la glaçante scène du base-ball. Et le héros ira jusqu'au meurtre.
Il y a , comme dans Rencontres... un voyage, mais un voyage de cauchemar qui est une fuite éperdue loin de la recherche de la révélation d'un miracle. Un voyage qui culmine avec les scènes d'émeute autour de la voiture (quel symbole !).
Il y a , comme dans Rencontres... ce son un peu grave qui annonce l'arrivée des engins spatiaux. Mais ici, pas de tentative de contact, pas d'observation les yeux grands ouverts, émerveillés. Cette fois, ce sont des yeux tétanisés par l'horreur.
Il y a comme chez E.T., le bras décharné qui se tend, mais ce n'est pas un bras ami, c'est un bras de mort.
Il y a l'enlèvement d'un enfant.
Il n'y a pas, il n'y a plus cette élaboration d'une communication à travers la musique. La communication, ce thème central de l'oeuvre de Spielberg est totalement absente de ce film, et ce pour la première fois. Le film est sur cette absence, cette impossibilité. C'est là, pour moi, qu'il est le plus « politique ». Parce que le film, comme Minority Report nous parlait de délire sécuritaire, nous parle de notre monde et, en l'occurrence, de la guerre que livrent les États-Unis à un ennemi impitoyable, peu visible et avec lequel ils sont incapables de communiquer. Et Spielberg, comme H.G.Wells, n' a pas de réponse, sinon l'ironie d'une intervention in extremis du destin. Comme réalisateur virtuose, il met désormais le même talent à faire surgir du quotidien, non plus le merveilleux, mais la peur. Il fait resurgir les images des pire conflits de ces dernières années, le 11 septembre et l'Irak évidemment, mais aussi les conflits africains avec ces cadavres charriés par le fleuve, les Balkans avec ces guérillas urbaines. Il y a l'image des cendres, qui ramène à New-York mais aussi au Varsovie de Schindler. Très fort. Fusion (presque) parfaite entre la forme et le fond, le film emporte dans son mouvement et laisse émerger la réflexion. Nous en sommes donc arrivés là ?
Quelques mots pour finir sur la fin. Elle est outrageusement mélodramatique. Spielberg a souvent eu du mal à terminer ses films, allant jusqu'à empiler plusieurs fins l'une derrière l'autre. Celle-ci me laisse dubitatif. Notre héros à triomphé de ses épreuves, et alors ? J'ai un peu pensé au final de La Prisonnière du Désert, avec ce porche et ce plan de la porte. Il faudrait peut être creuser l'idée.
12:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Steven Spielberg | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/07/2005
L'enfance d'Ivan
04:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Andrei Tarkovski, Sam Peckinpah | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2005
La scène du téléphone
01:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blog, théorie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/06/2005
Quelques couples de plus.
18:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blog, théorie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/06/2005
Couples en images
13:55 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blog, théorie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2005
Histoires de couples
Louis: Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Marion: Pourtant hier, tu disais que c'était une joie.
Louis: C'est une joie et une souffrance.
Marion: Je vous aime.
Louis: Je te crois.
Vivian : Speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first, see if they're front-runners or come from behind, find out what their whole card is, what makes them run.
Marlowe : Find out mine?
Vivian : I think so.
Marlowe :Go ahead.
Vivian : I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front, open up a lead, take a little breather in the backstretch, and then come home free.
Marlowe : You don't like to be rated yourself.
Vivian : I haven't met anyone yet that can do it. Any suggestions?
Marlowe : Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. You've got a touch of class, but I don't know how, how far you can go.
Vivian : A lot depends on who's in the saddle.
James Stewart de Dona Reed dans La Vie est Belle de Franck Capra
John Wayne et Angie Dickinson dans Rio Bravo de Howard Hawks
Birger Malmsten et Eva Henning, La Fontaine d'Arethuse de Igmar Bergman
Maggie Cheung et Tony Leung dans In The Mood For Love de Wong Kar-Wai
Charlie Young et Nicky Wu The Lovers de Tsui Hark
Humphrey Bogart et Elizabeth Sellars dans La Comtesse aux pieds nus de Joseph L Mankiewicz.
John Wayne et Maureen O'Hara dans L'Homme Tranquille de John Ford
Charlie Chaplin et Paulette Goddard dans Les Temps Modernes de Charlie Chaplin
Alberto Sordi et Léa Massari dans Une Vie Difficile de Dino Risi
Cary Grant et Katharine Hepburn dans Indiscretions de Georges Cuckor

Feathers: I thought you were never going to say it.
John T. Chance: Say what ?
Feathers: That you love me.
John T. Chance: I said I'd arrest you.
Feathers: It means the same thing, you know that
15:00 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, blog, théorie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
10/06/2005
Balade ou Ballade sauvage ?
13:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Terrence Malik | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/06/2005
Malik, Springsteen et Hawks
I saw her standin' on her front lawn just twirlin' her baton
Me and her went for a ride sir and ten innocent people died
Ce sont, en version originale, les deux premières phrases de la chanson de Springsteen «Nebraska », de l’album éponyme de 1983. Ce pourrait être le résumé littéral de Badlands (la Ballade Sauvage) premier film tant admiré de Terrence Malik. Ce pourrait certainement l’être vu que Springsteen a toujours revendiqué l’influence de ce film sur son œuvre. Tous les deux ont pour base la cavale sanglante de ce couple de jeunes américains, Charles Starkweather et Caril Fugate à la fin des années 50.
La chanson, je l’écoute depuis des années, je crois même que c’est le tout premier CD que je me suis acheté. Le film, on m’en a beaucoup parlé, surtout à l’époque de La Ligne Rouge. Mais La Ligne Rouge, je n’aime pas tellement. Je n’aime pas la philosophie du film, ou plutôt le plaquage du discours philosophique sur le film dont la forme reste malgré tout si conventionnelle si on la compare à celles de Samuel Fuller, Raoul Walsh, Steven Spielberg ou Robert Aldrich (vous retrouverez sans peine les films auxquels je fais allusion).
J’ai donc pu découvrir La Ballade Sauvage ce week end, grâce à la programmation de Cinéma Sans Frontières, et je me suis retrouvé tout aussi perplexe que face à La Ligne Rouge. L’intéressant, c’est que le débat qui a suivi m’a permis de mieux comprendre ce qui me gênait. Sur la forme et, globalement sur l’interprétation, rien à dire. Malik est un grand cinéaste qui sait filmer la nature, la lumière, qui sait en donner une image lyrique, poétique, vivante et vibrante.
Sur le fond, j’ai bien l’impression que les deux films racontent la même histoire. De jeunes êtres humains (notre couple, les jeunes soldats) veulent « être » au monde et cherchent une sorte de paradis perdu en communion avec la nature (la cabane dans l’arbre, l’île paradisiaque). Mais, inadaptés comme tous les hommes, ils sont rattrapés par la violence et replongés de force dans la société humaine, celle de la guerre et du meurtre, sous le regard indifférent de la nature. Ils chercheront en vain à s’en sortir et trouvent le mort au bout du voyage (mort physique ou spirituelle). Morale, l’homme est une pièce rapportée dans la nature, inadapté il ne porte que la destruction en lui et ne peut atteindre au « divin ».
Bien. C’est une thèse. Mais j’ai du mal à la partager. Je me sens absolument plus proche de la vision d’un Renoir, d’un Ford ou d’un Hawks pour lesquels l’homme est capable de fusionner avec la nature, il s’y révèle et s’y épanouit, voire s’y transcende. Je pensais à des films comme la Captive aux Yeux Clairs ou Hatari !, qui représentent sans doute l’absolu hawksien en la matière et dans lesquels je me retrouve complètement.
C’est sans doute pour cela que je reconnais l’art de Malik mais qu’il me restera sans doute toujours un peu étranger. Curieusement, je n’ai pas ce problème avec Springsteen. Je l’ai toujours vu comme l’héritier rock de John Ford. Va savoir !
12:45 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Terrence Malik, Howard Hawks, théorie, Bruce Springsteen | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2005
Westerns all'dente
11:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, Sergio Corbucci, Sergio Sollima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2005
Que la force, etc.
Lucas a eu tort d’arrêter si longtemps pour reprendre si tard. Nous n’avons plus 15 ans et ce que nous acceptions alors, ça passe moins bien aujourd’hui. C’est sans doute pour avoir oublié ça qu’il s’est lourdement planté avec l’épisode I, que nous ne sommes plus aussi sincères dans l’attente des épisodes II et, aujourd’hui, de cette Revanche des Siths. Et que l’on ne me dise pas que nous avons vieillis. Enfin, si, on est plus vieux, mais quand je regarde King Kong, Rio Bravo ou Indiana Jones, je retrouve toujours mon « âme d’enfant ». Et quand je regarde les deux premiers épisodes, ceux historiques, je marche toujours. Parce qu’alors, Lucas , qui ne savait pas encore bien où il allait, était encore capable de partager son innocence avec nous. Parce que les effets spéciaux, un peu imparfaits, participaient de la naïveté de l’entreprise. Parce que Leight Brackett et Lawrence Kasdan avaient écrit le scénario de L’Empire Contre Attaque et qu’ils savaient écrire des films d’aventure et de science fiction.
Difficile aujourd’hui de regarder un des nouveaux Star Wars autrement que comme le nouveau « blockbuster ». Fini le temps du film exceptionnel qui repoussait les limites de l’imaginaire. Dès le Retour du Jedi, Lucas est devenu prisonnier de sa réussite. C’est un peu pathétique de le voir, aujourd’hui, essayer de raccrocher les wagons en élaborant à posteriori une philosophie globale pour les 6 épisodes. Dans la première trilogie, on riait pas mal avec les héros, des héros avec lesquels on pouvait s’identifier. Dans la seconde série, on ri peu, avec une créature virtuelle moche comme un pou, et le héros, censé nous ressembler, reste trop lisse. Ah ! Où sont la maladresse de Solo, les timidités de Luke, les crises d’autorité de Leia ?
Ce qui est amusant aussi, c’est tout le baratin que l’on fait sur le côté sombre et pessimiste qui dominerait la série. Comme si l’ensemble de la saga n’était pas d’un optimisme avéré. Lucas ne fait qu’appliquer les règles de bases de la dramaturgie : plus la chute est profonde, plus le mal est puissant, plus le mérite des héros est grand.
Il pourrait rester les films, mais non ! Même pas depuis que Tonton Georges a cru bon de les reprendre et de les tripoter. Ca, c’est vache. Retirer comme cela une part d’enfance à ses fans… Mais bon. Pas le choix. J’irais quand même voir la fin du début de l’histoire. Il parait que c’est pas mal. Avant, si j’ose dire, c’était merveilleux.
10:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Georges Lucas, Star Wars | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2005
Images lointaines



12:15 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : souvenirs, christian-jaque, john ford, jacques tourneur, victor halperin | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/04/2005
Le Cauchemard de Darwin

A travers l'histoire de l'introduction de la perche du Nil, un poisson introduit dans le lac Victoria (Tanzanie) il y a quelques dizaines d'années, le film est une dénonciation glaçante des ravages de la mondialisation et devrait vous inciter à changer de menu.
Pour plus de renseignements : le site ADN
11:35 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Documentaire, ADN, Hubert Sauper | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/04/2005
Eastwood, donc
Cet univers, Eastwood y est comme chez lui. Ce n'est certainement pas son intrigue et les péripéties de son entraîneur sur le retour qui décide de se mouiller une nouvelle fois en devenant le manger d'une jeune boxeuse qui innove. Non, on est en terrain connu, celui des salles de gym, des vestiaires minables, des combinaisons louches, l'univers déjà visité par Robert Wise, Stanley Kubrick ou Mark Robson. L'anecdote du poulain tocard qui va s'élever jusqu'aux sommets, c'est du classique aussi. Du classique au sens Fordien ou Hawksien. Quoique que pour le coup, nous sommes ici plus chez Ford (l'échec, les valeurs) que chez Hawks et son professionnalisme décontracté.
Mais à ce classicisme de la narration, on marche. On marche par c'est ce qui permet de mettre le spectateur dans le bain très vite et de l'emmener ailleurs. Un ailleurs de cinéma, du cinéma pur et du plus beau. Ce cinéma, c'est d'abord celui des acteurs, de l'émotion qui passe au niveau de cette relation de vieux couple entre Eastwood et Freeman, nouvelle variation de leur relation d'Impitoyable. Émotion du rapport entre l'entraîneur et sa boxeuse, Hillary Swank, terriblement attachante. D'ailleurs, et c'est sans doute un élément fondamental chez Eastwood, il reprend une nouvelle fois cette problématique de la relation père-enfant, souvent marquée par l'échec ou la mort, comme avec sa fille dans Jugé Coupable, le jeune soldat de Josey Wales ou le tueur débutant d'Impitoyable. Eastwood doit aimer ces personnages rongés de culpabilité, voyant leur échapper la transmission d'une génération à l'autre. C'est peut être ce qui agace certains dans son cinéma. Lui, le réalisateur comblé, lui l'interprète sûr de lui de Harry et autres héros de Léone, adore se mettre en scène en perdant, souvent, il faut le dire, magnifique.
Tout le monde est magnifique dans ce film et c'est cette justesse dans le jeu, cette apparente simplicité qui donne vie aux personnages et qui fait que l'on se passionne pour leur destin, même s'il est écrit d'avance, que l'on s'accroche à cette histoire comme si l'on vous la racontait pour la première fois.
Là où Eastwood va plus loin, là où il se révèle un grand metteur en scène, c'est dans sa démarche esthétique. Je suis resté cloué par la beauté de ses images comme devant celles, encore un fois de Ford ou de Hawks. Ce n'est pas une beauté virtuose, sophistiquée, mais au contraire, de cette simplicité qui ne s'obtient qu'avec la plus grande des rigueurs. Rigueur des cadres, rigueur des compositions, un exercice sur la lumière et les couleurs, ou plutôt sur un noir et blanc en couleurs, qui donne à son histoire une dimension quasi mystique. Le traitement du son appelle les mêmes éloges. La voix off dite par Freeman (pas de VF par pitié !) est l'une des plus belles que l'on ait entendue depuis longtemps. Musicale, comme un vieux blues, elle est autant sens dramatique que participante à l'atmosphère.
Bon, allez, je m'arrête, j'ai envie de faire des belles phrases pour vous parler de ce beau film. C'est idiot. Il se voit et il s'écoute. C'est du Cinéma.
23:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Clint Eastwood | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/03/2005
Assaut, Rio, Bravo !
Chance, c’est surtout le nom du personnage joué par John Wayne dans le Rio Bravo de Howard Hawks. Ce pseudonyme, c’est un acte de filiation. On connaît l’admiration de Carpenter pour Hawks, et, au sein de son œuvre, pour ses thématiques, son sens de l’espace et le dispositif minimaliste qui élève Rio Bravo au rang des grandes tragédies classiques.
Ce qui est moins connu, c’est que la véritable inspiration d’Assaut, c’est un autre western, moins aboutit, plus ancien, réalisé en 1953 par John Sturges : Fort Bravo, dans lequel des nordistes avec leurs prisonniers sudistes sont coincés dans un trou en plein désert, assiégés par une horde d’indiens invisibles qui les bombardent dans un silence coupé de sifflements par une multitude de flèches. Si on prend la peine d’analyser les situations des trois films, on voit bien qu’Assaut a bien plus à voir avec le Fort qu’avec le Rio.
Alors, ça me fait un peu marrer, à l’occasion de la sortie du remake d’Assaut, d’entendre parler tout le monde de la filiation avec Rio Bravo. Du remake, rien à dire, je ne l’ai pas vu et puis j’irais pas. Comme pour L’Aube des Morts et Massacre à la Tronçonneuse, il s’agit de versions édulcorées, aseptisées, formatées, de grandes œuvres subversives des années 70. Roméro, Hooper et Carpenter faisaient de la vraie série B, des films engagés qui passaient par le fantastique et l’horreur pour s’attaquer violemment à la société de l’époque. Aujourd’hui, ils sont presque tous réduits au silence. Mais leur oeuvre est toujours très présente et le meilleur hommage que l’on puisse leur rendre, c’est de s’abstenir d’aller voir leur tristes clones qui seront oubliés dans deux ans.
13:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : John Carpenter, Howard Hawks, remake | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2005
Les aventures maritimes de Steve Zissou
Incarné par Bill Murray, Steve Zissou et son équipe sont les héros du nouveau film de Wes Anderson, réalisateur assez indépendant à qui l'on doit un premier film réalisé avec les frères Wilson : Bottle Rockett, inédit chez nous. En 1998, il se fait connaître avec l'original, Rushmore, histoire d'un étudiant atypique, avec déjà Bill Murray et La famille Tenenbaum avec, encore, Bill Murray au sein d'une distribution imposante.

Néanmoins, sa dépression latente ne l'empêchera pas de repartir une nouvelle fois à l'aventure, déterminé comme Achab à se venger du monstre aquatique, entouré de son équipe à toute épreuve parmi laquelle on compte un second germanique (Willem Dafoe), un cameraman hindou (Waris Ahluwalia), un guitariste brésilien qui joue Bowie ( Seu Jorge), deux dauphins albinos idiots et une horde de stagiaires bénévoles corvéables à merci. Pour simplifier, il se greffe un pilote qui est peut être son fils (Owen Wilson) et une journaliste enceinte (Cate Blanchett).
On l'aura compris, le film est une comédie un peu complexe. Sa ligne dramatique principale linéaire est constamment parasitée par une foule d'intrigues secondaires basées sur les rapports entre les différents personnages, rapports marqués par des interrogations telles que le rapport de filiation, la réussite, l'échec, le couple, la mort...
Je n'ai personnellement pas été tout à fait convaincu que cet ambitieux programme fonctionne. Le film n'est pas aussi drôle que l'on pouvait s'y attendre. Il fonctionne plus sur un humour décalé, proche de la bande dessinée avec de nombreuses ellipses. Le film a des ruptures de rythme parfois brutales et semble parfois chercher sa direction, à l'image de son personnage principal. Parfois, le dérapage dans la folie tombe à plat comme lors de l'évacuation musclée des pirates par Zissou, seul contre tous. Mais souvent, il se dégage en contrepartie une poésie bienvenue, les intermèdes musicaux par exemple, ou les petits animaux farfelus dessinés par Henry Selik, complice de Tim Burton, ou encore les plans séquences virtuoses du bateau, en coupe, qui rappellent ceux de la pension de jeunes filles filmée par Jerry Lewis dans Le tombeur de ces dames.
Le film emporte quand même l'adhésion, si l'on accepte son ton original, parce que c'est tout sauf un film bateau (facile !), parce qu'il est ambitieux et volontaire, parce que Wes Anderson aime faire du cinéma et que ça se voit, et enfin par l'excellence de sa distribution, visiblement motivée par l'aventure, Murray en tête, dans une prestation digne de ses grands moments.
23:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, Wes Anderson | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/03/2005
Tire encore... si tu peux !
Barney, un métis incarné avec beaucoup de charme par Thomas Millian, organise un hold up avec une bande moitié américaine, moitié mexicaine. Au moment du partage, les Américains, laissant ressortir leurs instincts racistes, exécutent les Mexicains et s’enfuient à travers le désert. Barney s’en sort miraculeusement. Il est recueilli par deux indiens qui rappellent étonnamment celui de Dead Man de Jim Jarmush, et qui acceptent de l’aider à se venger à condition qu’il leur raconte ce qu’il a vu « de l’autre côté », lui qui a été si proche de la mort. Entre temps, la bande américaine arrive dans un village à l’ambiance très étrange, ambiance que l’on retrouvera dans High plains drifter (L’homme des hautes plaines - 1973) de Clint Eastwood, une ambiance de corruption et de dépravation assez impressionnante. A partir de là, tout le film bascule. L’intrigue brasse nombre d’éléments classiques du western italien en les décalant systématiquement, mêle des réminiscences baroques et fantastiques, tant sur le fond que dans le style.

Question de style, Se sei vivo, spara surprend tout d’abord par ses premières séquences. Le générique, porté par la musique superbe de Ivan Vandor, alterne les plans d’inspiration fantastique de Barney s’extirpant de la fosse ou l’ont jeté ses ex-associés, puis étant soigné par les deux indiens philosophes, avec des images de l’exécution, montées très rapidement (c’est carrément du Eisenstein !), contrastant par leur lumière blanche de désert à midi, avec celles du « ressuscité », nocturnes et bleutées.
Gulio Questi, le réalisateur, n’a guère fait de films, et celui-ci est son unique western. Il s’en donne à cœur joie, même si certaines scènes paraîtront un peu pâles (l’attaque du début), il se rattrape par un montage très original, jouant sur le temps (la construction en flash back du début, les ellipses radicales) et l’espace (l’exécution des Américains, la mise à mort du chef). Il excelle surtout dans l’établissement de son climat baroque, à base de jeu sur les couleurs (les ambiances du saloon, les costumes noirs et blancs des « ragazzi » et de compositions étonnantes, dans un esprit très proche du surréalisme ou de Bunuel (l’arrivée des truands américains dans la ville est typique d’étrangeté). Sans multiplier les exemples, Se sei vivo, spara est un film hypnotique, un peu déstabilisant mais toujours surprenant.

Question de fond, enfin, le film est assez virulent et, comme Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) de Sergio Corbucci, surprendra par son ton acide, un peu cynique et un peu amoral, aux antipodes de la « morale » des westerns américains. Ici pas de fin heureuse, ici, le massacre de innocents se déroule sous les yeux impuissants de l’anti-héros dégoûté. Ce n’est pourtant pas là que le film est le plus original, les meilleurs westerns italiens (Leone, Damiani, Corbucci…) se sont toujours fait une spécialité de transposer dans cet univers si spécial des préoccupations politiques et sociales très européennes et souvent très « à gauche » (exploitation du Tiers-Monde à travers les personnages de Mexicains, dénonciation du gros capitalisme à travers les américains, réflexions sur la guerre du Vietnam, critique de l’église…). Se sei vivo, spara ne déroge pas à la règle et Barney est un parfait héros libertaire, leader à la Che Guevara d’une bande de Péons trahis par l’Occident.
22:45 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, giulio questi, tomas milian | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |