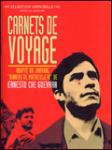16/06/2006
Django
Le moment me semble bien choisi pour vous faire partager l'ouverture de ce film emblématique du western italien : Django, réalisé en 1966 par Sergio Corbucci. Film matrice, créateur d'un mythe qui inspirera des légions (romaines) de déclinaisons (latines), souvent imité mais bien sûr jamais égalé, Django est un diamant noir. Les quelques minutes de l'ouverture suffisent à exprimer la radicalité du projet de Corbucci. Jamais un héros de western n'était arrivé à pied, à l'exception de John Wayne dans Hondo de John Farrow, mais il marchait de face, au soleil, un chien sur les talons. Deux ans plus tôt, Sergio Léone faisait arriver l'homme sans nom, Clint Eastwood, sur un âne, c'était un premier pas ironique. Django lui, enveloppé dans sa cape noire, chemine péniblement sous une fine pluie, de dos, trébuchant dans la boue, traînant son mystérieux cercueil comme une croix. Le paysage n'est pas ouvert sur de vastes étendues mais, désolé, se refermant entre deux collines chétives.
Franco Nero raconte avec humour comment lors du tournage de cette scène, Corbucci lui a donné comme instructions d'avancer sans se retourner et qu'il lui dirait quand stopper. Au bout d'une dizaine de minutes, n'entendant rien venir, il se retourne et découvre que l'équipe s'est fait discrètement la malle. Un certain sens de la plaisanterie.
Corbucci retourne soigneusement tous les signes habituels du genre pour donner une vision étonnamment neuve et sombre. Second élément qui place d'emblée Django à mille lieues au-delà de Per un pugno di dollari (Pour une poignée de dollars - 1964) et de ce qui avait été fait jusqu'ici, l'irruption du fantastique gothique. Le cercueil, bien sûr, mais aussi ces lettres rouges sang, dont la police serait adaptée aux films de la Hammer anglaise ou à ceux de Mario Bava. Si les premiers westerns italiens se plaçaient sous le signe de l'imitation, si Léone allait « s'inspirer » du Yojimbo de Kurosawa et engager un cow-boy authentique, Corbucci va puiser son inspiration visuelle dans une tradition bien européenne et à-priori aussi éloignée que possible de l'univers du western. Comme il le fera deux ans plus tard dans Le grand silence, il n'hésite pas à s'asseoir sur le genre. Il ne rend pas hommage, il ne fait pas de clin d'oeil, il subvertit, il dynamite dans un grand éclat de rire sardonique. Car l'humour ne manque pas dans Django, un humour noir all'dente comme lors de la scène de l'oreille. Un humour qui passe ici par les paroles de la chanson pop chantée par Roberto Fia sur la musique de Luis Bacalov. Une chanson qui parle d'amour perdu, d'une femme aimée, du soleil qui brillera demain. Une chanson dont les mots sont en contradiction totale avec ce qui nous est montré sur l'écran. Une chanson qui laisse croire que le film sera une nouvelle histoire de vengeance. Mais l'entreprise de subversion des codes menée par Corbucci va jusqu'à s'en prendre au western italien lui-même et ce thème de la vengeance laisse brutalement place, à mi parcours du film, à des motivations plus vénales. Corbucci va au bout, jusqu'à cette rédemption improbable au cœur d'un cimetière. Revenu du royaume des morts, c'est chez eux que Django retourne pour puiser les dernières forces nécessaires à son ultime combat.
A lire, le très bel article de Francis Moury sur DVDrama auquel il me semble que Ludovic rend hommage.
Django, have you always been alone?
Django, have you never loved again?
Love will live on, Oh Oh Oh...
Life must go on, Oh Oh Oh...
For you cannot spend you life regreatting.
Django, you must face another day.
Django, now your love has gone away.
Once you loved her, whoa-oh...
Now you've lost her, whoa-oh-oh-oh...
But you've lost her for-ever, Django.
When there are clouds in the skies, and they are grey.
You may be sad but remember that love will pass away.
Oh Django!
After the showers is the sun.
Will be shining...
Once you loved her, Whoa-oh...
Now you've lost her, Whoa-oh-oh-oh...
But you've lost her for-ever, Django.
When there are clouds in the skies, and they are grey.
You may be sad but remember that love will pass away.
Oh Django!
After the showers is the sun.
Will be shining...
Django!
Oh Oh Oh Django!
You must go on,
Oh Oh Oh Django...
23:05 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, sergio corbucci, western | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
09/06/2006
Puisque l'on en parle...
10:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/05/2006
Cannes (4)
Du bon usages des archives
C'est la première fois que je vois un travail issu de la fondation montée par Steven Spielberg pour recueillir les témoignages des survivants de la Shoah. Une organisation qu'il a mise sur pied suite à La liste de Schindler. En l'occurrence, Volevo solo vivere est réalisé par Mimmo Calopresti qui avait mis Nanni Moretti en scène dans La seconda volta. Le film documentaire laisse la parole à neuf survivants, surtout des survivantes, du camp d'Auschwitz. L'une d'elle fut déportée dans le même convoi que celui de Primo Levi. Les neuf parcours déclinent le sinistre engrenage de l'extermination, depuis les premières lois raciales mises en place par Mussolini jusqu'à l'accélération due à l'invasion allemande après 1943 et la chute du Duce. Les récits sont émouvants avec, pour certains, cet humour tout autant italien que juif. Il faut entendre cette vieille femme digne raconter son premier contact avec un libérateur américain : « C'était Tom Cruise ! ». Tous ont des moments glaçants, en particulier l'homme qui opérait dans le « sonderkommando » chargé d'encadrer les opérations au plus près des chambres à gaz et qui doit assister la dernière heure d'un cousin. On a là la même force que chez Lanzmann. Par contre, je me suis interrogé sur l'emploi de quelques images d'archives qui ponctuent, sur une musique redondante (pour rester gentil), les différents témoignages. Si les photographies des proches des différents intervenants sont en situation, les autres images, souvent assez connues et de sources très diverses, ne semblent rien apporter, créant même une distance regrettable entre le temps du film et celui des récits. Comme si le spectateur avait besoin de cette sorte de rappel, d'illustration de ce qui est dit et qui possède en soi une telle force.
08:18 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/05/2006
Cannes (1)
Petit passage à Cannes
Cannes, toujours ce mélange de fascination et de répulsion. Cannes, ses palmiers, ses queues interminables, ses vigiles plutôt sympas, ses hôtesses inspectrices de sacs toujours charmantes, ses CRS garés sur le côté, toujours trop nombreux (mais moins que la dernière fois), ses cocktails sur le port entre 17 et 19 heures, ses affiches de films improbables, son Lloyd Kaufman, ses myriades de jolies femmes que l'on ne voit dans de telles tenues qu'ici et une fois par an, ses rencontres, ses frustrations, ses découvertes, ses surprises, ses enchantements, ses désespérances. Cannes, son festival du film. Cannes 2006 s'achève, je peux raconter mon bref passage.
23:13 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/06/2005
Une gâchette en or


16:10 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, western, site internet | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/06/2005
La leçon de Stanley Donen

Cette obsession du rythme, cette densité de la création, ce cinéma qui est mouvement et vitesse, ce cinéma qui est l’humour et la grâce, léger comme les pas de Fred Astaire, c’est bien le sien. C’est tout ce grand cinéma hollywoodien à son meilleur, celui qui nous manque cruellement aujourd’hui. Le reste n’est qu’anecdote. Si Donen nous a parlé de ses trucs, de son métier de chorégraphe, de ses idées techniques de mise en scène, il n’a rien dit, vraiment, sur son art de cinéaste. Sauf quand il eu cette peur d’ennuyer son audience et puis, un peu pus loin quand il a dit que, si une idée pouvait passer par le cinéma, par son langage propre, c’était mieux.
Donen fait partie, et il est l’un des derniers à Hollywood, de ces cinéastes qui pensaient cinéma et qui se sont, très généralement, refusé à théoriser leur travail. Je pense à Ford, Hawks, Walsh, Minelli, Lubitch, Capra... Ils avaient des tempéraments visuels avant tout. L’image, le rythme, le mouvement, formaient l’essence de leur cinéma.
En revoyant ses comédies musicales, des plus célèbres aux plus modestes, on ressent encore cette incroyable optimisme. La mélancolie viendra après, à l’époque des comédies sophistiquées qu’il réalisera quand les studios ne feront plus de comédies musicales. Pour l’heure, comment ne pas être positif quand, à 26 ans, on réalise son premier film avec son idole (Astaire). François Truffaut disait que la scène phare de Chantons sous la pluie était la séquence la plus euphorique de l’histoire du cinéma. Comment ne pas se sentir porté sur les ailes de la danse quand on a pu faire défiler devant sa caméra Astaire, Kelly, Cyd Charisse, Audrey Hepburn, Debbie Reynolds ou Cary Grant ?
06:10 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, Stanley Donen, comédie musicale | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2005
Histoires de couples
Louis: Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Marion: Pourtant hier, tu disais que c'était une joie.
Louis: C'est une joie et une souffrance.
Marion: Je vous aime.
Louis: Je te crois.
Vivian : Speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first, see if they're front-runners or come from behind, find out what their whole card is, what makes them run.
Marlowe : Find out mine?
Vivian : I think so.
Marlowe :Go ahead.
Vivian : I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front, open up a lead, take a little breather in the backstretch, and then come home free.
Marlowe : You don't like to be rated yourself.
Vivian : I haven't met anyone yet that can do it. Any suggestions?
Marlowe : Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. You've got a touch of class, but I don't know how, how far you can go.
Vivian : A lot depends on who's in the saddle.
James Stewart de Dona Reed dans La Vie est Belle de Franck Capra
John Wayne et Angie Dickinson dans Rio Bravo de Howard Hawks
Birger Malmsten et Eva Henning, La Fontaine d'Arethuse de Igmar Bergman
Maggie Cheung et Tony Leung dans In The Mood For Love de Wong Kar-Wai
Charlie Young et Nicky Wu The Lovers de Tsui Hark
Humphrey Bogart et Elizabeth Sellars dans La Comtesse aux pieds nus de Joseph L Mankiewicz.
John Wayne et Maureen O'Hara dans L'Homme Tranquille de John Ford
Charlie Chaplin et Paulette Goddard dans Les Temps Modernes de Charlie Chaplin
Alberto Sordi et Léa Massari dans Une Vie Difficile de Dino Risi
Cary Grant et Katharine Hepburn dans Indiscretions de Georges Cuckor

Feathers: I thought you were never going to say it.
John T. Chance: Say what ?
Feathers: That you love me.
John T. Chance: I said I'd arrest you.
Feathers: It means the same thing, you know that
15:00 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, blog, théorie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2005
Sur le Bosphore



22:50 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma, photographie, salle | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2005
Westerns all'dente
11:25 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, Sergio Corbucci, Sergio Sollima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2005
La théorie du bon navet
Attention à l’importance des expressions !
Série B se réfère à un phénomène économique, celui des films de « première partie », plus courts, au budget réduit. Une série B peut être un grand film. Et dans l’absolu, on ne fait plus de série B depuis plus de 30 ans sauf John Carpenter.
Série Z ne correspond à rien, si ce n’est une façon de dire que le budget comme les intentions sont particulièrement misérables. Mais si l’on recrute de bons navets dans les séries Z, on y trouve surtout des films insignifiants, ennuyeux et simplement mal fichus.
Alors, attention, un bon navet, tout d’abord, c’est rare. Pour approcher d’une définition, je dirais que le bon navet est d’abord réjouissant et généralement pas dans le sens que le réalisateur et son équipe ont voulu lui donner. Un bon navet est souvent drôle, mais involontairement. Un bon navet ne pratique pas le second degré, puisque c’est dans le décalage entre les intentions et le résultat que le spectateur va trouver son plaisir. Un bon navet doit se prendre, un peu, au sérieux et c’est pour cela que les comédies ne donnent qu’exceptionnellement de bons navets. Une comédie est faite pour faire rire. Si elle échoue, c’est qu’elle n’est pas drôle, donc elle devient nulle et ne suscite que l’affligement.
Le bon navet relève très souvent du cinéma de genre ou cinéma d’exploitation, peplum, fantastique, western, polar… mais pas toujours. Un film ambitieux qui se plante peut donner un joli navet. Ce n’est pas non plus un problème de budget, il existe de superbes navets qui ont coûté la peau des fesses.
Bon, alors, ce navet trois étoiles ? Et bien, c’est un film dont l’un, plusieurs ou totalité des éléments constitutifs est complètement à côté de la plaque. C’est un acteur particulièrement mauvais jusqu’au risible (Brigitte Nielsen dans Red Sonja), un scénario plein de trous et de clichés (Le Pacte des Loups, pas un film fauché, hein ?), des dialogues qui laissent sans voix (Les Guerriers du Bronx, au hasard), un doublage surréaliste (Le zozotement du héros de Doc Savage Arrive !), des effets spéciaux touchants de naïveté (le Sixième Continent et ses suites), ou un peut tout ça à la fois (Godzilla contre Megalon qui est une perle).
J’insiste sur le fait qu’il est difficile de faire un bon navet, car il faut tenir la distance et ne pas perdre le spectateur susceptible de sortir en se disant qu’il perd son temps et sa vie devant une daube. Non, il faut de la constance dans le ridicule, du renouvellement dans les situations improbables et, quelque part, une certaine foi dans le cinéma. Et c’est pour cela qu’on peut aimer le bon navet. D’autant que la part de naïveté inhérente au genre peut donner d’étranges moments de poésie pure comme chez Ed Wood.
Assez de philosophie, des actes ! Quelques photos (sous copyright) pour illustrer mon propos et un lien indispensable (merci à Yohan) : www.nanarland.com
Ce site est non seulement indispensable si vous voulez tout savoir sur Max Thayer et la version turque de Star Wars, mais il est hilarant, plein d’extraits vidéo et audio, de photographies et de chroniques et même de philosophie. Un « must » comme on dit outre manche.
En anglais, donc, un autre site tout aussi fourni avec de nombreuses vidéos : www.badmovies.org
Allez-y, vous n’en reviendrez pas
13:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, navets, site internet, théories | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2005
Les aventures maritimes de Steve Zissou
Incarné par Bill Murray, Steve Zissou et son équipe sont les héros du nouveau film de Wes Anderson, réalisateur assez indépendant à qui l'on doit un premier film réalisé avec les frères Wilson : Bottle Rockett, inédit chez nous. En 1998, il se fait connaître avec l'original, Rushmore, histoire d'un étudiant atypique, avec déjà Bill Murray et La famille Tenenbaum avec, encore, Bill Murray au sein d'une distribution imposante.

Néanmoins, sa dépression latente ne l'empêchera pas de repartir une nouvelle fois à l'aventure, déterminé comme Achab à se venger du monstre aquatique, entouré de son équipe à toute épreuve parmi laquelle on compte un second germanique (Willem Dafoe), un cameraman hindou (Waris Ahluwalia), un guitariste brésilien qui joue Bowie ( Seu Jorge), deux dauphins albinos idiots et une horde de stagiaires bénévoles corvéables à merci. Pour simplifier, il se greffe un pilote qui est peut être son fils (Owen Wilson) et une journaliste enceinte (Cate Blanchett).
On l'aura compris, le film est une comédie un peu complexe. Sa ligne dramatique principale linéaire est constamment parasitée par une foule d'intrigues secondaires basées sur les rapports entre les différents personnages, rapports marqués par des interrogations telles que le rapport de filiation, la réussite, l'échec, le couple, la mort...
Je n'ai personnellement pas été tout à fait convaincu que cet ambitieux programme fonctionne. Le film n'est pas aussi drôle que l'on pouvait s'y attendre. Il fonctionne plus sur un humour décalé, proche de la bande dessinée avec de nombreuses ellipses. Le film a des ruptures de rythme parfois brutales et semble parfois chercher sa direction, à l'image de son personnage principal. Parfois, le dérapage dans la folie tombe à plat comme lors de l'évacuation musclée des pirates par Zissou, seul contre tous. Mais souvent, il se dégage en contrepartie une poésie bienvenue, les intermèdes musicaux par exemple, ou les petits animaux farfelus dessinés par Henry Selik, complice de Tim Burton, ou encore les plans séquences virtuoses du bateau, en coupe, qui rappellent ceux de la pension de jeunes filles filmée par Jerry Lewis dans Le tombeur de ces dames.
Le film emporte quand même l'adhésion, si l'on accepte son ton original, parce que c'est tout sauf un film bateau (facile !), parce qu'il est ambitieux et volontaire, parce que Wes Anderson aime faire du cinéma et que ça se voit, et enfin par l'excellence de sa distribution, visiblement motivée par l'aventure, Murray en tête, dans une prestation digne de ses grands moments.
23:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Cinéma, Wes Anderson | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/03/2005
Tire encore... si tu peux !
Barney, un métis incarné avec beaucoup de charme par Thomas Millian, organise un hold up avec une bande moitié américaine, moitié mexicaine. Au moment du partage, les Américains, laissant ressortir leurs instincts racistes, exécutent les Mexicains et s’enfuient à travers le désert. Barney s’en sort miraculeusement. Il est recueilli par deux indiens qui rappellent étonnamment celui de Dead Man de Jim Jarmush, et qui acceptent de l’aider à se venger à condition qu’il leur raconte ce qu’il a vu « de l’autre côté », lui qui a été si proche de la mort. Entre temps, la bande américaine arrive dans un village à l’ambiance très étrange, ambiance que l’on retrouvera dans High plains drifter (L’homme des hautes plaines - 1973) de Clint Eastwood, une ambiance de corruption et de dépravation assez impressionnante. A partir de là, tout le film bascule. L’intrigue brasse nombre d’éléments classiques du western italien en les décalant systématiquement, mêle des réminiscences baroques et fantastiques, tant sur le fond que dans le style.

Question de style, Se sei vivo, spara surprend tout d’abord par ses premières séquences. Le générique, porté par la musique superbe de Ivan Vandor, alterne les plans d’inspiration fantastique de Barney s’extirpant de la fosse ou l’ont jeté ses ex-associés, puis étant soigné par les deux indiens philosophes, avec des images de l’exécution, montées très rapidement (c’est carrément du Eisenstein !), contrastant par leur lumière blanche de désert à midi, avec celles du « ressuscité », nocturnes et bleutées.
Gulio Questi, le réalisateur, n’a guère fait de films, et celui-ci est son unique western. Il s’en donne à cœur joie, même si certaines scènes paraîtront un peu pâles (l’attaque du début), il se rattrape par un montage très original, jouant sur le temps (la construction en flash back du début, les ellipses radicales) et l’espace (l’exécution des Américains, la mise à mort du chef). Il excelle surtout dans l’établissement de son climat baroque, à base de jeu sur les couleurs (les ambiances du saloon, les costumes noirs et blancs des « ragazzi » et de compositions étonnantes, dans un esprit très proche du surréalisme ou de Bunuel (l’arrivée des truands américains dans la ville est typique d’étrangeté). Sans multiplier les exemples, Se sei vivo, spara est un film hypnotique, un peu déstabilisant mais toujours surprenant.

Question de fond, enfin, le film est assez virulent et, comme Il grande silenzio (Le grand silence - 1968) de Sergio Corbucci, surprendra par son ton acide, un peu cynique et un peu amoral, aux antipodes de la « morale » des westerns américains. Ici pas de fin heureuse, ici, le massacre de innocents se déroule sous les yeux impuissants de l’anti-héros dégoûté. Ce n’est pourtant pas là que le film est le plus original, les meilleurs westerns italiens (Leone, Damiani, Corbucci…) se sont toujours fait une spécialité de transposer dans cet univers si spécial des préoccupations politiques et sociales très européennes et souvent très « à gauche » (exploitation du Tiers-Monde à travers les personnages de Mexicains, dénonciation du gros capitalisme à travers les américains, réflexions sur la guerre du Vietnam, critique de l’église…). Se sei vivo, spara ne déroge pas à la règle et Barney est un parfait héros libertaire, leader à la Che Guevara d’une bande de Péons trahis par l’Occident.
22:45 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : western, cinéma, giulio questi, tomas milian | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/03/2005
Guédiguian et Mitterrand
L’une des forces du film de Robert Guédiguian est de ne pas donner de réponse, ce dont je lui suis gré. Il donne des pistes, des éléments, mais son film n’est ni un portrait à charge, ni une absolution, ni un cours d’histoire, ni une étude politique. C’est une tentative d’approcher l’homme à un moment clef de sa vie.

Il y a dans ce film quelque chose de Fordien, quelque chose de Vers sa destinée ou Lincoln n’est pas seulement Lincoln président légendaire, mais un jeune avocat de province avec les soucis, les joies et les peines d’un jeune avocat de province. Ce qui n’empêche pas le film de participer à la légende mais il lui donne un intérêt humain de premier plan.
Le Mitterrand de Guédiguian est un vieil homme au seuil de la mort et il se pose les questions de tout homme dans sa condition. Sans doute la légende est présente comme en filigrane. Comme le dit un des personnages du film, « Tu es comme les autres, tu finis par l’aimer », Guédiguian, comme tant d’autres, cède à la fascination de François Mitterrand, « dernier des grands présidents ». Mais Guédiguian reste aussi le réalisateur de l’Estaque, l’ancien communiste qui s’est interrogé dans son œuvre, depuis 1980, sur les désillusions de la classe ouvrière et l'impuissance du socialisme à changer la vie.
Il arrive à faire de son personnage historique un archétype que je rattacherais encore à Ford, à celui de La dernière fanfare, un de ses derniers films avec Spencer Tracy dans le rôle d’un politicien qui s’engage dans sa dernière élection, un homme qui n’a pas pris la mesure des changements du monde et qui meurt, lui aussi, à la fin.
Il y a beaucoup de points communs avec ce film. A commencer par le fond politique. Car si le film de Guédiguian n’est effectivement pas une analyse ou une critique politique littérale, il fait passer avec beaucoup d’intelligence une idée forte sur l’échec du socialisme incarné par Mitterrand : celle du décalage avec son époque. Arrivé peut être trop tard, il aurait perdu prise avec les grands mouvements du monde moderne. On voit constamment dans le film que Mitterrand est un homme inscrit dans l’Histoire, connaisseur de l’Histoire, lettré citant Duras, Lamartine, De Gaulle et Blum, héritier d’une époque qui n’a plus rien à voir avec le présent. Et cela, c’est encore plus vrai aujourd’hui qu’en 1995.
Quand le journaliste lui parle de mondialisation, il répond que l’Europe est en paix depuis 14 ans. Mitterrand vient d’une Europe en guerre : guerre mondiale, guerre civile, guerres coloniales. Quelles sont ses réponses pour une génération, bientôt deux, qui n’ont connu que la guerre économique ? Il n’en a pas.
La force du film, c’est de donner une forme cinématographique à cette idée. Guédiguian met en place un dispositif, comme souvent inspiré de son goût pour théâtre, où Mitterrand est isolé entre le témoin qu’il s’est choisi, le jeune journaliste (bien plus jeune que son modèle réel, Georges-Marc Benamou, et donc encore plus lointain des références du président) et quelques silhouettes : secrétaire, docteur, chauffeur, garde du corps. Guédiguian se refuse à montrer et même à nommer les autres protagonistes de ces années : vous ne verrez ni Chirac, ni Rocard, ni Jospin, ni personne. Seule Mazarine, sans doute pour la dimension humaine et inclination pour la littérature, est citée.
Mitterrand est aussi constamment inscrit dans le paysage de la France « éternelle », parcourant villes et villages symboles de siècles d’histoire. Scène inaugurale dans la cathédrale de Chartres, scène proustienne où le président parcours les gisants de rois oubliés. Scène mélancolique entre les cartons pleins de souvenirs lors du départ de l’Elysée. Scène fordienne encore dans le petit cimetière puis, plus tard, scène ultime dans l’église où il s’allonge. Il est déjà un fantôme quand il monte l’escalier de pierre, déjà avec ses morts comme Truffaut dans La Chambre Verte.
Les livres enfin, irriguent tout le film. Mitterrand amoureux des livres, c’est le Mitterrand le plus sympathique. Les livres sont de (presque) tous les plans. Pas les livres produits à la chaîne d’aujourd’hui, écrits par ce que l’on ose appeler un écrivain (dont le journaliste fait partie, d’une certaine façon). Mais les livres avec un grand L. Cervantès, Duras, Lamartine, Hugo, Valéry, Lévi, j’en oublie sûrement. Des livres que l’on caresse comme des femmes, des livres que l’on possède, des livres compagnons, des livres qui sont, comme chez Truffaut, notre plus bel héritage.
L’attachement à cette culture de la littérature est un fossé de plus entre Mitterrand et les générations de l’image et de l’ordinateur. Elle est pourtant une ultime possibilité de communication : maladroite lors de l’épisode du livre choisi pour l’anniversaire, porteuse d’espoir lorsque le journaliste fait le rencontre d’une… bibliothécaire. On a là de nouveau un très beau motif de cinéma, enchâssé dans la trame du film et riche de signification.
Symboliquement, Guédiguian met en avant l’affaire Bousquet comme révélatrice de ce fossé. A l’indignation du jeune journaliste qui « n’avale » pas les relations ambiguës du président avec le régime de Vichy, répond l’obstination du vieil homme : « Vichy n’était pas la France », l’excuse de sa jeunesse et d’un contexte plus que troublé. Guédiguian ne tranche pas, n’accuse ni n’excuse, mais laisse plusieurs personnages (la vieille résistante, la jeune bibliothécaire) faire la part des choses.
Là encore, le personnage du journaliste, joué avec beaucoup de sobriété par Jalil Lespert, incarne les doutes et les questionnements des nouvelles générations. C’est sans doute pourquoi il éprouve le besoin d’aller visiter Vichy pour se rendre compte qu’il n’y a rien à voir, rien que puisse apprendre le Vichy de 1995 sur celui de la collaboration. Le « tu n’as rien vu à … » de Duras s’applique à tous ces lieux que nous avons chargés d’Histoire mais qui, par eux même sont incapables de nous parler aujourd’hui.

Pour terminer, la question qui s’est posée quand on a su que ce serait le cinéaste de l’Estaque qui porterait ce sujet à l’écran, c’est comment allait-il passer d’un cinéma du soleil à un cinéma de la grisaille. Réponse : en beauté. Beauté de l’image de Renato Berta revendiquée par une tirade pleine de chaleur de Bouquet-Mitterrand en forme d’ode au gris (entendre le noir et blanc cinématographique). Le film est une succession de noir et blanc en couleur, du sable des plages du nord aux ardoises des villages, des ors passés de l’Elysée au fameux manteau et chapeau présidentiels, des gris infinis de Paris aux gris illimités des champs de province.
En relevant le défi d’un sujet à priori anti-cinématographique et éloigné de son univers marseillais, Robert Guédiguian s’en sort avec talent et honneurs. Comme quoi il faut se méfier des a priori. Ce projet qui pouvait lui sembler si étranger, il en a fait, d’une certaine façon, l’un de ses films les plus personnels de part les réflexions qu’il développe, synthétisant et prolongeant celles de ses plus belles réussites ; et l’un de ses films les plus réussis de part sa grande maîtrise de son art : celui du cinéma.
Photographies : © Pathé Distribution
19:40 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma, Robert Guédiguian | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2005
Assassination tango
Il y joue un tueur à gage dont on ne saura jamais s'il travaille pour une agence occulte ou pour le crime organisé. Toujours est-il que c'est l'un de ces tueurs qui a une éthique de son métier (un peu comme le personnage d'Eastwood dans LA SANCTION). Il vit avec une femme qui a une petite fille. Le tueur et la fillette s'adorent. Le tueur est aussi danseur de salon.
Quand on l'envoie pour une mission à Buenos Aires, il ne manque pas de visiter les salles de danse et rencontre Manuela, superbe danseuse dont le tango le fascine. Bien sûr, il y a un grain de sable dans la mission et notre héros aura tout le temps de s'initier à la sensualité technique du tango argentin. Manuela ne le trouve pas trop vieux et elle a, elle aussi, une petite fille.

Je n'en dirais pas plus. Le film est d'une facture originale, d'un rytme inhabituel pour le cinéma américain moderne, sachant prendre son temps, mais soumis à de vives accélérations, un peu comme un morceau de tango, quoi. Et Luciana Pedraza est incroyablement belle.
Le DVD
19:10 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma, Robert Duvall | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2005
Musique à l'italienne

Passez visiter leur site : CAM Original Soundtrack il y a plein d’extraits à écouter.
18:00 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, musique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/01/2005
Courts métrages

Et puis, le court, c'est riche. Voir dix films en deux heures, c'est chouette. Mis à part les deux sélections, française et internationale, il y a du numérique, de l'animation, des rétropectives (Truffaut l'an dernier, très belle), des programmes spéciaux, parfois incroyables, bref, de quoi s'occuper toute la journée et la soirée. Ensuite, place aux afters...
Clermont existe depuis plus de vingt ans et ils ont fait énormément pour la reconnaissance du court. Malgré les critiques, comme la polémique de l'an dernier, cela reste le meilleur endroit pour découvrir les auteurs à venir du monde entier. Les programmations ont lieu dans toute la ville, toutes les salles, les amphis des facultés, les cinémas du centre et de la périphérie. C'est la fête.
Et puis, les gens sont agréables et compensent en chaleur humaine le froid qui peut être, en janvier, redoutable.
Les dates de cette année : 28 janvier - 5 février
le site
23:20 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, court métrage, festival, Clermont Ferrand | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/01/2005
Affiche
Je trouve que cela relève d’un certain culot. Pourquoi ? Parce que, pour se limiter au cinéma, je ne me souviens pas avoir vu des affiches similaires pour dénoncer les atteintes au statut des intermittents du spectacle, autrement plus graves en ce qui concerne la création. Parce que je ne me souviens pas avoir vu d’affiches dénoncer le désengagement de Canal+ dans le financement du cinéma. Parce que je ne me souviens de rien pour alerter le public du danger des multiplexes, ces hypermarchés du film. Parce que rien sur la défense de l’exception culturelle.
C’est culotté et hypocrite, insultant pour les spectateurs et assez malvenu. Pourquoi ? Parce que, en ce début d’année, on nous annonce une année cinéma exceptionnelle. La meilleure depuis 1987 ! Parce que les ventes de DVD explosent et, comme le fait remarquer Antoine de Baecque sur son « chat » de Libération, les DVD donnent envie aux spectateurs de retrouver le chemin des salles. Etonnant non ? Parce qu’il ne faut pas oublier, même si les films qui fonctionnent le mieux sont des films commerciaux, que le système d’aide français fait qu’automatiquement, les entrées en salle induiront une augmentation des aides aux films français, quelqu’ils soient.
Alors, ça veut dire quoi cette façon de culpabiliser les spectateurs ? Qu’est-ce que c’est que cette façon d’accueillir le public ?
Bien sûr, d’accord pour les pirates qui filment en salle (quoi qu’on les voit rarement filmer le dernier Kiarostami !) OK pour ceux qui revendent des copies, ce n’est pas élégant… Mais pour le reste, il est largement temps de redéfinir la notion de copie privée et cesser de vouloir gratter le beurre, l’argent du beurre et le sourire du cinéphile. Les majors du cinéma se foutent de nous quand ils revendent à prix d’or leurs catalogues amortis depuis 40 ans. Surtout quand il n’y a aucun travail éditorial autour (et je salue ici les éditions de Wild Side, HK vidéo, MK2, là au moins, il y a une véritable valeur ajoutée).
Que les salles se prêtent à cette pitrerie est désolant quand on sait que leur malheur est venu de la télévision et de sa démission en matière de propagation de la culture cinématographique. Une petite affiche sur le sujet, peut être ?
Personnellement, je ne charge pas de films. Ce qui m’intéresse dans le DVD, ce sont les possibilités de la VO et du sous titrage. Et puis, surtout, je n’ai pas de télévision, je me souviens de la phrase de Godard (qui d’autre !) qui dit à peu près que quand on a vu un film à la télévision, c’est comme si on disait avoir vu un tableau alors que l’on n’en a vu qu’une mauvaise photocopie. Et oui, le DVD, comme le CD, ce ne sont que des copies de copies des œuvres originales. Ben merde lors !
Au lieu de hurler au pirate, il serait plus normal de rappeler que l’endroit pour découvrir, voir et revoir un film, c’est la salle. Qu’il n’y a pas assez de salles et pas assez de programmations. Que ce n’est pas en inondant de milliers de copies les écrans avec le dernier « blockbuster » que l’on va défendre le cinéma. Et que celui-ci, si on le pirate, ce n’est vraiment pas bien grave.
« A la télévision, on baisse la tête pour voir le film, au cinéma, on la lève ».
23:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, droits | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/11/2004
Génériques
11:00 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, site | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
17/11/2004
Information
Ca se passe au cinéma Mercury, 16 place Garibaldi à Nice. Comme d'habitude, le film sera précédé d'une présentation et suivi d'un débat (que l'on espère vif, mais ça dépend des spectateurs !).
Pour en savoir plus sur les organisateurs : le site de CSF
09:30 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, Walter Salles, CSF | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/11/2004
Cap à l'ouest !

Je le sentais bien. Le nouveau film de Philippe Lioret est une réussite. Tout ce que j'avais apprécié dans son précédent opus, Mademoiselle, je l'ai retrouvé dans L'équipier. A commencer par Sandrine Bonnaire qui retrouve un rôle de femme simple bouleversée par une passion aussi violente qu'inattendue. L'ile bretonne de L'équipier est très proche du fameux pont de Madison mis en scène par Clint Eastwood. Les amateurs de beaux mélodrames s'y retrouveront sans peine. Lioret a le cinéma classique, l'art de camper une atmosphère, de filmer un regard dérobé, un geste en suspens, quelque chose de l'art de Truffaut et sa sensibilité pour les personnages aux amours sans espoir.
Il a également un certain talent pour évoquer les activités professionnelles viriles façon Hawks. Ses gardiens de phare portent avec eux une façon de vivre et une certaine philosophie du "métier". Ils sont les frères des chasseurs d'Hatari !, des aviateurs de Seuls les anges ont des ailes, avec le caractère bien trempé des bretons des années 60 !
Philippe Torreton et Grégori Derangère développent une histoire d'amitié aussi passionnée et complexe que la relation amoureuse qui se noue entre Derangère et Bonnaire. On pourra trouver certains des ressorts classiques, mais ça fonctionne bien.
S'il y a un film français à découvrir en ce moment, c'est bien celui là.
Pour finir, une petite information, pour les amateurs de musique de film, ce site en anglais très complet : www.soundtrackcollector.com
Allez, à la prochaine...
20:55 Publié dans Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Cinéma, Philippe Lioret, cinéma français | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |