03/09/2008
Scène d'ouverture






The long voyage home, captures DVD Warner
11:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/09/2008
Le long voyage
John Ford était un homme de passions et celle de la mer ne le cédait en rien à celle du cinéma. La légende veut qu'il ait tenté d'embarquer, jeune adolescent, puis que sa mauvaise vue lui ait fermé les portes d'une carrière dans la Marine. Ce n'était pas cela qui allait l'arrêter et Ford a construit sa carrière de marin à sa façon, jusqu'à obtenir un grade équivalent à amiral (ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas un expert en ces matières). En juin 1934, devenu un metteur en scène reconnu et fortuné, il achète un ketch de 32 mètre, le Faith qu'il rebaptise l'Araner en hommage aux îles d'Aran. Ce sera son second foyer, sa base opérationnelle et son refuge. Il met le bateau à la disposition de la Marine et effectue des missions de reconnaissance et d'espionnage avant l'entrée en guerre des États Unis fin 1941. C'est sur l'Araner qu'il prépare certains de ses films, recevant scénaristes et acteurs. C'est sur l'Araner qu'il fait lire à John Wayne l'histoire de Stagecoach (La chevauchée fantastique) en 1937 et qu'il lui propose de façon détournée de tenir le rôle qui en fera une star. C'est sur l'Araner qu'il part en croisière après les tournages, se détendre et picoler avec ses amis, laissant ses films aux mains des monteurs, confiant en sa technique de tournage qui ne laisse que peu de latitude aux producteurs pour tripoter ses oeuvres. John Ford ne tourne que le strict nécessaire. C'est l'Araner, enfin, qu'il filme avec tendresse sous le soleil du Pacifique dans Donovan's reef (La taverne de l'irlandais) en 1963, l'un de ses derniers films.

La mer, la mer toujours recommencée, est au coeur de son oeuvre. Men without women (1930), Submarine patrol (Patrouille en mer – 1938), They where expandable (Les sacrifiés – 1945), Eagle has wings (L'aigle vole au soleil – 1957), Mr Roberts (Permission jusqu'à l'aube – 1955), j'en oublie sûrement. Le plus beau, le plus intense, le plus personnel aussi sans doute est The long voyage home (Les hommes de la mer), tourné en 1940 à partir de quatre pièces du dramaturge irlandais Eugene O'Neill. La séquence d'ouverture est franchement étonnante chez Ford, outre le tour de force narratif et technique. Le second plan nous montre plusieurs femmes langoureusement adossées à des palmiers, sur le rivage d'une île du Pacifique. Celle au premier plan fume doucement tout en se caressant l'épaule. La lumière du soir scintille et l'image dégage une sensualité directe rare chez un cinéaste d'ordinaire pudique. Au loin, le cargo Glencairn est mouillé dans la baie et son équipage ressent les présences féminines. Yank (Ward Bond) fait des ronds de fumée, Ole (John Wayne juvénile juste après Stagecoach) s'approche et ses mouvements sont presque dansés. Il se retire, un autre marin arrive. Leurs gestes et leurs regards disent leur désir. On ressent la chaleur et la langueur. Bientôt les femmes monteront à bord avec des fruits et de l'alcool. Il n'y aura quasiment aucune parole. Juste des sons, des images et le sens qu'elles prennent l'une derrière l'autre. Ce que j'appelle du pur cinéma.
Si j'aime autant celui de John Ford, c'est pour des séquences comme celle-ci, pour un film comme celui-ci. Difficile de ne pas citer tous les autres moments du film, ces morceaux de la vie de l'équipage du Glencairn, les actes et les rêves de ces hommes embarqués en mer, allant de port en port, parcourant le globe avec l'espoir de mettre un jour pied à terre, pour de bon, pour toujours, comme Ole, le suédois qui ne pense qu'à s'acheter une ferme et retourner voir sa mère. Mais ces hommes qui restent ballottés par les vagues du destin, flambent leur payes en beuveries et remontent au matin sur le pont du cargo, résignés jusqu'à la fin du prochain voyage, incapables secrètement de renoncer à la chaleur de leur camaraderie vraie, à cette vie errante et libre. Pour raconter leur histoire, pour nous faire partager cette vie, Ford crée un poème visuel dont chaque image est composée comme si elle était la plus importante du film. Il y a la fuite de Smitty sur les docks de New-York, la tempête, la mort de Yank, le transport de dynamite vers l'Angleterre en guerre, le danger, la monotonie de la vie en cabine, l'homme que l'on croit vendu aux nazis, Ole que l'on finit par mettre sur un bateau pour chez lui, et la scène finale, l'une des plus bouleversante de Ford, jusqu'à celle de The searchers (La prisonnière du désert) 16 ans plus tard.

The long voyage home a été tourné au coeur du premier âge d'or de Ford, entre Grapes of Wrath (Les raisins de la colère) tourné aussi en 1940 et Tobacco Road (La route du tabac) adaptation du roman d'Erskine Caldwell. A l'époque, entre 1938 et 1941, Ford fait quasiment un film tous les six mois et donne quelques unes de ses oeuvres majeures. Comme si la somme d'expériences et de créativité accumulée depuis 1917 et ses débuts donnait d'un coup toute sa mesure. The long voyage home est le plus atypique, parce qu'il retrouve les conditions particulières de production de The informer (Le mouchard) tourné en 1935 : petite production indépendante (avec son associé Walter Wanger) au coeur du système, petit budget, sujet « irlandais » qui le touche particulièrement, maximum de liberté et collaborateurs fidèles ayant la plus haute idée de leur art. C'est Dudley Nichols qui signe l'adaptation des pièces de O'Neill. On a pu reprocher à Nichols d'avoir entraîné Ford dans l'impasse artistique de The fugitive (Dieu est mort - 1947), mais il aura contribué plus que d'autres à faire accepter à Ford sa part d'artiste sensible en collaborant sur The informer, Steamboat round the bend, ou encore Stagecoach, jalons essentiels de l'oeuvre fordienne. A la photographie, on retrouve le grand chef opérateur qu'était Gregg Toland qui signera l'année suivante les images de Citizen Kane d'Orson Welles. Son travail ici est largement équivalent tant chaque plan est composé avec soin, tant la lumière est travaillée avec amour, tant on sent régner la liberté de création. Ford explique qu'ils se sont plu à briser certaines règles, comme filmer directement une source lumineuse, comme balancer des paquets d'eau sur l'objectif, comme toutes les expérimentations sur la profondeur de champ. Toutes choses qui relativisent sérieusement le côté « novateur » du film de Welles, malgré toute l'admiration que j'ai pour lui. La partition de Richard Hageman, compositeur peu connu mais essentiel chez Ford, développe un thème nostalgique de toute beauté, réservant la part belle aux musiques populaires qui plaisaient tant au réalisateur (Irish washerwoman, When Irish Eyes Are Smiling, Blow the man down). Du côté des acteurs, c'est le festival. La Ford stock company est quasiment au complet. Barry Fitzgerald y compose une nouvelle fois un petit personnage excité et attachant, Cocky, Arthur Shield donne une touche de douceur mélancolique à Donkeyman, Thomas Mitchell apporte à Drisck le côté jovial et bourru que j'avais aimé dans le rôle du docteur alcoolique de Stagecoach, John Qualen, petit homme au nez pointu, est Axel Swanson ou la fragilité, Ward Bond est Yank, la solidité, sentiment sur lequel joue Ford lors de la si belle scène de sa mort. Et puis il y a John Wayne, étonnant dans un rôle qui se fond dans la tapisserie du groupe, jeune, naïf, il n'est pas le « big guy », le chef, et ne se bat presque pas. Wayne avait appris l'accent suédois avec sa compagne du moment et sa composition de Ole reste l'une de ses plus originale. Dans cet univers d'hommes, il faut noter la prestation sensible de Mildred Natwick qui jouait pour Ford son premier rôle. Il y en aura bien d'autres. Ici, elle est une prostituée au grand coeur et a un joli moment avec Wayne. Les habitués reconnaîtront aussi les visages de Jack Pennick et de Danny Bozague. Ian Hunter enfin, joue un personnage décalé par rapport au groupe, Smitty, et comme par hasard, il ne fait pas partie de la « famille ». Ce qui ne veut pas dire que ça se soit mal passé avec le réalisateur, cela donne juste une indication sur la façon dont Ford pouvait faire fonctionner une distribution.

The long voyage home est donc un film emminement fordien, atteignant à cet équilibre rare et délicat entre émotion, ambition artistique et simplicité. Du même registre que Young Mr Lincoln (Vers sa destinée - 1939) ou Wagonmasters (Le convoi des braves- 1950). Ford nous fait pénétrer de l'intérieur la vie de ces marins, sans jamais donner le pas à tel ou tel. Il filme un groupe, une famille comme il en a le secret, et nous amène à en faire partie, en compagnie d'hommes de chair et de sang qui existent bien au delà du film. Il y exprime un humanisme lucide, parfois amer mais bienveillant quand même. A un moment, Smitty est soupçonné d'être un agent nazi et de faire des signaux pour les sous-marins qui torpillent les cargos. C'est effectivement un homme qui porte un secret et ses compagnons cherchent à le démasquer. Ils manquent de le lyncher, comme la foule dans Young Mr Lincoln. Dans la plupart des cas, on aurait montré le meurtre, la honte éventuelle et associé un discours sur la sombre nature humaine. Pas chez Ford. Le secret de Smitty est révélé mais comme Lincoln faisait entendre raison aux lyncheurs, les marins du Glencairn sont capables de comprendre, de penser et d'apprendre. Et Ford filme la honte, certes, mais aussi la réconciliation. Et la Loi qui l'emporte sur le Chaos. C'est cela, l'humanisme de Ford. A la fin du film, Ole a été mis par ses compagnons dans un bateau en route pour son pays natal et sa ferme. Sur le pont du Glencairn, Donkeyman voit revenir ses camarades, le pas lourd, leur destin de marins errants pesant sur les épaules. Cocky arrive entre deux policiers. Chacun sait ce que l'autre ressent. Pas un mot jusqu'à ce que Donkeyman remarque l'absence de Drisck. En sauvant la mise à Ole, celui-ci a été assommé, et embarqué de force dans un autre cargo. « He is gone » lance avec rage Swanson, « Il est partit », la même expression qu'il avait utilisée lors de la mort de Yank. Ce que Swanson ne sait pas, c'est que Donkeyman tient le journal du matin qui indique que le cargo de Drisck a été torpillé. Pas de survivant. Mourir, partir, quitter le groupe, c'est pareil. Donkeyman jette le journal à l'eau sur les accents tristes de la musique de Hageman. Le Glencairn va repartir. Mais il ne faudrait pas rester sur le sort heureux de Ole, ni sur celui tragique de Drisck. The long voyage home nous laisse sur le sentiment amer et doux du destin sans cesse recommencé des hommes de la mer.
Chez Christophe
Sur Wikipedia
Par Damien Canon (en anglais)
Un extrait
Perspective fordienne sur Six martinis
Photographies : capture DVD Warner et site Carteles
09:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/09/2008
Profondeur de champ









De haut en bas : The long Voyage home (Les hommes de la mer - 1940) de John Ford ; Il figlio di Spartacus (Le fils de Spartacus - 1963) de Sergio Corbucci et Paper Moon (La barbe à papa - 1973) de Peter Bogdanovich. Captures DVD Warner, Opening et Paramount.
11:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, sergio corbucci, peter bogdanovich | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
27/08/2008
Ford mercenaire
Le système des studios, à Hollywood comme à Hong-Kong ou Rome avait du bon en cela qu'il permettait aux metteurs en scène d'enchaîner les films dans un environnement créatif, infrastructures, auteurs, acteurs et techniciens sous contrat, d'une grande disponibilité. John Ford n'aurait sans doute pas eu une carrière aussi riche s'il n'avait évolué dans ce système avec une relative aisance. Bien sûr, il y avait un prix à payer et on pourra trouver ce prix élevé. Certains ne l'on jamais accepté.
Four men and a prayer (Quatre hommes et une prière), tourné par Ford en 1938 est un bel exemple de ce prix. En l'occurrence, ce film d'aventures exotiques fait pour la 20th Century Fox de Darryl F. Zanuck faisait partie des conditions mises par le studio à Young Mr Lincoln (Vers sa destinée) puis Grapes of wrath (Les raisins de la colère). Dans les années 30, Ford se cherche un peu. Quoique devenu un metteur en scène respecté, il enchaîne les expériences avec divers studios (Goldwyn, RKO, Fox) tout en visant toujours plus d'indépendance. Il alterne productions d'envergure dans des genres très divers et films plus modestes dans lesquels, plus autonome, il développe son style propre. C'est dans cette catégorie que l'on peu placer la trilogie avec Will Rogers et The informer (Le mouchard) qui lui vaudra, Dieu existerait donc, son premier oscar. Il aura sans doute fallu ces dix années d'expériences, de combats, d'échecs, de recherche, de ruses et de succès pour aboutir à ce premier âge d'or entre 1939 et 1941 qui le voit passer d'un grand film à un autre avec une aisance belle à pleurer.
Mais nous n'en sommes pas là. Four men and a prayer est un film méprisé dans sa carrière, Ford lui-même n'ayant rien eu à en dire sinon qu'il n'aimait rien dedans. Peu connu donc et, il faut bien le dire, n'ayant rien d'une perle rare. Pourtant, l'amateur acharné se fera un devoir de l'aborder par le bon bout de la raison et de rechercher les touches fordiennes éparses. Ce faisant, il aura le plaisir de découvrir un film distrayant, un peu vieillot mais sans plus, finalement agréable et pas indigne quoique mineur.

L'histoire. Oui, l'histoire à laquelle participa, sans doute du bout de la machine à écrire William Faulkner. Quatre hommes, quatre frères, et une prière donc, celle faite à la mémoire de leur père injustement condamné puis assassiné. Un serment plutôt, laver l'honneur familial et débusquer les coupables. Pourquoi pas ? Nous sommes dans le genre balisé des aventures exotiques d'avant guerre. Costumes blancs toujours impeccables, casques coloniaux, Indes, Égypte et Amérique du Sud d'opérette. Un univers entre Indiana Jones, les lanciers du Bengale et Tintin. Avec en prime une belle héroïne, piquante Loretta Young, qui traîne ses robes vaporeuses de comédie musicale aux quatre coins de la planète, entre massacre à la mitrailleuse et croisière sur l'Amazone. Tout est dit. L'histoire est abracadabrante et relâchée. Pas intéressé, Ford ne cherche pas, comme aurait pu le faire Hitchcock, à s'amuser avec et à bâtir de grandes scènes à coup de style. Le film manque cruellement de tension, de suspense, du souffle de l'aventure telle qu'on la trouve chez Hathaway ou Stevens pour rester dans le genre. Il manque aussi de personnalités fortes. La distribution des quatre frères est bancale. Georges Sanders est sous employé, Richard Greene et William Henry sont sans relief. Reste David Niven, moustache frémissante, qui apporte un peu de fantaisie dans le tout. Signe d'intérêt qui ne trompe pas, c'est lui qui sera la tête de turc de Ford durant le tournage. C'est donc Loretta Young qui emporte le morceau avec Miss Lynn Cherrington, héroïne assez moderne, déterminée et sensuelle.
Alors, ces touches fordiennes ? Dans les seconds rôles pour commencer. Ce film est la seconde collaboration entre Ford et Barry F. Fitzgerald, venu de l'Abbey Theater de Dublin et qui sera l'un de piliers de la Ford stock company. Il joue ici un sous officier irlandais dans l'épisode indien, cabotinant tant et plus, déclenchant une bagarre dans une taverne dans la plus pure tradition de cet humour haut en couleur affectionné par le réalisateur. Il faut voir Fitzgerald pousser son étrange cri de guerre. Certains seront rétifs à ce genre de scène. Pas moi. Dans le registre savoureux, on retrouve le magnifique John Carradine, ici en officier sud américain au costume impeccable, cape blanche, onctuosité et classe. Il commande l'exécution d'un autre général piégé, Torres, pour lequel il éprouve visiblement de l'estime. Carradine offre à son malheureux collègue un verre, puis une cigarette qu'il refuse « Vous savez que je ne fume pas ». « On nous regarde » insiste Carradine, désignant le peloton d'exécution. Torres accepte « Je vous remercie de vos prévenances », il tousse, refuse le bandeau puis tombe sous les balles. La scène est superbe, alliant une tonalité parodique à une véritable émotion. La situation étant à la fois incongrue, décalée, et véritablement dramatique. On verra également Berton Churchill en homme d'affaire peu regardant (il vend des armes), répétition peut être de son rôle de banquier véreux dans Stagecoach.

La partie la plus intéressante du film reste cet épisode Sud Américain. Juste avant l'exécution de Torres, nous l'avons suivi avec Miss Lynn Cherrington alors qu'il rejoignait ses partisans dans un entrepôt où l'on venait de leur livrer des armes. Outre l'atmosphère soignée, Ford a une façon saisissante de filmer ce petit peuple. Une série de portraits, fixes et muets, des visages, des attitudes, une dignité. On retrouve cette façon de faire dans sa façon de filmer les indiens authentiques (ses figurants Navajo) dès Stagecoach. J'ai toujours trouvé qu'il se détachait de ces plans une plus grande humanité, un plus profond respect, que dans tous les personnages fabriqués et joués par des non indiens comme la distribution hispanique de Cheyenne autumn (Les cheyennes). C'est aussi sa façon de filmer les paysans dans Grapes of wrath. Curieusement, je retrouve ça dans certains westerns italiens, avec leur goût des visages et de faire passer le sentiment d'un peuple comme dans par exemple Quien sabe de Damiano Damiani (voir ici). Cette belle séquence prend une dimension supplémentaire après l'exécution. Les révolutionnaires sortent en armes de l'entrepôt et s'engagent dans un escalier. Mais face à eux, l'armée prend position. Leurs armes ne fonctionnent pas. Ils sont trahis et fusillés en masse, à la mitrailleuse. Là, ce sont les images de Giu la testa ! (Il était une fois la révolution - 1971) qui me sont revenues et j'imagine assez que Léone pouvait connaitre ce film. La scène surprend par sa violence sèche, directe, et son ombre se répercute sur le reste du film. Comme si Ford, qui pensait peut être aux guerres d'Irlande et d'Espagne, signifiait que derrière l'aventure fantaisiste, il y avait un réel bien dramatique.

Le DVD
Photographies : capture DVD Opening
Un article de quelqu'un qui a été marqué par les mêmes scènes que moi (en anglais avec des captures plus nombreuses)
22:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : john ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/04/2008
Chez les normands
Dans un tout autre registre, l'équipe du Lux renouvelle une intrigante expérience. Ils avaient diffusé en 2000 simultanément, c'est à dire côte à côte sur le même écran, les deux versions de Psychose, celle de Hitchcock et celle de Van Sant. Rebelote avec les deux versions de Funny games, l'autrichienne et l'US toutes deux de Michael Haneke. L'évènement aura lieu le mercredi 7 mai à 21h00.
23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford, michael haneke, lux | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
15/03/2008
A la recherche de John Ford
Joseph McBride écrit dans A la recherche de John Ford (Editions Institut Lumière – Actes Sud) que la genèse de ce livre remonte à 1971. Cinéphile passionné par cette oeuvre immense, il organise des projections dès l'université avant de devenir avec Peter Bogdanovich l'un des critiques clefs de la réévaluation du cinéaste au début des années 70. Il rencontrera le maître (« Vous n'avez rien à faire de plus excitant » lui dira Ford pour commencer), ses collaborateurs, sa famille et se rendra sur la terre de ses ancêtres. Poussé par le temps qui efface petit à petit cette génération, naît alors l'ambition d'un livre somme, vaste comme les étendues de Monument Valley, qui embrasse l'homme et l'oeuvre.
Aujourd'hui, le livre existe, à la mesure de cette ambition. Un pavé comme on dit, de plus de mille pages sur papier bible. Un somme, oui, de témoignages, de documents, de recherches, de recoupements. Un travail de détective, d'historien, de critique et d'amoureux qui force l'admiration par son ampleur et sa précision. Et ce qui ne gâte rien, ça se lit facilement, avec voracité même pour peu que l'on partage avec l'auteur cet amour de la poésie fordienne et la fascination pour son mystère.
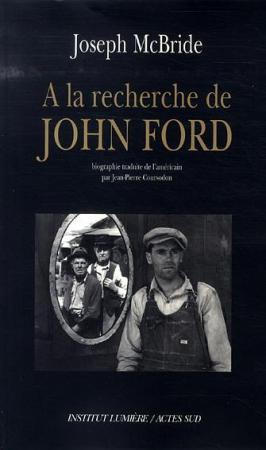
A la recherche de John Ford se situe dans la ligné des ouvrages de Donald Spoto sur Alfred Hitchcock, de Todd McCarthy sur Howard Hawks ou encore de Serge Toubiana et Antoine De Baecque sur François Truffaut. Il cherche à pénétrer l'homme en profondeur pour éclairer son oeuvre. Le titre choisi par McBride est significatif. Il existe une énigme John Ford et il cherche à la percer. Mais Ford est un morceau plus coriace que ses collègues. Hawks était un aristocrate qui s'épanouissait dans l'action (Faire des films, de la moto, de l'avion), Truffaut et Hitchcock étaient obsédés par les femmes et le cinéma de façon exclusive. Ford c'est une autre paire de manches et, dès le milieu du livre, j'ai eu le sentiment que McBride n'arrivait pas, ne toucherait pas à son but. Comme le personnage joué par John Wayne à la fin de The searchers (La prisonnière du désert), il réunit les morceaux mais reste sur le seuil. A plusieurs reprises, il avoue ses difficultés à résoudre les contradictions fordiennes. Son abondance de sources et sa précision ne font que rendre les choses encore plus obscures.
Par exemple sur l'attitude du cinéaste durant le maccarthysme et la liste noire. Dans un long chapitre, nous avons côte à côte sa fameuse déclaration courageuse où il s'oppose à Cecil B. DeMille, et la lettre admirative qu'il lui envoie le lendemain, son amitié pour Wayne et Ward Bond, très engagés dans le combat anticommuniste, couplé à sa façon de leur faire jouer des « libéraux » (Wayne dans Fort Apache) ou des personnages symboles de tolérance pour Bond. Il y a ses emportements contre le sénateur Mac Carthy (« Je ne voudrais même pas rencontrer cet homme dans un bordel ») et une lettre ou il accuse John Huston de communisme. Il y a ses dérobades, des aveux d'impuissance, et puis sa façon de faire retirer son amie Anna Lee de la liste noire d'un simple coup de fil. Il y a des zones d'ombres, le goût du secret, l'art du mensonge, de l'humour douteux. Impossible de s'y retrouver là-dedans.
Et McBride parfois s'y enferre. Il fait à mon sens deux erreurs. La première est de vouloir lire les positions complexes de Ford à la lumière de critères actuels, notamment de ce que l'on appelle le « politiquement correct ». C'est flagrant dans l'étude de la façon dont Ford aborde les minorités (indiens, noirs). D'abord parce que Ford raisonne en termes d'être humain ou de groupe social (la famille, la garnison, la tribu) plutôt qu'en termes nationaux, politiques ou ethniques. Ce qui l'amène à privilégier tel ou tel point de vue selon le cas et, par exemple, exalter les buffalo soldiers noirs sur le dos des apaches, ou passer alternativement pour les indiens d'une vision généreuse au cliché des brutes sanguinaires. Un film comme The searchers est ainsi un monument d'ambiguïté pouvant susciter les lectures les plus diverses. Et Ford l'a sans doute voulu comme ça.
L'autre erreur me semble être de ne pas suffisamment faire la part de l'humour fordien. Rien que dans ses films, son sens de l'humour irlandais ne fait toujours pas l'unanimité et donne prise à ses plus dures critiques. En lisant la lettre à DeMille, par exemple, j'ai beaucoup de mal à la trouver sérieuse. Je peux me tromper, mais j'y vois de l'ironie. A plusieurs reprises, je pensais à la phrase de Desproges : «On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et puis, il faut avouer que Ford lui-même n'a jamais simplifié les choses. Il a toujours aimé avancer masqué. Il parlait peu et on ne compte plus les répliques déroutantes pour ses plus fidèles admirateurs. Pétri de contradictions, il semble avoir cultivé cet aspect de sa personnalité pour protéger une sensibilité à vif qu'il estimait dangereuse au sein du système dans lequel il travaillait. Il préférait la laisser filtrer dans ses films. Ses films sont l'expression d'un idéal mais sa vie, pour riche qu'elle fut, en était loin. Pour lui sans doute l'oeuvre devait passer avant l'homme, une oeuvre dont McBride écrit justement, presque à regret, que sa complexité permet à chacun de trouver ce qu'il est venu chercher. Ce qui fait de la recherche de John Ford une recherche sur soi-même.
D'un point de vue biographique, le livre est une réussite. Toute la première partie sur son enfance dans le Maine et son adolescence est un puissant portrait de l'immigration irlandaise au début du siècle (et je comprends la fascination de Martin Scorcese pour Ford). Toute l'histoire sur ses débuts dans le Hollywood naissant est passionnant, éclairant surtout sur la relation complexe (tiens) qu'il entretenait avec son frère Francis. C'est Francis qui le fit venir et le format, Francis qui était alors un metteur en scène coté et dont la carrière dégringola au début des années 20. Par la suite, les évènements sont plus connus et l'on retrouve les grands passages de la légende, de la découverte de Wayne à la brouille avec Fonda, de son implication dans la seconde guerre mondiale à ses relations avec les producteurs. Une découverte pour moi, sa liaison (complexe encore) avec Katharine Hepburn en 1936/1937.
D'un point de vue critique, je suis plus mitigé. L'essentiel de l'oeuvre muette étant perdue, la tache reste ardue. McBride cite volontiers ses collègues et se situe clairement dans le camp de ceux qui estiment assez haut la fin de carrière de Ford, à l'inverse de Lindsay Anderson par exemple. Pas de grosse surprise mis à part les pages enflammées sur Pilgrimage (Deux femmes – 1932) que l'auteur tient en très haute estime. Un film que je dois découvrir toutes affaires cessantes. Il y a de très belles pages aussi sur How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941) que j'ai eu envie de revoir illico, The quiet man (L'homme tranquille – 1952), Fort Apache (Le massacre de fort Apache – 1948) et The searchers(La prisonnière du désert– 1956). Peu d'originalité dans l'approche de films moins estimés mais estimables comme Mogambo(1953) ou The horse soldiers(Les cavaliers– 1959). Je partage aussi moins ses critiques sur les prestations de Victor McLaglen dans The informer(Le mouchard– 1935) et de Jane Darwell dans Grapes of warth(Les raisins de la colère– 1940). Passé les contorsions sur tel ou tel aspect politique de l'oeuvre, j'ai surtout été surpris sur le peu de cas que fait McBride de She wore a yellow ribbon (La charge héroïque– 1949). La beauté du film est reconnue, mais McBride déplore le peu d'action. « Scénario médiocre », le livre m'en est tombé des mains. Comme si la délicate tapisserie de ce film n'était pas du même ordre que celle de ses chefs d'oeuvres les plus intimes comme Wagonmaster(Le convoi des braves– 1950) ou Young Mr Lincoln(Vers sa destinée– 1939). Comme si ce film n'était pas immensément riche en mouvements humains. Il faut dire que c'est l'un des films préférés de Lindsay Anderson qui n'aime guère Fort Apache. Ceci explique peut être cela et puis nous nous sommes réconciliés sur The man who shot Liberty Valance(L'homme qui tua Liberty Valance– 1962) pour lequel McBride écrit « [c'est] le film américain le plus important des années 60 ». Et puis tout ça, c'est une question de point de vue.
Celui de McBride se défend avec vigueur et son implication personnelle dans le livre n'est pas la moindre de ses qualités. Il vous faudra faire une bonne place dans votre bibliothèque à cet ouvrage important mais non définitif. La recherche de John Ford peut continuer puisque ce qui compte, c'est le voyage.
Le livre
22:48 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, joseph mcbride | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/11/2007
John Ford au Mercury

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : John Ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/10/2007
Cavaliers noirs et blancs
« La plupart des films sur lesquels j’écris très souvent, je ne les ai jamais revus depuis plus de vingt ans. » (Louis Skorecki dans un entretien aux Inrocks)
Je vais dons tenter l'expérience d'une nouvelle plongée dans mes souvenirs pour deux films de John Ford opportunément ressortis en salle en cette année faste pour les admirateurs du merveilleux barde borgne.
Je n'ai jamais revu Sergeant Rutledge (Le sergent noir) depuis une lointaine soirée familiale et télévisuelle. Largement plus de vint ans. Je dirais si l'on me pose la question que j'ai un bon souvenir de ce film. Mais de quoi me souviens-je ? Il faudrait déjà faire la part entre le souvenir réel de cette soirée et les éléments qui se sont ajoutés au fil des années, les photographies, les articles lus, les discussions. En essayant d'être le plus honnête possible, je ne me souviens de presque rien de ce film. Si je me rappelais qu'il était question d'un soldat noir accusé de viol, je ne me souvenais même plus que le film était construit autour d'un procès. Deux images, presque des sensations : un combat des « buffalo soldiers », ces unités de cavalerie composées de soldats noirs, avec les indiens, des chevaux, de la poussière qui tourbillonne, ces fameuses chutes très dynamiques des films de Ford. Ensuite, la scène de la gare. La jeune femme qui attend sur le quai dans une ambiance quasi fantastique, la nuit, la brume, et puis la silhouette du sergent joué par Woody Strode, immense et effrayant. Mais pourtant bienveillant. Et cette photographie du programme TV de l'époque (si vous avez aimé celle de mes héros chabroliens). C'est comme cela que l'on se crée des mythes. Et puis si je me force, me vient l'image de vieilles rombières fordiennes, Billie Burke et Mae Marsh sont de la partie. C'est tout. Ah ! Et la chanson du film, je me souviens d'un air, celui de la légende du Captain Buffalo. Ma mémoire l'a peut être déformé, je saurais ça quand je l'entendrais de nouveau.
« ...With a whoop and a holler and ring-tang-toe, Hup Two Three Four, Captain Buffalo, Captain Buffalo »

Quand Ford réalise ce film, en 1960, entre deux superproductions à grandes stars, il fait l'un de ses « petits films » qui lui tiennent à coeur et estime sans doute n'avoir rien à prouver. Il aborde un sujet sensible en cette période de la lutte pour les droits civiques d'une façon à la fois personnelle et déroutante, traduisant bien ses propres contradictions dans la représentation des noirs au sein de son oeuvre. Pourtant, avec le recul, il donne à Woody Strode, ce magnifique acteur, ce splendide être humain, un rôle qui va bien au delà de ce qui se pratiquait alors chez des cinéastes « progressistes » comme Stanley Kramer ou Martin Ritt. Il fait de son sergent noir un héros authentique. Ce n'est pas la thèse qui l'intéresse mais le portrait d'un homme. « Il m'a filmé comme John Wayne, sur fond de Monument Valley » disait Strode. Chez Ford, la dignité n'est pas dans ce qui est dit mais dans ce qui est montré, dans la façon dont sont montrés même les plus humbles. C'est Muley dans Grapes of Warth (Les raisins de la colère), c'est le chef Poney-qui-marche dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque), c'est Cochise dans Fort Apache et c'est le sergent Braxton Rutledge.
Ce dernier paragraphe est bien sur issu de réflexions beaucoup plus récentes. Il reste à vérifier pour moi le vendredi 23 novembre puisque j'aurais l'honneur de présenter le film à Nice. Je vous en reparlerais.

The horse soldiers(Les cavaliers), c'est une autre histoire. C'est le film juste avant Sergeant Rutledge, grosse production chère avec John Wayne et William Holden. Le film a mauvaise réputation. La fin du tournage s'est endeuillée de la mort du cascadeur Fred Kennedy, vieil ami de Ford, lors d'une chute de cheval à priori banale. Démoralisé, Ford arrêta le tournage et le film fut complété plus tard. Il est considéré comme une commande mineure. Le film est pourtant très fordien. C'est le récit d'un raid de cavalerie nordiste loin dans les lignes sudistes pendant la guerre de sécession. On y trouve les thèmes du nord et du sud, le devoir, le sentiment d'échec, l'histoire d'une nation déchirée mais réconciliable, et la relativité de l'héroïsme. Le colonel joué par Wayne passe son temps, comme le capitaine de She wore a yellow ribbon, à chercher à éviter le combat au maximum. Ce film je l'ai revu plusieurs fois récemment. L'autre jour, c'était après avoir écouté l'émission de France Culture que m'avait envoyé 4roses (que je remercie encore) et où l'on disait son admiration pour le film, chose peu commune. J'ai été frappé à cette nouvelle vision de voir comment les plans du film étaient organisés autour des arbres. La photographie superbe de William Clothier est une succession de paysages dont le calme et la sérénité contrastent avec l'agitation des hommes. Pas un plan en extérieur qui ne mette en valeur arbres et branches, ces mille tonalités de vert si reposant, un sentiment d'éternité.
J'ai vu ce film très jeune. A l'époque, il suffisait qu'il y ait des cavaliers bleus dans un film pour que je m'enthousiasme. Les arbres, à l'époque, ne m'avaient pas marqué je pense. Le sentiment d'éternité non plus. Je me souvenais surtout de la scène du début que j'ai longtemps confondue avec la première scène de The undefeated(Les géants de l'ouest), un western de Andrew McLaglen, fils de son père Victor. A y repenser, ce n'est pas étonnant puisque McLaglen a tout (mal) pompé sur Ford. Je me souvenais aussi de la séquence de la charge des cadets. A un moment, pour retarder l'avance des nordistes, une troupe d'enfants de 12 à 16 ans s'avance en rang bien ordonné et charge. Wayne, bien sûr, ne fait pas tirer dessus et la scène finit par une dispersion bouffonne bien dans le ton humoristique de Ford. Je suppose que je m'identifiais un peu aux cadets. Je me souvenais enfin de l'amputation, vers la fin, d'un soldat. J'ai toujours été sensible aux scènes d'amputation dans les films. Ford et Hawks ont réussi de belles choses sur ce motif. C'est tout. Mais comme pour le film précédent, cela a suffit pour que ces films restent gravés en bonne place dans ma mémoire encombrée de cinéphile.
D'autres peuvent à nouveau les graver, puisque les deux films ressortent en salle, ô bonheur, et je signale un charmant article sur le sujet par Pierre Berthomieu dans le dernier numéro de Positif.
Affiche : Carteles
Sergeant Rutledge par Skorecki
The horse soldiers par Tepepa
23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, Louis Skorecki | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/09/2007
Ford à l'Institut Lumière
Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement 4roses pour ses liens audio, je vous laisse celui-ci (France Culture) encore actif. Et pour célébrer tout ceci dignement, une petite galerie d'affiches (source : l'indispensable site Carteles).


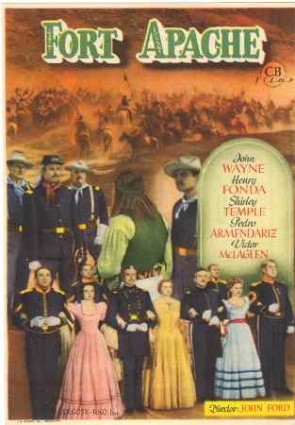
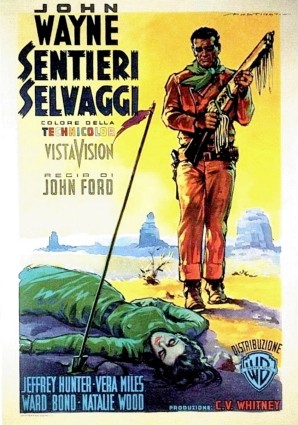
13:00 Publié dans Festival | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, rétrospective, Institut Lumière, affiches | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2007
Finale
John Ford Blog-a-thon
Ici s'achève ce John Ford Blog-a-thon. J'avais prévu de terminer par un article sur l'héritage fordien, notamment dans le cinéma de Steven Spielberg, une idée que j'avais déjà abordée lors de la sortie de Munich (voir ICI), mais je n'ai pu aboutir à un texte satisfaisant aussi je reporte la publication ces considérations essentielles (forcément). Je tiens à remercier ceux qui ont participé :
Blogart (la comtesse)
Le bon Dr Orlof
Peter Nellhaus du blog Coffee, coffee and more coffee
Et les deux petits bonus sur l'Hispaniola et Cher Nanni
Et sur le fil, comme la cavalerie qui arrive juste à temps, Tepepa sur l'immense Stagecoach. Les autres notes sur les westerns de Ford méritent aussi le détour.
Je rappelle le lien sur la Rétrospective Ford du festival de La Rochelle qui s'achève aujourd'hui. Et je vous annonce la ressortie début septembre de Sergeant Rutledge (Le sergent Noir – 1960) par Bisrepetita.
Je remercie aussi et surtout les lecteurs et commentateurs, en particulier 4roses dont les analyses pointues et passionnées ont été un grand plaisir tout au long de ces dix journées. Il est temps pour moi de souffler un peu et de vous laisser souffler aussi de risque de lasser. Mais je reviendrais sur Ford, j'y reviens toujours.

09:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
08/07/2007
Motif : lazy line
John Ford blog-a-thon
La « lazy line » désigne dans la culture des indiens Navajos, une erreur volontaire dans la trame des tapis pour casser la continuité trop parfaite du tissage. Cette rupture signifie l'impossibilité de la perfection dans une oeuvre humaine. Ford, la légende le dit, était chef honoraire des Navajos qui ont maintes fois joué pour lui dans les ocres de Monument Valley. Cette philosophie de la « lazy line » ne pouvait manquer de séduire celui qui savait si bien changer de ton d'une scène à l'autre. Le motif parcours l'ensemble de The Searchers (La prisonnière du désert en 1956). Motifs visuels, irruptions dans le champ, cadrages, symboles (le chef comanche s'appelle Scar, cicatrice, en écho à la cicatrice intérieure d'Ethan Edwards), mais aussi brusques ruptures dans la narration, comme la blessure aux fesses du révérend après le sommet d'émotion du geste d'Ethan envers Debbie, et le contraste entre les somptueux extérieurs et les décors de studio revendiqués tels. (Je n'ai pas trouvé ça tout seul, il y eu un livre très précis sur le sujet : La Prisonnière du désert, une tapisserie navajo de Jean Louis Leutrat).




08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/07/2007
Impetuous ! Homeric ! - Partie 2
Le moteur érotique de The quiet man, c'est l'interaction entre ces deux corps. Quelle phrase. Mais cela prend en compte la diversité de ces interactions, en particulier la douce violence au sein du couple. Il l'attrape au vol, elle tente de le gifler plusieurs fois, il lui donne une tape sur les fesses (Fais comme si c'était pas grave dira Jason Robards à Claudia Cardinale chez Léone), elle le menace d'un fouet, Il la lance sur le lit et, pour finir, il y aura la longue et anthologique scène où il la ramène de la gare à son frère avec au passage un coup de pied aux fesses qui aura fait grincer bien des dents. Il faut noter qu'aucun de ces gestes ne se résout en tragédie (Les gifles sont contrées, il accepte de dormir dans le salon), que quand on se bat chez Ford c'est souvent entre amis et que cette violence est partagée dans le sens qu'il ne s'agit pas d'exercer une domination. Elle n'est pas différente de celle de la bagarre finale qui n'est qu'une forme de réconciliation (virile, certes) entre Thornton et Dananher frère. Bien sûr que c'est irréaliste, dans la vraie vie on se bat rarement pour rire, en couple ou entre amis sauf les enfants. Mais nous sommes au cinéma, alors cela se pratique entre armée et marine, entre cavaliers, entre irlandais, entre mari et femme. Question de tempérament. Question de comédie aussi, la référence du film, c'est La mégère apprivoisée de William Shakespeare.
Dans le cas présent, on comprend vite qu'il ne s'agit que d'une autre façon de s'étreindre et le premier échange d'horions se transforme vite en baiser passionné. Comme à l'issue de la « promenade de santé », Mary Kate peut accepter le compromis avec Sean et lui ouvrir la porte de la chaudière dans laquelle il balance l'argent de la dot. Et puis repartir, fière, le regard une nouvelle fois plein de désir, s'étant affirmée comme femme et épouse au vu de tous après que lui se soit affirmé comme homme et mari respectueux de ce que cela signifie à Innisfree. Le dernier plan du film, après que l'ensemble des acteurs ait salué comme à la scène, montre nos deux époux devant leur cottage. Mary Kate murmure quelques mots à l'oreille de Sean qui prend un air étonné comme seul Wayne en était capable. La légende veut que Maureen O'Hara n'ait dit qu'à John Ford ce que serait sa réplique, sans doute à la hauteur de son franc parlé. Les deux John ayant disparu, la rousse sublime ayant décidé d'emporter le secret dans la tombe, nous sommes libres d'imaginer de quelle façon Mary Kate entraîne Sean vers White O'morn' pour y rattraper le temps perdu.

De gauche à droite: Francis Ford, John Wayne, Victor McLagen, John Ford et Barry Fitzgerald (assis)
Si la dimension de comédie érotique est essentielle, il ne faudrait pas qu'elle masque les autres richesses du film. Comme dans plusieurs de ses oeuvres de la même période, John Ford exprime dans The quiet man un idéal de vie. Celui de la petite communauté comme les mormons de Wagonmaster ou la petite ville de The sun shine bright. Des communautés avec leurs préjugés mais finalement ouvertes, une ambiance 1900, dans lequel la voiture est rare, la grande ville et l'industrie lointaines, la vie harmonieuse et où le temps s'écoule avec douceur. Une utopie. Caractéristique est le traitement de la religion dans ce film. Ford, on le sait était un catholique bon teint. Dans un pays où la question religieuse est si sensible, il se paie le luxe de montrer des communautés apaisées et vivant en bonne entente. Prêtre (Ward Bond) et pasteur (Arthur Shields) complotent ensemble à réunir les amants. Et au final les nombreux catholiques se feront passer pour des protestants pour conserver son poste au pasteur. Et Ford va plus loin. A ces religions modernes et monothéistes, il mêle de nombreux signes de croyances anciennes et d'esprits naturels. Ainsi comme on l'a noté, la façon dont les éléments interviennent aux côtés des personnages : la tempête aux moments de passion, la pluie sombre lors de la tentative de demande en mariage, le vent lors de la course de chevaux, le feu au coeur du foyer. Et puis il y a ce vieux saumon traqué par le père Lonergan, véritable esprit de la rivière. Et la réplique de Michaleen Oge Flynn « Homéric ! » abusé par l'état du lit nuptial. Et cette façon d'évoquer la moderne Amérique et les aciéries de Pittsburg (Dans une fournaise si chaude que l'homme en oublie sa crainte du feu éternel). Cet ensemble de croyances cohabite sans heurt, harmonieuses au sein d'une nature irlandaise puissante et bienveillante. Innisfree est bien une terre de conte de fée, si proche et si lointaine.
Ford en accentue le côté irréel avec la narration assurée de façon intermittente par Ward Bond, le contraste entre les somptueux extérieurs irlandais et les décors de studio travaillés de façon expressionniste (le cottage, le cimetière, le ring) et qui ne cherchent pas à cacher ce qu'ils sont ; la mise en scène qui travaille le côté théâtral des situations (la course de chevaux, la bagarre finale, le mariage) avec le décor envisagé comme une scène, les figurants comme spectateurs de l'action et ses rituels quand Flynn met en scène la demande en mariage, la cours ou la bagarre finale. Il faut aussi mentionner l'utilisation de la musique, partition enlevée de Victor Young basée sur des airs traditionnels, qui est alternativement extérieure et intégrée à l'action. Pour Ford, enfin, ce retour sur la terre ancestrale se traduit par un retour au cinéma des origines, le muet. A plusieurs reprises le son est délaissé pour la pure expression visuelle comme dans la scène du tandem. On y voit Wayne parler, mais on ne l'entend déjà plus. Seul compte alors l'attitude de Maureen O'Hara qui l'entraîne dans la course poursuite au milieu des champs où l'image est reine.
Cette philosophie de vie, c'était celle que Ford recherchait dans l'exercice de son métier et la clef de sa conception du cinéma. Le tournage de The quiet man a été une histoire familiale et de belles vacances d'été. Son frère Francis Ford, qui le fit venir à Hollywood au milieu des années 10, joue le truculent Dan Tobin, le patriarche ressuscité par la « réconciliation » finale ; Maureen O'Hara y joue avec ses deux frères Charles Fitzsimons et James O'Hara ; John Wayne était venu en famille et quatre de ses enfants sont dans le film (autour de O'Hara lors de la scène de la course). On retrouve évidemment l'essentiel de la troupe à Ford : Ward Bond et ses cannes à pêche, Ken Curtis avec son accordéon, Mae Marsh, Arthur Shields et son jeu de puce, Mildred Natwick vieille fille comme bientôt chez Hitchcock, Sam Harris en général sourd ; et l'immense Victor McLaglen. La touche locale au film est achevée par les prestations de plusieurs acteurs de la fameuse troupe des Players from the Abbey Theatre Company en personnel des chemins de fer, piliers de bar et petites gens d'Innisfree. Barry Fitzgerald en est le plus illustre représentant dans l'inoubliable rôle de Michaleen Oge Flynn. Comme il le dit : «la nuit est claire et fraîche, j'ai envie d'aller rejoindre mes amis et discuter politique ». Il est sur un petit pont de pierre avec Wayne, non loin du cottage. On entend la rivière en dessous et le vent du soir. C'est un moment doux et précieux.
Pistes
le DVD
Un magnifique article en anglais par William C. Dowling
Un article sur DVDclassik
La fiche sur le Ciné-club de Caen
Un article en anglais sur Speakeasy.org
Un article en anglais sur filmsite
Un article en anglais sur Reel Classics
Le Quiet man movie club
Le site du village de Cong (à visiter un jour)
Photographie : © Connacht Tribune Group
08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : blog-a-thon, john ford | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
06/07/2007
Motif : comédie musicale





Source : captures DVD Montparnasse
08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
05/07/2007
Impetuous ! Homeric ! - Partie 1
Ford aimait à décrire The quiet man (L'homme tranquille) comme « Une histoire d'amour entre adultes ». Le cinéma de Ford a de nombreuses qualités et sa sensibilité vibre pour de nombreux aspects de la vie humaine. Mais il est bien difficile de le reconnaître comme un cinéaste à l'érotisme exacerbé malgré de notables efforts avec Joanne Dru ou Ava Gardner. Ses films regorgent de femmes sublimes, mères courageuses, épouses dévouées, jeune filles en fleur, prostituées au grand coeur, institutrices, bonnes soeur, aristocrate sudiste et même doctoresse dans l'ultime et féminin Seven Women (Frontière chinoise en 1966). Mais au contraire de ses pairs, disons Hawks ou Hitchcock, Ford ne leur permet pas de dégager beaucoup de sensualité. L'exception, c'est bien sur le film qui nous intéresse et qui constitue, dans son oeuvre, un cas. Le cas typique du film atypique, de ce projet aux résonances intimes que l'on porte des années et qui se fait enfin, envers et contre tout et qui, miracle renouvelé du cinéma, rencontre le public, les honneurs (oscar à la clef) et finit par marquer durablement une carrière. Le genre de film qui permet, quand on en connaît l'histoire, de se dire qu'il y a une justice en ce bas monde.
Ce n'est peut être pas un hasard si Ford s'intéresse à l'histoire de Maurice Walsh, The quiet man (parue dans le Saturday Evening Post en 1933) en 1936, alors qu'il est, dit-on, très amoureux de Katharine Hepburn qu'il dirige dans Mary of Scotland. Il en achète les droits et tente de monter le projet. Malgré son statut et sa statue (l'oscar pour The informer), il échoue à intéresser un studio à ce qu'ils appellent (les cons !) « Une stupide petite histoire irlandaise ». Le temps passe, la guerre survient, Ford ne désarme pas et convainc dès 1945 Maureen O'Hara qu'il a dirigé dans How green was my valley (Qu'elle était verte ma vallée en 1941) et John Wayne se s'engager dans le projet. O'Hara racontera volontiers à quel point elle sera impliquée dans la conception du film, tapant elle-même à la machine les différentes version du scénario de Franck S. Nugent sur le yacht de Ford, l'Araner. Les studios restant difficiles à convaincre, O'Hara plaisantait le réalisateur en lui disant qu'au train ou allaient les choses ils seraient, elle et Wayne, bientôt trop vieux pour le jouer. En fin stratège, Ford, au vu du succès de ses deux premiers westerns autour de la cavalerie américaine, finit par convaincre Herbert J. Yates de la petite Republic Pictures de faire le film en échange d'un autre western. Ce sera Rio Grandeen 1950, dont Ford se sert pour tester son couple vedette (voir ICI). Le test étant concluant côté sensualité au-delà de ses espérances, il prépare activement le tournage qui a lieu l'été 1951 autour du village de Cong (près de Galway) en Irlande même, pour une sortie en 1952 et un succès public comme critique, oscars à la clef pour Ford et son fidèle chef opérateur Winton C. Hoch.
The quiet man est un conte de fée merveilleux, sensuel et unique. Le voir en 2007 est presque douloureux tellement il ressemble à l'évocation d'un paradis perdu. Sergio Léone, qui a dit parfois des conneries, rejetait le film pour son irréalisme politique. Comment parler d'Irlande sans parler d'IRA ? Mauvaise version italienne ou distraction ? Le film est bourré d'allusions (le grand père déporté en Australie, certaines chanson, les deux ex-officiers, le toast...) et il y même une citation littérale de l'IRA (le Sinn Féin en VF). Mais tout cela n'est pas très important, Sergio. L'Irlande de Ford est un territoire de cinéma, comme Monument Valley, dans lequel le réalisateur a mis beaucoup de lui même, de ses origines, de sa propre légende. L'Irlande de Ford est un territoire de la sensualité et son film, le seul de sa longue carrière, est l'un des plus érotiquement émouvant qui soit.
Qu'est-ce que The quiet man ? L'histoire de Sean (John) Thornton qui débarque de Pittsburg (Massachusetts, USA) dans son village natal d'Innisfree pour y refaire sa vie sur la terre de ses ancêtres. Il y croise Mary (prénom de la mère de Ford) Kate (Hepburn) Danaher qui porte un jupon rouge et garde ses moutons. Ils tombent raides amoureux l'un de l'autre au premier regard. Mary Kate est rousse et attachée aux traditions. Elle doit obtenir l'accord de son frère pour se marier mais celui-ci a un mauvais premier contact avec l'américain. D'où problèmes, complot, mensonges, drame et comédie, mais vous connaissez le film aussi bien que moi.

The quiet man, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont une envie irrésistible de coucher ensemble mais qui doivent pour ce faire lutter, lui contre un lourd passé, elle contre une lourde éducation. Plus complexe, fordien, ils doivent concilier harmonieusement leur pulsion sexuelle avec leur être profond. Sean n'entend pas renoncer à son mépris de l'argent (Vous connaissez combien de films où l'on brûle de l'argent avec tant de naturel ?) et doit accepter ce qu'il est profondément, un homme dont le métier est de se battre (Boxeur pour ceux qui ont le bonheur d'avoir encore à découvrir le film). Mary Kate n'entend pas renoncer au respect des traditions irlandaises, notamment en matière de dot, car elle sait que c'est à travers cela qu'elle peut s'affirmer comme femme et s'épanouir pleinement comme épouse. Elle a des mots magnifiques pour exprimer ce que cela représente pour elle, ce qu'elle porte de rêve et d'espoir. Et son regard lorsqu'elle chante « Innisfre » est une merveilleuse expression de féminité. Leur problème, le moteur du film, c'est qu'ils doivent s'apprivoiser. Apprendre à se respecter et à s'accepter. Et le faire sans se laisser déborder par leurs sens. Rarement dans un film le désir a été aussi clairement montré. Dès qu'ils sont face à face, Sean et Mary Kate déchaînent les éléments (la tempête dans le cottage, l'orage dans le cimetière). John Wayne et Maureen O'Hara dégagent une sensualité d'autant plus forte qu'elle est soigneusement enchâssée dans la vison poétique de Ford. Celui-ci s'est véritablement investit dans son histoire au point de violenter sa nature. Harry Carey Jr raconte comment, sur Rio Grande, il avait repoussé jusqu'au dernier moment la scène du baiser entre Wayne et O'Hara. Wayne pestait : « Il déteste diriger les scènes d'amour ». Dans The quiet man, j'en suis à me demander comment certaines choses ont pu passer la censure de l'époque. En finesse.
Dès le premier regard, c'est le coup de foudre. Sean découvre Mary Kate en fille sauvage, gambadant au milieu de ses moutons. Ford donne le ton avec ce jupon rouge vif et ce premier regard explicite de la jeune femme. Les regards de Maureen O'Hara dans ce film sont tous aussi suggestifs les uns que les autres. Elle donne l'impression de dévorer Wayne des yeux et Ford, comme Hawks plus tard, utilise le contraste entre la franchise sexuelle de son actrice avec le côté ingénu de l'acteur. Il est toujours réjouissant de voir Wayne embarrassé par une femme. L'autre élément déterminant, c'est le lien qui est fait entre les sentiments et la nature somptueuse. La passion obéit ici à un ordre naturel supérieur à celui de la société, religion ou tradition.
La seconde rencontre, Ford s'amuse justement à la situer à l'église pour bien indiquer que cette passion ne respectera rien. La scène la plus torride ce sera donc dans le cimetière. Le coup du bénitier, ou Sean transgresse ingénument les règles en présentant l'eau bénite à Mary Kate qui accepte la transgression avec l'eau, est explicite. La force du film est de montrer ce geste comme s'ils s'étaient roulé un patin en public. Pour le passage à l'acte, il en faudra plus. La première étreinte, c'est la fameuse scène du cottage, devenue une icône du cinéma. Elle est filmée comme une scène de cinéma fantastique (et ressemble beaucoup à l'arrivée de Claudette Colbert dans la ferme de Henry Fonda dans Drums along the Mohawks tourné en 1939). Le vent souffle en tempête, les volets battent, la lumière est crépusculaire, caverneuse, primitive. Ford déchaîne le monde qui se met au diapason des corps. Et ces corps sont filmés comme dans une comédie musicale, forme qui a brillé à exprimer la sensualité. Et toutes les scènes entre les deux amants, bientôt époux, sont ainsi très précisément travaillées au niveau des gestes et des déplacements. Et la grâce de Wayne, son fameux balancement des hanches, fait merveille. Il la fait surgir de sa cachette, elle tente de sortir, il la rattrape par le bras et l'attire vers d'un mouvement aussi ample qu'irréaliste. Est-ce que ce n'est pas une figure vue avec Fred Astaire et Ginger Rogers ? Comme la scène de la cours officielle. Leur façon de marcher ensemble puis de s'enfuir brutalement pour s'emparer du tandem rappelle la scène de Central Park entre Astaire et Cyd Charisse dans The band Wagon (Tous en scène – 1953 de Vincente Minelli). Le couple s'harmonise avant de se libérer à travers la course / la danse. Plus loin, il y a ce plan magnifique où elle retire ses bas qui valent bien les gants de Rita Hayworth, puis ils ont une façon de se courir après toujours très chorégraphique. Tout comme la façon dont ils retirent, l'un après l'autre, leurs chapeaux.
Le grand moment érotique, c'est bien sûr cette scène du cimetière. Là ils sont enfin seuls. La tension est à son comble car nous savons que l'on peut s'attendre à tout de la part d'un couple aussi amoureux (enfin dans les limites hollywoodiennes, hein). Après un échange verbal brillant dans la tradition de la comédie sophistiquée, Ford ramène son cinéma à l'expression originelle du muet et de la pure expression corporelle. Le premier baiser déchaîne à nouveau le vent et l'orage dans ce cimetière irréel surgit d'un profond passé. Les corps sont à nouveau dirigés au millimètre pour un moment de pure magie qui montre le désir de Mary Kate et la candeur solide de Sean. Ce qui est très fort, très osé quand on y pense, c'est que l'érotisme passe plus par le corps de l'homme que par celui de la femme. Combien de réalisateurs on plus ou moins savamment déshabillé leurs actrices ? Combien ont utilisé plus ou moins élégamment l'érotisme de l'eau en mouillant leurs chemisiers ? Ford, lui choisit de mouiller la chemise de Wayne, ce qui est dans la logique de la scène (il lui a donné sa veste pour la protéger de la pluie) et permet de mettre l'accent sur le désir féminin d'une façon assez inédite. On notera que c'est par ailleurs la femme qui dirige la chorégraphie du sentiment et que l'homme la découvre, l'accepte et y répond. « Et c'est à travers ces lourdes gouttes d'eau que battent les coeurs ».
(à suivre)
Photographie de l'affiche : collection personnelle.
08:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : john ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/07/2007
Jeunes années
John Ford Blog-a-thon
Quel bonheur ! La plupart des films courts de Ford sont perdus ou difficilement visibles. Celui-ci, signé Jack Ford, date de 1919 pour la Universal. By indian Post, aussi connu sous le titre The love letter a été édité dans les excellentes compilations Retour de flamme (volume 5). Mis en ligne par un cinéphile espagnol.
08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : John Ford, court métrage, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
03/07/2007
Souvenirs
John Ford blog-a-thon
La compagnie des héros
par Harry Carey Jr
Edition des Riaux
Il n'est pas forcément facile de mettre immédiatement un visage sur le nom de Harry Carey Jr. Mais que l'on voit ce visage et l'on se rappelle l'avoir croisé plus d'une fois aux côtés de John Wayne sur les pistes de Monument Valley. Harry Carey Jr a fait partie de la « John Ford'stock company », cette troupe de comédiens fidèles qui a campé les nombreux personnages de l'univers du grand réalisateur et que l'on identifie au premier coup d'oeil : Le cocher de L'homme tranquille, la mère des Raisins de la colère, le sergent bourru et dévoué de La charge héroïque, le médecin de La chevauchée fantastique... Harry Carey Jr est avec Maureen O'Hara le dernier survivant de la bande. Son père, Harry Carey, avait aidé Ford à débuter à la fin des années 10. Les deux hommes firent des dizaines de westerns de série, les Cheyenne Harry, dont la plupart sont malheureusement perdus. Puis ils se brouillèrent professionnellement. Mais juste après la guerre, Ford proposa à Carey junior l'un des rôles principaux de sa nouvelle version de Three godfathers, (Le fils du désert) que Carey senior avait tourné avec Ford au temps du muet. Le père venait de mourir et Ford de perdre l'un de ses amis les plus chers. Et c'est ainsi que « Dobe » Carey intégra la troupe après un tournage-initiation des plus rude. Rappelez-vous, ce jeune homme mince, rouquin, un peu fragile. Il a été le kid d'Abilène dans Le fils du désert, le prétentieux lieutenant Pennell qui veut emmener Joan Dru en pique-nique dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque), la flegmatique recrue Boone avec son brin de paille à la bouche dans Rio Grande, Sandy, l'un des wagonmasters du Convoi des bravesaux côtés de son ami Ben Johnson, le malheureux soupirant de Lucy, enlevée et assassinée par les comanches de The searchers (La prisonnière du désert), huit films jusqu'à retrouver l'uniforme bleu et Ben Johnson dans Cheyennes autumn (Les cheyennes), l'adieu au western et à Monument Valley du maître.

Harry Carey Jr a donc raconté en 1994 ses souvenirs dans un épais livre, La compagnie des héros. Ce n'est certes pas de la grande littérature mais un document de premier ordre sur les tournages de Ford. Car Carey Jr, littéralement fasciné, visiblement toujours très ému d'avoir fait partie de cette épopée cinématographique, s'en tient rigoureusement à ses expériences avec le réalisateur, expédiant sa propre biographie et ne mentionnant qu'à peine le reste de sa longue carrière qui démarre avec Red River (La rivière rouge) de Howard Hawks en 1946 jusqu'au Tombstone de Georges Pan Cosmatos en 1993 En passant par le second volet des Trinita avec Bud Spencer et Terence Hill. C'est donc John Ford au travail, au quotidien de ses tournages, dans la poussière rouge de Monument Valley, un Ford à la fois craint, aimé, détesté et admiré sans mesure. Carey décrit avec détails (quelle mémoire, cet homme) ce qu'il vit de la préparation des films, l'importance du choix d'un chapeau, par exemple, la construction des personnages, le quotidien des prises de vues, la façon de diriger les acteurs, de travailler avec les techniciens. Ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression d'y être et que l'on comprend que l'on y est pas. C'est à dire que l'on approche que de très loin qui faisait l'art de Ford, que celui-ci ne se livrait pas plus, ne s'exprimait pas plus sur son travail, qu'il ne le faisait dans d'autres circonstances. Ford procédait par petites touches : un détail (une façon de nouer un foulard), une réplique (« C'est un setter irlandais »), une idée qui fait discrètement son chemin (La monte romaine dans Rio grande), beaucoup de choses qui ne semblent pas si importantes sur le coup mais prennent sens à la vision du film terminé. Une vision d'ensemble que Ford ne semblait pas disposé à partager avec quiconque. Même quand il rend hommage au père du jeune acteur en filmant son cheval, il n'en dit sur le coup et écarte Carey Jr du plateau. Comme ceux qui travaillaient avec Ford, on sort de ce livre avec le sentiment d'avoir compris quelque chose d'important, tout en sachant que le mystère reste entier. Harry Carey Jr précise néanmoins quelques fameux morceaux de la légende : Winton C. Hoch n'a pas refusé de filmer la scène d'orage dans La charge héroïque, Ford lui-même a hésité. C'est Wayne qui a eu l'idée du geste final du bras dans La prisonnière du désert pour rendre hommage à Carey Sr. Le tournage des Deux cavaliers a débuté dans une ambiance plutôt favorable avant de basculer à l'annonce de la mort de Ward Bond. Des choses comme cela. Les pages les plus émouvantes sont celles consacrées au tournage des Cheyennes en 1964. Carey Jr et le complice Ben Johnson y jouent sans être crédités deux cavaliers aux côtés de Richard Widmark. On sent que c'est pour tous l'ultime tour de piste avec « papa » dans la chère Monument Valley. Et Ford de faire durer le tournage tant qu'il pu, suspendre un moment le temps.
Pistes :
Le livre
Une critique sur Écran Noir
Un article de Georges Malassenet dans l'Humanité
Le site de Harry Carey Jr
Photographie source SCVhistory.com
08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, Harry Carey Jr, blog-a-thon, livre | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
02/07/2007
Motif : chevauchée




08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
01/07/2007
Derniers feux, revoir « Les deux cavaliers »
John Ford Blog-a-thon
Tous les critiques qui se sont penchés sur l'oeuvre de John Ford s'accordent à voir en l'année 1956 et à The searchers (La prisonnière du désert) un tournant dans sa carrière. A partir de là, il y a ceux comme Lindsay Anderson ou Tad Gallagher qui voient son talent décliner et ceux, comme l'équipe des Cahiers du Cinéma ou Bertrand Tavernier, qui le voient au contraire affirmer son style et sa pensée avec encore plus de liberté. Il n'y a guère que The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) qui fait relativement l'unanimité, les uns comme les autres étant sensibles à sa vision morale et sa manière sombre.
Il faut commencer par examiner les faits objectifs. La période 1956/1966 voit la chute du système traditionnel des studios. Une nouvelle génération de metteurs en scène fait son apparition. La télévision étend son empire et son emprise. Les acteurs-stars sont désormais producteurs et imposent leurs volontés. C'est d'ailleurs grâce au soutien loyal de John Wayne, Richard Widmark et James Stewart que Ford pourra monter quelques uns de ses derniers films. The times, they are-a-changin'. Tout ceci, Ford le subit, sans doute sans plaisir mais il n'est pas le seul. Des gens comme Franck Capra, Anthony Mann, Alfred Hitchcock ou même Howard Hawks sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes frustrations. Et puis Ford prend de l'âge, sa vue lui pose des problèmes, son goût pour l'alcool aussi. Contrairement à Hawks qui vieillit mieux que bien, fait de la moto jusqu'à 77 ans et continue de courir les jeunes filles, Ford tient mal le choc physiquement. Luc Moullet, dans l'indispensable Théorie des acteurs raconte les multiples variations que les deux hommes firent dans leurs films autour de la vieillesse et de la décrépitude physique. Est-ce que ces difficultés se retrouvent au niveau des facultés intellectuelles, de l'inspiration, du talent ? Revoir un film comme Two rode together(Les deux cavaliers) tourné en 1961 est une façon de répondre à la question.
Parmi les films jugés faibles de notre homme, celui-ci est particulièrement mal vu. Anderson a l'impression que « Ford a positivement détesté celui-là ». Scott Eyman estime que « Ford semble avoir fait ce film machinalement ». Ford lui même déclare à Peter Bogdanovich qu'il « ne s'est pas amusé du tout ». Seul Harry Carey Jr, dans ses mémoires, se souvient d'un « tournage heureux », mais il était alors alors lui-même dans une mauvaise passe et ce tournage, pour lui, c'était des vacances. Le film avait été proposé au dernier moment à Ford par Harry Cohn, le producteur terrible de la Columbia, qui lui avait demandé de le mettre en scène pour lui rendre service. « Ok,on va le faire ton fichu machin » répondit Ford à priori peu enthousiaste. Pourtant tout le monde a noté que Two rode together, écrit par Franck Nugent qui avait travaillé entre autres sur The quiet man, The searchers et The last Hurrah (La dernière fanfare en 1958), est plein de choses très fordiennes. C'est l'histoire d'un officier de cavalerie intègre, Jim Gary joué décontracté par Richard Widmark, qui convainc un marshal un peu magouilleur, Guthrie McCabe joué avec délectation par James Stewart, de l'accompagner pour rechercher des enfants enlevés par des comanches. Leur quête et ce qu'il advient des « enfants » retrouvés et ramenés chez les blancs constitue le corps du film. Comme dans The searchers, la communauté est déchirée entre son racisme viscéral envers les « sauvages », la notion de souillure (physique et morale), et les sentiments familiaux, le besoin de cohésion du groupe. Contrairement au film précédent, la contradiction ne se résout pas et les effets du retour seront destructeurs. La violence l'emporte. La haine et le désespoir règnent. Certains enlevés préfèrent rester (sagement) chez les comanches, la jeune mexicaine sera rejetée et un jeune garçon sera lynché. Si la jeune femme trouve son salut et l'amour avec McCabe revenu de ses magouilles, le lynchage de l'adolescent est une des scènes les plus dures, la plus tristement violente de l'oeuvre de Ford. Sans hasard, les deux meneurs de la foule sont joués par Harry Carey Jr et Ken Curtis, ignobles, habituellement voués aux rôles de garçons sympathiques. Tout le film baigne dans une atmosphère d'amertume, ploie sous le poids du destin.
La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai globalement rejeté. Manque de rythme, décors de studio criards, je ne croyais pas à Woody Strode en indien, ni à Henry Brandon qui refait son numéro de chef. Les intermèdes comiques ne me faisaient pas rire. La cata. Pourtant... pourtant, il y a la fameuse scène, le fameux plan séquence sur Widmark et Stewart assis au bord de la rivière et discutant de tout et de rien un long moment. Un plan qui, paraît-il avait impressionné Marguerite Duras. Ah.
C'est pour revoir ce plan que je me suis décidé à l'acheter en DVD et à le revoir. Je dois dire que j'appréhendais certaines scènes. Et là, miracle ! Tout fonctionne. La vive musique de George Duning, la photographie du spécialiste du western Charles Lawton Jr, la pose de Stewart, les jambes allongées sur sa chaise comme Henry Fonda dans My darling Clémentine (La poursuite infernale en 1946), la poussière sur la veste de Widmark, même Woody Strode, après tout aussi crédible et beau que dans Kéoma. Et ce plan qui dure, qui permet de se réjouir du jeu des deux acteurs, de leur jeu corporel, les fameux jeux de main de Stewart, son texte bien en bouche, les gestes amples de Widmark, visiblement inspiré de ceux de Wayne. Et la disposition des jambes des deux hommes. Et cette sensation de temps qui s'écoule avec douceur. Et la simple beauté, si fordienne de l'escadron de cavaliers qui traverse la rivière. Homme de peu de foi qui avait douté.
Je ne sais pas ce que donnera une troisième vison, mais je sais que les beautés de ce film, que les beautés des oeuvres de cette dernière période sont sans doute moins immédiatement visibles que dans celles des grandes périodes d'avant et d'après guerre.
Ce film décontenance sans doute par sa tonalité amère. C'est bien une variation sur The searchers, une variation dans laquelle le héros ne permet pas le retour à l'équilibre du monde. Il est même obligé de prendre la fuite. McCabe est une sorte d'Ethan Edwards avec quelques années de plus et qui cherche surtout à ne pas rouvrir les cicatrices du passé. Comme aussi le capitaine Brittles dans She wore a yellow ribbon (La charge héroïque en 1949), il passe son temps à éviter les combats. Homme d'expérience, il anticipe les drames a venir et sait qu'il ne pourra les empêcher. Ce fatalisme, loin de l'idéal souvent décrit par Ford, peut choquer. Il faut se souvenir que durant le tournage, Ford appris la mort de son ami Ward Bond. Cette mort le marqua profondément après celle du cascadeur Fred Kennedy sur le tournage de The horse soldiers (Les cavaliers en 1959) qui lui fit interrompre le final de ce film. Il est bien possible que cet ensemble de contingences physiques et morales l'ai conduit à infléchir son discours et a exprimer très clairement ses doutes et ses peurs. A se radicaliser, à viser l'essentiel. Comme l'exprime McCabe à un moment : « Il faut parfois plus de courage pour vivre que pour mourir ». Il serait intéressant de savoir ce qui a été tourné avant et après ce décès. Car d'un autre côté, le film a de très beaux moments harmonieux, notamment tout le début, où Ford prend son temps, laisse ses acteurs habiter leurs personnages et donner corps à leur relation. On a beaucoup glosé sur les mauvais côtés du personnage de Stewart et l'on confond un peu vite son désir quasi maladif de se protéger avec du cynisme. Toutes les premières scènes le présentent plutôt comme une version paresseuse des personnages joués dans les années 30 par Will Rogers ou de Wyatt Earp – Henry Fonda. Et puis cette scène au bord de la rivière. Quand je parle de viser à l'essentiel, je sens que ce sont ces passages où l'on sent s'écouler la douceur du temps, de la vie qui passe, qui ont véritablement intéressé Ford. Cette tendresse qu'il oppose ensuite à la violence du monde.
On pourra également s'amuser à lire le film comme une parabole sur la situation du cinéaste. Un homme qui a fait son trou non sans cynisme, sollicité par un ami pour une mission qui le rebute et le conduit dans des territoires et des situations familières. Une mission vouée à l'échec mais dont il tirera le meilleur partit en se retrouvant lui-même grâce à l'amour d'une femme. Selon Harry Carey Jr, Ford « avait le béguin » pour l'actrice Shirley Jones.
Reste que le film n'en est par pour autant un chef d'oeuvre méconnu. Les intermèdes comiques ne me semblent toujours pas plus drôles. Le film est parfois un peu lâche au niveau du rythme. Mais mieux qu'un « grand film malade », Two rode together est une belle oeuvre de transition, enrichissant encore une oeuvre déjà considérable et ouvrant des portes pour les années restantes.

Pistes
Le DVD
Photographie : Allociné
Sur le site du Ciné-club de Caen
Sur ARTE
la chronique de Tepepa
Sur Onirik
Sur DVDbeaver
Analyse de la premère séquence sur le PhilblogZophe
08:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : John Ford, western, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
30/06/2007
Un visage, une carrière
Pour une filmographie complète avec une biographie correcte, voyez la fiche anglaise de Wikipedia. Il y a aussi, très détaillée, la fiche IMDB. Ce sont les bases.
Voici quelques photographies de Ford. Tout d'abord un portrait des années 30 du Domaine public (source Wikipedia) :

ICI une photographie publicitaire d'Alex Kahle qui date de 1937.
ICI une photographie de studio, la RKO, pour la promotion de The plough and the stars (Révolte à Dublin) en 1936.

08:30 Publié dans Réalisateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
29/06/2007
John Ford (et moi, et moi, et moi)
John Ford blog-a-thon
Je suis né en décembre 1964. John Ford sort son dernier long métrage, Seven women (Frontière chinoise) en 1966. Pourtant son oeuvre n'a cessé de m'accompagner et, contrairement à celle de tant d'autres cinéastes, elle n'a cessé de me fasciner, c'est un fait qui n'aura échappé à personne. Mes plus vieux souvenirs de cinéma, si vieux que je ne saurais les dater, sont liés à ses films. La poursuite finale dans Stagecoatch (La chevauchée fantastique)qui est peut être un des tout premiers films que j'ai vu de ma vie, la marche de John Wayne dans le canyon de Three godfathers (Le fils du désert), la charge des cadets et l'amputation de Horse soldiers (Les cavaliers), les bateaux de They were expandable (Les sacrifiés), la chute de Wayne dans l'escalier de Wings of the eagle (L'aigle vole au soleil)... Il est sans doute le premier réalisateur que j'ai identifié en tant que tel, avec Disney, mais ce dernier était déjà plus une marque qu'une signature. Plus tard, c'est la programmation de Stagecoatch qui m'amènera en 1978 à m'inscrire à la Cinémathèque de Nice. C'est la diffusion de My Darling Clémentine (La poursuite infernale) qui m'attirera à la Cinémathèque de Bruxelles. C'est une soirée Ford qui me décidera à retourner faire un tour l'an dernier à Cannes.
Ford me fascine et je ne cesse de me demander pourquoi. Une première approche, forcément superficielle, me laisse songeur. John Ford était un américain d'origine irlandaise, catholique, croyant, militaire de carrière (il a finit amiral, je crois, et a fait du contre espionnage), démocrate longtemps, il vire conservateur républicain au milieu des années 60, attaché aux traditions toujours ainsi qu'aux valeurs familiales. C'était un homme assez secret, un secret qu'il a savamment entretenu pour avoir la paix ; tout comme il entretenait son sale caractère. Au fil des témoignages, biographies et documentaires, on le découvre tour à tour colérique, tyrannique, irascible, porté sur la boisson (il était loin d'être le seul), capable de dureté voire de cruauté avec ses acteurs, rancunier, bref possédant autant que d'autres la « dark side of the genius ». Ses films peuvent s'attaquer au choix sur les angles du machisme, du paternalisme, du militarisme, de l'impérialisme et d'un tas d'autres trucs en « isme », y compris, ça s'est entendu, du communisme. Alors ?
Alors, tout cela compte très peu en regard d'une oeuvre qui aura mis l'homme en son centre, l'homme sous toutes ses facettes, les nobles comme les abjectes, et avec toutes ses contradictions. Peut-être inspiré par les siennes propres, Ford aura filmé une chose et son contraire, non en les opposant dans des corps différents comme il se pratique le plus souvent, mais en les mêlant dans le même individu et en faisant de la résolution de cette contradiction le moteur de ses histoires. Ainsi cohabitent chez Mary Kate Danaher dans The quiet man (L'homme tranquille) les valeurs traditionnelles irlandaises (la place de la femme, la valeur de l'argent, le respect au frère) et ses désirs de femme (désir sexuel, volonté d'exister par elle même) qui rendent au final assez peu pertinentes les critiques de machisme faites à ce film (j'y reviens). Ainsi Ethan Edwards dans The searchers (La prisonnière du désert), doit résoudre la contradiction interne entre son racisme viscéral pour les indiens et son sens de la famille, résolution qui se fera à travers la quête de sa nièce enlevée par les comanches et qui en fera un homme apaisé mais condamné à errer à jamais. Ainsi Marty Maher dans The long gray line (Ce n'est qu'un au-revoir) doit apprendre à vivre avec sa fascination et son dévouement à l'armée (ici West Point) et son désespoir de voir partir à la guerre de jeunes hommes qui parfois ne reviennent pas. Et lorsque Ford s'engage dans la voie plus classique de l'incarnation en différents personnages de différents points de vue, il se débrouille le plus souvent pour renverser les repères. Ainsi dans les célèbres fins de The man who shot Liberty Valance (L'homme qui tua Liberty Valance) et Fort Apache(Le massacre de Fort Apache) ce que l'on tient pour acquit (Stoddart est un héros, le colonel Thrusday est un salaud, je simplifie) est remis en cause. Ford nous montre que la réputation de l'intègre avocat est bâtie sur un mensonge et que le courageux et progressiste capitaine York justifie son supérieur devant les journalistes. Avec cela, on comprend que les films de Ford soient pleins de perdants magnifiques, exaltent l'esprit de sacrifice, et baignent dans une douceur mélancolique, parfois teintée d'amertume dans les oeuvres les plus sombres.
La vision de Ford me semble mêler avec grâce le simple et le complexe, ce qui le rend à la fois immédiatement compréhensible et analysable en profondeur. Il y a une notion forte et claire du bien et du mal chez Ford, mais aussi la notion de leur relativité et les rapports ambigus qu'ils entretiennent. Dans Stagecoach les marginaux sont les héros, le banquier est un voleur et l'aristocrate sudiste un homme déchu. Chez Ford, un homme (une femme) vaut par son humanité tout en état fortement ancré dans une réalité sociale. La première transcende la seconde, comme chez ce timide avocat appelé Abraham Lincoln. Ce qui explique, et j'aime tellement cette idée, que les hommes changent, qu'ils sont capables d'évoluer, de s'ouvrir comme Tom Joad qui comprend le sens de l'engagement, comme dans ce final de The searchers qui n'a jamais finit de me bouleverser lorsque Wayne prend Nathalie Wood dans ses bras. Si l'on pleure à ce moment, c'est un peu à cause du mélo, mais surtout parce que l'on voit un homme découvrir son humanité. La pulsion de vie prendre le pas sur la pulsion de mort. C'est ce que Ford n'a cessé de filmer.
Et a ces mouvements internes répondent de vifs mouvements externes. De l'action pure. On a souvent définit le plan fixe comme la figure type du cinéma fordien. Pourtant ce sont ses merveilleux travellings latéraux accompagnant diligences, cavaliers ou hordes indiennes qui me semblent son inimitable signature. Ford était un grand portraitiste mais il avait aussi un oeil remarquable pour traduire la dynamique exaltante du mouvement.

Ford est aussi plus cinéaste que la plupart des cinéastes. Formé à l'école du muet, il maîtrise ce langage comme très peu d'autres. Il est notable qu'il soit sans doute le plus discret, le moins disert des metteurs en scène, refusant de s'expliquer, pirouettant, envoyant bouler ceux qui tentent de lui faire dire ses images. Il est tout entier dans son art. Comme les plus grands, il a délimité un espace personnel, un monde de fiction purement cinématographique, entre Monument Valley et Innisfree. Un monde de fiction peuplé de sa troupe, la « John Ford stock company », ces visages inoubliables qui incarnent cow-boys, marins, militaires, cavaliers, indiens, mères, prostituées, docteurs alcooliques, journalistes, barmen irlandais et tant d'autres. Une troupe que l'on retrouve derrière la caméra avec ses collaborations répétées avec tel opérateur, tel musicien, tel cascadeur. Une troupe de fidèles dévoués. Une conception du cinéma comme mode de vie collectif.
Son destin de réalisateur est assez exceptionnel, il arrive à Hollywood naissant alors qu'il n'a pas 20 ans. Il tourne son premier film à 23 et il n'a pas 30 ans qu'il est aux commandes d'une épopée comme The iron horse (Le cheval de fer). Ford aura eu toute la liberté possible dans un système à la fois ambitieux et contraignant. Sa carrière épouse l'histoire de Hollywood, de la naissance à la première chute en passant par l'apogée du muet, la révolution du parlant, l'âge d'or et les premières lézardes. Elle épouse aussi l'histoire de son pays, les deux guerres, la seconde surtout qu'il fera et filmera, la crise de 1929, le New Deal, la Corée, le guerre froide, l'ère Kennedy et jusqu'aux doutes des années 60. Au-delà de son vécu, Ford aura revisité tout la brève histoire de son pays depuis l'époque des pionniers de la vallée de la Mohawk jusqu'aux années 60, passant par la guerre de sécession, la conquête de l'ouest, les guerres indiennes et la naissance de la civilisation industrielle. Un peu plus de 130 films, un poil de télévision et quelques documentaires. Ford en impose à la fois par la qualité et la quantité. Ses méthodes de tournage qui tirent le meilleur et de son art et du système lui permettent par exemple, entre 1939 et 140, de réaliser à la suite Stagecoach, Young Mr Lincoln (Vers sa destinée), Drums along the Mohawks (Sur la poste des Mohawks), Grapes of Wrath (Les raisins de la colère) et The long Voyage home (Le long voyage). Ca donne le vertige. Mais Ford est aussi celui qui a dit « J'ai mené cent combats contre les studios et je les ai tous perdus ». Encore une façon de nuancer les choses pour celui qui, dans une oeuvre riche en succès commerciaux et grosses productions, disait préférer Wagonmaster (Le convoi des braves) ou The sun shine bright (Le soleil brille pour tout le monde), de « petits films ».
John Ford, poète en cinéma, « divin barde » comme le furent en leurs temps Homère pour la Grèce antique ou Shakespeare pour l'Angleterre élisabéthaine, aura filmé l'épopée de son pays et le mécanisme de cette épopée, la scène et les coulisses. Il aura filmé le vent dans les chevelures, les roches immémoriales, les cours d'eau scintillants, les robes qui ondulent, la poussière rouge sur les bottes, les services en faïence bleue, les chants, les steaks, les couvertures indiennes, les cieux d'orages sur la lande, les cieux si bleus du pacifique, les frissons au froid du petit matin, les vertes prairies irlandaises, le noir profond des mines du pays de Galles, la mélancolie douce des cimetières, la tempête tropicale, le calme crépuscule africain, la vitesse des chevaux, la joie des chiens, le courage des hommes, la beauté des femmes et vice-versa.
Le John Ford blog-a-thon est donc ouvert. Je publie ci-dessous les liens avec les différents participants et je mettrais à jour cette liste régulièrement jusqu'au 9 juillet. Si quelqu'un échappe à ma vigilance, qu'il n'hésite pas à me mettre un petit message.
Rétrospective Ford au festival de La Rochelle (très beau texte de Thierry Frémaux)
Bande annonce d'époque sur Cher Nanni
La contribution de Blogart (la comtesse)
Initiative originale, un jeu autour des actrices sur le Ciné-club de Caen. Et bien sûr leur fiche sur Ford.
Les deux cavaliers selon le bon Dr Orlof. Merci de ta participation, Pierrot.
"Quand la légende..." Steamboat round the bend par Sonic Eric, merci pour ce texte, proche de ce que j'aurais aimé écrire sur Judge Priest.
Lee Marvin on John Ford, un superbe document sur Cinébeats. Thanks a lot for this posting.
L'héritier rock sur l'Hispaniola (un jour, je développerais cette idée).
Peter Nellhaus du blog Coffee, coffee and more coffee (en anglais), propose une relecture de What price glory ? (1952) qui vient de sortir en France dans un coffret de films rares. Thanks a lot Peter, it is an honor to have your contribution.
08:00 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : John Ford, blog-a-thon | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
























