A la recherche de John Ford (15/03/2008)
Joseph McBride écrit dans A la recherche de John Ford (Editions Institut Lumière – Actes Sud) que la genèse de ce livre remonte à 1971. Cinéphile passionné par cette oeuvre immense, il organise des projections dès l'université avant de devenir avec Peter Bogdanovich l'un des critiques clefs de la réévaluation du cinéaste au début des années 70. Il rencontrera le maître (« Vous n'avez rien à faire de plus excitant » lui dira Ford pour commencer), ses collaborateurs, sa famille et se rendra sur la terre de ses ancêtres. Poussé par le temps qui efface petit à petit cette génération, naît alors l'ambition d'un livre somme, vaste comme les étendues de Monument Valley, qui embrasse l'homme et l'oeuvre.
Aujourd'hui, le livre existe, à la mesure de cette ambition. Un pavé comme on dit, de plus de mille pages sur papier bible. Un somme, oui, de témoignages, de documents, de recherches, de recoupements. Un travail de détective, d'historien, de critique et d'amoureux qui force l'admiration par son ampleur et sa précision. Et ce qui ne gâte rien, ça se lit facilement, avec voracité même pour peu que l'on partage avec l'auteur cet amour de la poésie fordienne et la fascination pour son mystère.
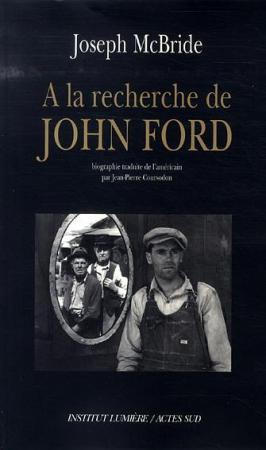
A la recherche de John Ford se situe dans la ligné des ouvrages de Donald Spoto sur Alfred Hitchcock, de Todd McCarthy sur Howard Hawks ou encore de Serge Toubiana et Antoine De Baecque sur François Truffaut. Il cherche à pénétrer l'homme en profondeur pour éclairer son oeuvre. Le titre choisi par McBride est significatif. Il existe une énigme John Ford et il cherche à la percer. Mais Ford est un morceau plus coriace que ses collègues. Hawks était un aristocrate qui s'épanouissait dans l'action (Faire des films, de la moto, de l'avion), Truffaut et Hitchcock étaient obsédés par les femmes et le cinéma de façon exclusive. Ford c'est une autre paire de manches et, dès le milieu du livre, j'ai eu le sentiment que McBride n'arrivait pas, ne toucherait pas à son but. Comme le personnage joué par John Wayne à la fin de The searchers (La prisonnière du désert), il réunit les morceaux mais reste sur le seuil. A plusieurs reprises, il avoue ses difficultés à résoudre les contradictions fordiennes. Son abondance de sources et sa précision ne font que rendre les choses encore plus obscures.
Par exemple sur l'attitude du cinéaste durant le maccarthysme et la liste noire. Dans un long chapitre, nous avons côte à côte sa fameuse déclaration courageuse où il s'oppose à Cecil B. DeMille, et la lettre admirative qu'il lui envoie le lendemain, son amitié pour Wayne et Ward Bond, très engagés dans le combat anticommuniste, couplé à sa façon de leur faire jouer des « libéraux » (Wayne dans Fort Apache) ou des personnages symboles de tolérance pour Bond. Il y a ses emportements contre le sénateur Mac Carthy (« Je ne voudrais même pas rencontrer cet homme dans un bordel ») et une lettre ou il accuse John Huston de communisme. Il y a ses dérobades, des aveux d'impuissance, et puis sa façon de faire retirer son amie Anna Lee de la liste noire d'un simple coup de fil. Il y a des zones d'ombres, le goût du secret, l'art du mensonge, de l'humour douteux. Impossible de s'y retrouver là-dedans.
Et McBride parfois s'y enferre. Il fait à mon sens deux erreurs. La première est de vouloir lire les positions complexes de Ford à la lumière de critères actuels, notamment de ce que l'on appelle le « politiquement correct ». C'est flagrant dans l'étude de la façon dont Ford aborde les minorités (indiens, noirs). D'abord parce que Ford raisonne en termes d'être humain ou de groupe social (la famille, la garnison, la tribu) plutôt qu'en termes nationaux, politiques ou ethniques. Ce qui l'amène à privilégier tel ou tel point de vue selon le cas et, par exemple, exalter les buffalo soldiers noirs sur le dos des apaches, ou passer alternativement pour les indiens d'une vision généreuse au cliché des brutes sanguinaires. Un film comme The searchers est ainsi un monument d'ambiguïté pouvant susciter les lectures les plus diverses. Et Ford l'a sans doute voulu comme ça.
L'autre erreur me semble être de ne pas suffisamment faire la part de l'humour fordien. Rien que dans ses films, son sens de l'humour irlandais ne fait toujours pas l'unanimité et donne prise à ses plus dures critiques. En lisant la lettre à DeMille, par exemple, j'ai beaucoup de mal à la trouver sérieuse. Je peux me tromper, mais j'y vois de l'ironie. A plusieurs reprises, je pensais à la phrase de Desproges : «On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et puis, il faut avouer que Ford lui-même n'a jamais simplifié les choses. Il a toujours aimé avancer masqué. Il parlait peu et on ne compte plus les répliques déroutantes pour ses plus fidèles admirateurs. Pétri de contradictions, il semble avoir cultivé cet aspect de sa personnalité pour protéger une sensibilité à vif qu'il estimait dangereuse au sein du système dans lequel il travaillait. Il préférait la laisser filtrer dans ses films. Ses films sont l'expression d'un idéal mais sa vie, pour riche qu'elle fut, en était loin. Pour lui sans doute l'oeuvre devait passer avant l'homme, une oeuvre dont McBride écrit justement, presque à regret, que sa complexité permet à chacun de trouver ce qu'il est venu chercher. Ce qui fait de la recherche de John Ford une recherche sur soi-même.
D'un point de vue biographique, le livre est une réussite. Toute la première partie sur son enfance dans le Maine et son adolescence est un puissant portrait de l'immigration irlandaise au début du siècle (et je comprends la fascination de Martin Scorcese pour Ford). Toute l'histoire sur ses débuts dans le Hollywood naissant est passionnant, éclairant surtout sur la relation complexe (tiens) qu'il entretenait avec son frère Francis. C'est Francis qui le fit venir et le format, Francis qui était alors un metteur en scène coté et dont la carrière dégringola au début des années 20. Par la suite, les évènements sont plus connus et l'on retrouve les grands passages de la légende, de la découverte de Wayne à la brouille avec Fonda, de son implication dans la seconde guerre mondiale à ses relations avec les producteurs. Une découverte pour moi, sa liaison (complexe encore) avec Katharine Hepburn en 1936/1937.
D'un point de vue critique, je suis plus mitigé. L'essentiel de l'oeuvre muette étant perdue, la tache reste ardue. McBride cite volontiers ses collègues et se situe clairement dans le camp de ceux qui estiment assez haut la fin de carrière de Ford, à l'inverse de Lindsay Anderson par exemple. Pas de grosse surprise mis à part les pages enflammées sur Pilgrimage (Deux femmes – 1932) que l'auteur tient en très haute estime. Un film que je dois découvrir toutes affaires cessantes. Il y a de très belles pages aussi sur How green was my valley (Quelle était verte ma vallée – 1941) que j'ai eu envie de revoir illico, The quiet man (L'homme tranquille – 1952), Fort Apache (Le massacre de fort Apache – 1948) et The searchers(La prisonnière du désert– 1956). Peu d'originalité dans l'approche de films moins estimés mais estimables comme Mogambo(1953) ou The horse soldiers(Les cavaliers– 1959). Je partage aussi moins ses critiques sur les prestations de Victor McLaglen dans The informer(Le mouchard– 1935) et de Jane Darwell dans Grapes of warth(Les raisins de la colère– 1940). Passé les contorsions sur tel ou tel aspect politique de l'oeuvre, j'ai surtout été surpris sur le peu de cas que fait McBride de She wore a yellow ribbon (La charge héroïque– 1949). La beauté du film est reconnue, mais McBride déplore le peu d'action. « Scénario médiocre », le livre m'en est tombé des mains. Comme si la délicate tapisserie de ce film n'était pas du même ordre que celle de ses chefs d'oeuvres les plus intimes comme Wagonmaster(Le convoi des braves– 1950) ou Young Mr Lincoln(Vers sa destinée– 1939). Comme si ce film n'était pas immensément riche en mouvements humains. Il faut dire que c'est l'un des films préférés de Lindsay Anderson qui n'aime guère Fort Apache. Ceci explique peut être cela et puis nous nous sommes réconciliés sur The man who shot Liberty Valance(L'homme qui tua Liberty Valance– 1962) pour lequel McBride écrit « [c'est] le film américain le plus important des années 60 ». Et puis tout ça, c'est une question de point de vue.
Celui de McBride se défend avec vigueur et son implication personnelle dans le livre n'est pas la moindre de ses qualités. Il vous faudra faire une bonne place dans votre bibliothèque à cet ouvrage important mais non définitif. La recherche de John Ford peut continuer puisque ce qui compte, c'est le voyage.
Le livre
22:48 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : john ford, joseph mcbride | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Commentaires
Mazette, quel post ! J'étais sûr que la sortie du Mc Bride allait t'inspirer. J'attends l'été pour m'y plonger à fond.
Écrit par : sonic eric | 16/03/2008
Rétrospective John Ford ici:
http://cinemalux.canalblog.com/archives/2008/03/21/8410358.html
A bientot.
Écrit par : S*E*B | 27/03/2008