« 2012-10 | Page d'accueil
| 2012-12 »
28/11/2012
Ça vous gêne pas, ce truc au dessus ?

Fatigué le perchman sur cette photographie de tournage de The empire strike back (L'empire contre-attaque - 1980) d'Irvin Kershner. Photographie © LucasFilms
09:18 Publié dans Ça | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irvin kershner | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
26/11/2012
Laura

« Pour ce qui est de ma performance personnelle dans ce film, je n’ai jamais eu le sentiment de faire beaucoup mieux qu’une prestation réussie. Je suis contente que le public continue de m’identifier à Laura plutôt que de ne pas m’identifier du tout. L’hommage va, je crois, au personnage – cette Laura, créature de rêve – plus qu’à mon éventuel talent d’actrice. Je ne dis pas cela par modestie. Nul d’entre nous, qui fut impliqué dans ce film, ne lui prêta à l’époque la moindre chance d’accéder au rang de classique du mystère, voire de survivre à une génération »
Gene Tierney, citée dans Gene Tierney et Mickey Herskowitz, Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma…, Ramsay « Poche Cinéma », 2006. Source Wikipedia.
Photographie Cinémathèque Suisse.
10:35 Publié dans Panthéon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto preminger, gene tierney | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/11/2012
Saines lectures

Le saut de l'ange (1971) de Yves Boisset - Photographie Capture DVD Studio Canal
08:08 Publié dans Curiosité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves boisset, bande dessinée | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/11/2012
Assurance sur la mort
Après John Carpenter et Abel Ferrara, c'est une bonne nouvelle que de pouvoir se mettre sous l’œil un nouveau film de William Friedkin Malgré les six années séparant Bug (2006) de Killer Joe (2011), ce dernier vient confirmer la vitalité du réalisateur, la maîtrise toujours bluffante de sa mise en scène et sa capacité à reprendre tout en les renouvelant ses motifs de prédilection (Le Mal, les amis, le Mal !). Entre baudruches et divertissements standards, en attendant le Mud de Jeff Nichols, voilà qui entretient la flamme d'un cinéma américain trop ronronnant.

Killer Joe s'ouvre sur quelques minutes d'une intensité qui me rappelle que Friedkin prenait avis à ses début auprès de Howard Hawks. Il sortait avec la fille du maître, ce qui est pratique. La nuit, un éclair violent, la pluie, un chat noir traverse l'écran large, des phares, un chien qui hurle, un plan très large qui va se resserrant. Un jeune homme éperdu tambourine sur l'une de ces mobile-home des échoués du rêve américain. La porte s'ouvre et le jeune homme se trouve nez à nez avec un sexe de femme. C'est celui de Sharla, sa belle-mère. C'est ainsi que l'on fait connaissance au sein d'un chaos aux limites du fantastique, de la famille Smith. Admirons en cet instant l'ironie d'un patronyme excessivement banal pour une famille qui ne l'est en rien. Le jeune homme c'est Chris (Emile Hirsch), petit voyou et petit trafiquant qui a des dettes. Ansel est son père, abruti par la vie (Admirable visage de l'acteur Thomas Haden Church), remarié avec Sharla que nous venons de découvrir (La sublime Gina Gershon donne tout). Enfin, Dottie (Juno Temple, troublante) est la jeune sœur, joli visage d'ange, foyer d'innocence et pivot du film. Comme dans tout bon film noir, Chris doit payer ses dettes ou mourir. Il propose donc à sa famille modèle de tuer sa mère, partie avec un autre type, pour toucher l'assurance vie. Ô combien de malfrats se sont lancés dans cette affaire. Chris se croit plus malin et a prévu d’engager un tueur professionnel, le Joe du titre. Joe est un flic façon cow-boy texan bien que le film se situe en Louisiane, ange noir tout de noir vêtu, des bottes au chapeau. C'est un puritain et un mystique, tueur pour arrondir ses fins de mois et complètement obsédé. Dans le rôle, Matthew McConaughey est ahurissant, délectable, réussissant un beau doublé avec sa prestation du Mud de Jeff Nichols cité plus haut.
Sans le sou, Chris va proposer en échange à Joe sa sœur vierge. Car Joe est tombé sous le charme de Dottie. Le démon est subjugué par l'ange, la belle par la bête. Histoire éternelle. Friedkin introduit du mythe universel sous le vernis de surface du polar, du drame au sein de personnages et de situations vues mille fois. L'histoire de Chris et de sa famille de bras-cassés prend la dimension d'une tragédie américaine grand style que Friedkin pervertit d'une ironie qui lui est propre. Chris est l'homme luttant contre le Destin. A lui l'initiative, à lui aussi l'échec programmé. Quoi qu'il entreprenne, le destin lui fera un douloureux croc-en-jambe. Il sera broyé (un vrai calvaire dont Friedkin nourri d'imagerie chrétienne multiplie les références visuelles) pour avoir tenté de s'en sortir et s'être mesuré à des forces qui le dépassent (Digger Soames son créancier, puis Joe). Friedkin le montre hyperactif, courant à travers l'espace du film, frénétique dès la première scène, enfermé dehors, à la recherche d'une ouverture, semblant fuir une force mauvaise, en butte à l'hostilité du monde : l'orage, le chien. Il faut dire aussi que Friedkin souligne le désordre moral de son héros. Motivé par de fausses valeur, l'argent en premier lieu, Chris s'aveugle, s'obstine et passe toutes les lignes les jaunes puis les rouges. Comme le père Karras ou le flic Richard Chance, Chris n'est pas de taille et le paye au prix fort.

Face à lui, le Destin s'incarne en la personne de Joe, nouvel avatar d'une longue lignée d’incarnations du Mal habitant l’œuvre du réalisateur. Joe ressemble étrangement au personnage de Rick Masters joué par William Dafoe To live and die in L.A. (Police fédérale Los Angeles – 1985) : cheveu lisse, tiré à quatre épingles, langage précieux, esthète, sensuel, filmé avec densité et amour du détail quand la caméra détaille son extravagante tenue noire. Il a aussi, on en revient au côté mystique, quelque chose du pasteur Harry Powell de Night of the hunter (La nuit du chasseur – 1955). Friedkin pousse une analogie avec le vampire. Introduit dans la famille (un vampire doit être invité à entrer), il prend possession de la jeune vierge qu'il séduit érotiquement au cours d'une scène très sensuelle. Il occupe alors l'espace, prend le contrôle et déchaîne une violence terrifiante quand il comprend que l'on a tenté de le berner. Comme dans toutes les légendes, le Diable n'apprécie pas qu'on le floue et seule l'innocence peut l'arrêter. Dottie incarne cette figure, femme enfant que l'on découvre recroquevillée sur son lit. Fragile, presque transparente, elle est la Pureté menacée comme la petite Regan de The exorcist dont l'âme est une nouvelle fois l'enjeu du combat au cœur du film.
Le scénario de Tracy Letts d'après sa pièce, comme pour Bug, brasse toutes ces références allégoriques qui nourrissent la mise en scène de Friedkin en lui donnant matière à des scènes de grande intensité. Le découpage sophistiqué et le montage une nouvelle fois signé Darrin Navarro orchestrent les rapports de domination et de manipulation entre les personnages, jouant entre tension et explosions de violence, maîtrisant des scènes qui vont loin, très loin dans la folie comme la dernière scène, tétanisante, où se mêlent humiliation sexuelle, parodie de rite familial (le repas avec les Grâces) et violence graphique.
Tout ceci pourrait irriter si ne se superposait un regard sur l'Amérique qui incite à la réflexion. Toujours moraliste, Friedkin livre un portrait de son pays gangrené par la drogue, la célébrité à tout prix, l'argent comme valeur absolue, la violence comme mode d'expression, et surtout un détonant mélange de bêtise et de prétention. Impitoyable mais sans mépris. Le pathétique de cette Amérique pauvre et perdue, s'incarne dans le personnage du père qui incarne ceux qui ont renoncé. Ansel est lent à la détente. Il est un père inutile comme le père de Regan était absent. Il sera incapable de protéger ni ses enfants ni sa femme. Face à lui, Friedkin souligne sans complaisance les valeurs dans lesquelles se réfugie Chris, l'argent mais aussi son rêve d'ailleurs et d'un couple incestueux et improbable avec Dottie. La vision du réalisateur est donc d'un pessimisme radical, ce qui n'est pas nouveau. Mais il la tempère du regard fier de Dottie, ce plan final où le mal vacille une nouvelle fois. Killer Joe m'apparaît comme plus globalement réussi que le déjà très réussi Bug, moins théâtral malgré les mêmes origines, avec sa juste distance ironique, un grand film sur notre monde d'aujourd'hui.
Photographies :© Pyramide Distribution
08:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : william friedkin | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/11/2012
Nid d'espions

John Garfield, épaules carrées et mâchoires serrées, le regard fiévreux, traverse Fallen Sparrow (Nid d'espions) comme une boule d'énergie brute. Déterminé, incontrôlable, l'esprit sur la corde raide. Il incarne John « Kit » McKittrick revenu en ville pour mener l'enquête sur la mort (suicide ou meurtre ?) de son ami Louie Lepetino qui l'avait tiré des geôles de l'Espagne franquistes où il était torturé. McKittrick paye sa dette d'honneur et d'honneur il est beaucoup question dans Fallen Sparrow. C'est le moteur du film, au risque que son final laisse le spectateur d'aujourd'hui perplexe. Car on ne se bat pas ici pour une arme secrète où un traité vital, mais pour le dérisoire symbole d'une idée. L'étoffe dont sont faits les rêves comme dirait monsieur Guzman à propos du faucon de Malte. Cette idée est à remettre dans le contexte de l'époque. Réalisé en 1943 par Richard Wallace dans la dernière partie d'une carrière commencée comme monteur dans les années 20 chez Mack Sennett, Fallen Sparrow est un film noir agrémenté d'espionnage. En prise immédiate avec son époque comme Foreign correspondant (Correspondant 17 – 1940) d'Alfred Hitchcock, Man hunt (1941) de Fritz Lang, ou le Casablanca mythique de Michael Curtiz qui sort au même moment, c'est un film anti-nazi, le film d'une Amérique en guerre aux heures les plus sombres. Au-delà du symbole dérisoire, il y a l'idéal des démocraties et c'est l'un des mérites de Wallace de relier ce combat à celui des brigades internationales lors de la guerre d'Espagne.
Lire la suite sur les Fiches du Cinéma
Photographie Allmovies.com
08:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : richard wallace | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
17/11/2012
Les proies du vampire en tenues légères

« C'est absurde et incohérent ! » éclate à un moment l'une des filles de L'ultima preda del vampiro (Des filles pour un vampire). C'est toujours un grand moment quand un personnage se met à exprimer tout haut, depuis l'écran, ce que ressent généralement tout bas le spectateur sur son siège. Brenda (à moins que ce ne soit Julie) avoue ainsi son désarroi à être plongée dans une histoire dont l'absence d'originalité force l'admiration et dont le mécanisme manque singulièrement d'huile dans les rouages. Josette (ou Clara, je ne sais plus) fait partie d'une troupe de strip-teaseuses minable et itinérante, allant de ville en ville dans leur vieil autocar brinquebalant, accompagnée de leur manager forcément chauve et roublard, et conduites par leur chauffeur-pianiste. Il n' y a pas de petites économies. Suite à un orage (Ho !) qui leur coupe la route (Aïe), la troupe trouve refuge dans un immense château isolé (héhéhé). Comme il se doit, les autochtones apeurés ont prévenu que ce n'était pas une bonne idée parce qu'il s'en passe de drôle chez les Kernassy. Le spectateur perspicace aurait pu renchérir. Mais nos héros n'allant pas au cinéma, ils passent outre. « There is a light at the Frankenstein place » comme dit la chanson. Les voilà donc accueillis par un jardinier boiteux, une gouvernante raide et Gabor Kernassy, le châtelain affable quoiqu'un peu étrange. Du solide. Nous voici prêts pour un cocktail d'horreur et d'érotisme, cette fois malheureusement pas très tonique que signe Piero Regnoli en 1961.
Lire la suite sur les Fiches du Cinéma
La chronique du bon Dr Orlof
Photographie Artus Films
14:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : piero regnoli | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
16/11/2012
Champagne !
Un peu en retard quand même, c'est le 13 novembre 2004 que s'ouvrait Inisfree.
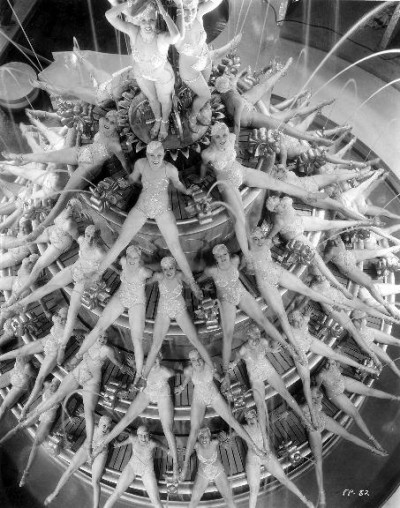
Photographie DR / Source Allociné
14:52 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : inisfree | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
14/11/2012
Légende du Grand Nord

Amateurs de dépaysement géographique radical et d'étrange cinématographique Valkoinen peura (Le Renne blanc) est fait pour vous. Tirez votre révérence aux éditions Artus qui ont exhumé cette gemme finlandaise réalisée par Erik Blomberg en 1952. Le film en son temps se tailla une certaine réputation en étant primé au Festival de Cannes 1953 de l'amusant Prix international du film légendaire. Jean Cocteau était dans le jury. Plongez donc dans les immensités glacées de Laponie aux confins du cercle polaire, blanches à perdre haleine, pour découvrir la belle histoire de Pirita (je ne garanti pas l’orthographe des noms), belle jeune femme aux étranges pouvoirs surnaturels. Elle tombe amoureuse du beau Aslak, éleveur de rennes, au cours d'une course en traîneaux (très belle scène purement visuelle). Ils se marient mais elle se sent très vite délaissée. Après avoir consulté un sorcier local, elle sacrifie un jeune renne à un dieu païen dont la statue se dresse sur la glace (très beau moment de pur fantastique). Pirita devient alors le renne blanc, animal insaisissable qui entraîne les hommes dans la vallée de la mort. Là, elle se révèle sous sa véritable forme humaine mais son sourire charmeur découvre deux canines pointues et crac ! Pirita est le Dracula femelle des steppes lapones dont les métamorphoses sont adaptées au climat. C'est saisissant. Valkoinen peura tient également de l'histoire du Docteur Jekyll et Mister Hyde car Pirita a une conscience et sa partie humaine tente de lutter contre son avatar surnaturel et la malédiction qu'elle a inconsidérément déclenchée. Craignant de perdre son mari, elle retourne implorer le dieu silencieux et glacé.
Lire la suite sur Les Fiches du Cinéma
La chronique du Dr Orlof
Photographie DR
12:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : erik blomberg | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
12/11/2012
Retour vers 1948
22:31 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : zoom arrière | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
11/11/2012
Haneke, amour et petits poissons
Que les choses soient claires d'entrée, je n'ai pas changé d'avis et je n'y suis pas allé. Mais je dois dire, non sans gourmandise, que j'ai aimé lire les textes de Pierre Murat (Télérama, une fois n'est pas coutume), Jean-Philippe Tessé et l'ami Joachim Lepastier (Les Cahiers du Cinéma), ainsi que celui de Buster sur Balloonatic et son virulent débat. Voilà un démontage du système Haneke qui me semble salutaire face à la vague unanimiste, après la déferlante cannoise, des « ho ! » et des « ha ! » d'admiration. Ce que je lis me conforte dans l'idée que je me fais du film dans la mesure où cela me ramène aux souvenirs évidemment douloureux de mes précédentes expériences avec le cinéaste. Expérience qu'il ne me semble pas urgent de renouveler.
Ainsi les évocations de la culotte baissée d'Emmanuelle Riva chez Buster m'ont immédiatement fait penser aux petits poissons de Der siebente Kontinent (Le Septième continent – 1988). Pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire d'une famille moyenne (papa, maman, fifille) qui s'ennuie à mourir dans une Autriche gaie comme un gibet. Au lieu de se balancer sous un TGV, ils choisissent une méthode longue et, auparavant, détruisent systématiquement tout ce qu'ils possèdent. Lourde critique de la vilaine société de consommation. Entre les vêtements lacérés et les billets de banque déchirées menus dans les toilettes, Papa fracasse l'aquarium familial et Haneke de filmer, longuement sinon ce n'est pas amusant, les petits poissons s’asphyxier sur le sol. C'est typiquement le genre de plans que Joachim appelle joliment dans son article « plan attentat » et qui sont au cœur de l'art hanekien. Attentat contre le spectateur bien sûr qui se retrouve coincé tout à coup à voir quelque chose qu'il faut bien qualifier de dégueulasse, avec en prime le coup de règle sur les doigts qui le renvoie à sa position de voyeur. Dans un excellent documentaire, Haneke avec son sourire irritant explique que oui, les petits poissons mais que quand même c'est le symbole de la mort de la fillette. Et de feindre de ne pas comprendre que les spectateurs en soient choqués.
Ami lecteur qui peut être est allé t'émouvoir à Amour, il faut s'arrêter un instant sur ces poissons. A ce moment, je peux me poser la question de savoir si Haneke, réalisateur célébré y compris par ceux qui n'aiment pas son discours, a vraiment compris ce qu'est le cinéma. J'exagère, Brutus est un homme honorable et Haneke a sans doute beaucoup réfléchi à la question. C'est pire, il n'a pas foi dans le cinéma, il ne l'aime pas. Alors il le démonte et l'attentat au spectateur se double d'un attentat au cinéma. Qu'est-ce que le fameux effet de rembobinage dans Funny games (1997) sinon l'agression délibérée d'un effet propre à la vidéo, à la télévision, envers la structure logique du film ? Les poissons, c'est pareil. Haneke confond (ou feint de) l'agonie de personnages de fiction joués par des acteurs et la souffrance réelle d'animaux réels qui n'ont eu que le tort de croiser la route du réalisateur ou de son assistant, alors que l'acteur après le tournage sera allé prendre une bière au bar d'en face. Haneke s'offusque mais il oublie (ou feint de) que le spectateur de cinéma fait plus ou moins inconsciemment la différence. Le procédé est dégueulasse parce que le réalisateur change les règle en cours de route. Et qu'il sort de celles du cinéma. Le cinéma est par essence un art de l'illusion, illusion fondamentale du mouvement, tournage sans contraintes chronologiques (il y a des exceptions). Au cinéma, on met un acteur sur une caisse pour qu'il semble plus grand, on lui fait déclarer l'amour fou à un objectif de 50mm, on double les voix, parfois les corps, on triche, on truque. « Les films sont plus harmonieux que la vie », un acteur de cinéma ne trébuche pas sur une réplique, il ne tombe pas par terre. Au théâtre ou au concert, il y a des trous et des fausses notes, il y a un corps avec son humanité fragile, sur une durée réelle. Pas au cinéma ou alors d'une toute autre façon. Et le miracle du cinéma, c'est de créer de l'émotion, l'émotion d'une vérité, avec tout ce faux. C'est je crois, le sujet du Holy motors de Leos Carax cette année.
Mais pour Haneke et une certaine tendance du cinéma mondial, cette illusion est un problème et l'on cherche par tous les moyens de « faire vrai ». L'on mettra donc en avant une histoire réelle (comme avec Intouchables, mais si), l'on imaginera des mises en scènes qui visent à faire comprendre qu'il n'y a pas de « truc », que l'on ne triche pas (joie du plan séquence alors que le coeur du cinéma, c'est le montage), et c'est comme cela que Nicole Kidman fera pipi sur son partenaire, qu'Emmanuelle Riva baissera sa culotte (je note au passage que c'est déjà elle qui avait fini dans les barbelés au terme de ce travelling qui avait scandalisé Rivette) et que Trintigant trébuche. Comme dans la pornographie, on ne simule pas, mais comme dans la pornographie, on triche quand même. Pour en revenir aux poissons et à cette soudaine irruption du réel au sein d'un dispositif de fiction, sa violence me rappelle les procédés de réalisateurs italiens des années 70 qui inséraient dans leurs histoires de jungle des inserts d'animaux tués vraiment. La tortue de Cannibal holocaust (1980) et le singe de La montagna del dio cannibale (La montagne du dieu cannibale - 1978) sont les exemples les plus célèbres. Le principe en est le même au fond, comme le dispositif du premier film signé Ruggero Deodato qui vise à un fort effet de réel (film dans le film, caméra portée, baratin sur les acteurs disparus, etc.). L'on m'objectera non sans raison qu'il y a une gratuité des effets dans ces films et que ce n'est pas le cas pour Haneke, mais comme spectateur, je ressens de la même façon cette brutalité de la rupture unilatérale du pacte tacite d'illusion propre à la fiction. Et je n'aime pas ça.
Pourtant cette part d'illusion me semble essentielle au cinéma. Quand un personnage tombe de cheval dans un western, on frémit pour le personnage mais on salue aussi la performance du cascadeur. Chez Ford, souvent, la caméra s'attarde deux secondes que l'on voit Yakima Canutt esquisser un geste pour se relever. Une manière de distanciation brechtienne quoi. Sans vouloir surestimer le public, et contrairement à ce que semble croire Haneke, je ne crois pas le spectateur si facilement dupe. Je vois plutôt une acceptation tacite de la part de jeu et de manipulation nécessaire, n'excluant d’ailleurs pas que l'on puisse se faire bousculer un peu. Mais dans un rapport équilibré. Cette distance fonctionne d'autant plus qu'il s'agit d'acteurs connus avec lequel le spectateur a une histoire pré-existante à celle du film. Mettre en scène Jean-louis Trintignant, avec sa voix si caractéristique et son regard si particulier, c'est amener avec lui les personnages qui nous ont accompagnés depuis tant d'années, ceux à qui l'on a ressemblé, que l'on a craint ou aimés, le Roberto de Risi, le Julien de Truffaut, le Marcello de Bertolucci, le Jean-Louis de Rohmer, le Silence de Corbucci, le flic de Labro. J'ai le sentiment que conserver son faux-pas pour « faire vrai » comme le décrit Buster, c'est tout à coup sortir du film et renvoyer le spectateur au Trintignant vieil homme bien réel et à ce qu'il peut y avoir de gênant à voir sa fragilité réelle. Comme je trouve gênant de voir de vrais poissons suffoquer vraiment pour un film.
Toutes choses se tenant, dans le bouquin d'entretiens avec Michel Cieutat et Philippe Rouyer, Haneke déclare que Spielberg fait un cinéma « épouvantable » avec Schindler's list (1994) (ce qui ramènerait à Gérard Lefort, mais ça suffit). C'est sûr que Spielberg, lui, a foi dans le cinéma et son langage, qu'il sait créer de l'émotion avec un requin mécanique qui ne marche pas, histoire de rester dans le poisson. C'est irréconciliable.
16:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : michael haneke, polémique | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
























