« lun. 11 mai - dim. 17 mai | Page d'accueil
| lun. 25 mai - dim. 31 mai »
24/05/2009
La séléction du patron
Cannes tire à sa fin et je vous raconte tout cela à partir de lundi (si tout va bien et que Dieu, dans son infinie sagesse, me prête vie). J'en termine avec mes chroniques pour Kinok avec quelques mots sur le livre de Luc Moullet Piges Choisies. Une fois n'est pas coutume, je vous livre l'article en entier, c'est que vous devez absolument vous le procurer. Vraiment.
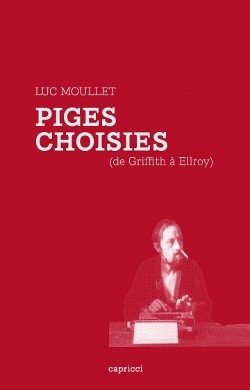
Peu d'ouvrages critiques sur le cinéma m'ont autant marqué que La théorie des acteurs de Luc Moullet. Originalité de l'approche, érudition, clarté, ouverture vers de nouvelles lectures pour des films pourtant bien connus, le tout enrobé dans un style vif et, surtout, surtout, plein d'humour. J'en ai développé une admiration tant pour le critique qui débuta en 1956 aux Cahiers du Cinéma période mythique que pour le cinéaste atypique à l'oeuvre très (trop) discrète mais conséquente avec une quarantaine de courts et longs métrages.
Je me suis donc jeté sans retenue ni pudeur sur Piges choisies (de Griffith à Ellroy), recueil de bons morceaux sélectionnés et présentés par le maître, édité par Capricci éditions et le Centre Georges Pompidou à l'occasion de la rétrospective Luc Moullet, le comique en contrebande que ces veinards de parisiens peuvent découvrir depuis le 17 avril et jusqu'au 30 mai. Au Centre Georges Pompidou comme il se doit.
Même s'il n'est pas un recueil exhaustif, l'ouvrage est très complet. Il couvre tout le parcours critique de Moullet depuis quelques lignes écrites à 12 ans (Exécution sommaire d'un film de Jean-Paul le Chanois en 1949 dans L'écran français) à un inédit de 2009 autour de l'oeuvre de James Ellroy, l'écrivain de Black Dalhia, Moullet décrétant qu'il préfère désormais lire les romans des américains plutôt que voir leurs films. C'est un choix.
Le livre permet de retrouver un texte écrit pour le John Ford collectif des Cahiers : Le coulé de l'amiral. Moullet se pose visiblement beaucoup de questions sur Ford dont il estime, c'est étonnant, Tobacco road, adaptation du roman d'Erskine Caldwell, datant de 1941 et généralement peu apprécié. J'ai quand même tendance à préférer quand Moullet parle de Ford en écrivant sur John Wayne ou James Stewart. Le lecteur trouvera également le texte assez long et assez remarquable sur Le morceau de bravoure écrit pour Positif en 2006, un essai sur Samuel Fuller qui lui valu les compliments de Rivette, ses admirations pour Truffaut, Godard et Sadoul, quelques textes théoriques comme De la nocivité du langage cinématographique, de son inutilité, intervention revigorante qui se conclut par ce cri du coeur « A bas le langage cinématographique pour que vive le cinéma ! ». Mais comme il le déclare, Moullet écrit peu de textes théoriques. « C'est dangereux. Metz, Deleuze, Benjamin, Debord se sont suicidés. Peut être avaient-ils découvert que la théorie de mène à rien, et le choc a été trop rude ». Ceci ne l'empêche pas de nous donner ses propres règles de critique : toujours faire rire le lecteur, pas de grille de lecture, ne jamais partir du Général et surtout ne pas s'y cantonner. « Avant d'écrire un texte, j'établissais la liste des calembours possibles. Pour faciliter mon inspiration, Rohmer m'avait offert le dernier almanach Vermot. »
Au fil des pages, on croisera quelques figures de son panthéon personnel. Don Luis Bunuel (« Je me rappelle cette saillie de Rohmer : « Moullet, je sais pourquoi vous adorez Bunuel, c'est parce que vous êtes tous les deux des fumistes ». Le plus beau compliment de toute ma vie »), Cecil B. DeMille, Kenji Mizoguchi, Edgard G. Ulmer ou plus récemment, Alain Guiraudie. Moullet s'y révèle précis, original dans ses approches souvent, et curieux toujours, révélant un amour du cinéma aussi large qu'on puisse l'imaginer. Ce qui me comble.
Dans un autre registre, Les maoïstes du centre du cinéma est une approche passionnante et très documentée sur les coulisses financières du cinéma français, écrit en 1999 pour un ouvrage sur le cinéma et l'argent. Moullet nous y révèle entre autre qu'il a faillit mourir de rire devant le devis d'un film de Pialat. Ce qui n'est pas rien, pensez-y deux secondes.
Pour ceux qui auraient envie de s'amuser autrement, éventuellement de s'énerver un peu, il y a deux textes assez raides. Le premier sur Michael Powell, « Michael Powell n'existe pas » écrit pour la défunte Lettre du cinéma. Moullet tend à mettre le crédit des oeuvres aux collaborateurs du cinéaste anglais, du comparse Emerich Pressburger, du monteur David Lean, du directeur de la photographie Jack Cardiff,et des producteurs comme Korda, faisant de Powell une sorte de réalisateur - ectoplasme. On sent pas mal ici cette méfiance de la tendance Cahiers envers le cinéma anglais. Ça se discute et c'est sans doute fait pour cela.
L'autre texte est un bel inédit puisqu'il a été refusé de partout. Avec entrain, Moullet s'attaque à l'une de nos modernes icônes, l'hispanique homme de la Mancha, Pedro Almodovar. « Russ Meyer soft », « John Waters du pauvre », le réalisateur de Volver est habillé pour l'hiver. L'humour du texte et le pertinence de certaines remarques, même s'il y aurait à dire là aussi pour la défense de l'accusé, atténuent la fougue radicale de la charge. Mais le positionnement un brin iconoclaste est réjouissant.
Moullet déplore en introduisant de dernier article les temps plus rudes mais plus stimulants (Le travelling de Kapo par Rivette si vous voyez ce que je veux dire) qui permettaient finalement d'approfondir les réflexions sur tel ou tel réalisateur. Le trop grand consensus actuel est sans doute ce qui ôte à la critique son utilité avec sa crédibilité. Moullet, lui poursuit dans la même veine son travail critique comme son activité de cinéaste, à sa façon, sans concessions aux modes ni à l'air du temps. Tout à ses passions. Piges choisies est aussi drôle que stimulant intellectuellement. Un ouvrage indispensable aux bibliothèques des cinéphiles de bon goût, à ranger à côté des chroniques de Jean-Patrick Manchette, Les yeux de la momie, histoire de voir comment ces deux là se supportent. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite mais regardez bien la photographie de l'auteur qui illustre la couverture. L'air inspiré devant la bonne vieille machine à écrire mécanique, il a la cigarette dans la narine.
11:55 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : luc moullet, cinéphilie | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
23/05/2009
Ōshima : Eté japonais, double suicide
Si Muri shinju: Nihon no natsu (Eté japonais, double suicide) tourné en 1967 par Nagisa Ōshima emprunte à l'univers des yakuzas (truands japonais), c'est principalement un masque porté par le film avec désinvolture. De même, il ne faut se fier qu'à moitié au double couple du titre. C'est bien l'été au Japon, mais la majeure partie du film se déroule dans un intérieur sombre et de nuit. En fait de double suicide, figure ô combien importante du cinéma d'Ōshima, il s'agit surtout du désir de mourir d'un seul homme, Otoko (qui signifie l'Homme, justement) joué par l'acteur fétiche Kei Sato. L'héroïne, Nejiko, jouée par la potelée et délicieusement vulgaire Keiko Sakurai est plutôt animée d'une intense pulsion de vie matérialisée par la double envie de pisser et de baiser, alternant l'ordre selon les circonstances.

Le premier quart d'heure est du Ōshima pur jus. Noir et blanc en Scope ouvragé par Yasuhiro Yoshioka, rythme sautillant de comédie rock and roll, esprit pop art entre body painting et tag, montage coq à l'âne. Nejiko a donc envie d'aller uriner. Hélas, les toilettes publiques sont envahies d'escadrons de jeunes hommes occupés à tout repeindre en blanc. Nejiko change son fusil d'épaule (quelle expression !) et comme Jane Russel chez Howard Hawks, demande s'il y a là quelqu'un pour l'amour. La pauvre semble transparente aux goujats qui la repeignent comme le vulgaire carrelage. Vexée, Najiko part assouvir ses besoins de deux ordres ailleurs. Sur un pont désert comme dans un film d'après la bombe, elle se met à l'aise et commence par envoyer par dessus le parapet petite culotte et soutien-gorge. Les délicats dessous sont recueillis par un nageur bientôt suivi par une procession nautique portant un drapeau japonais. Étonnant ballet nautique et nationaliste filmé de haut. Nous sommes bien chez Oshima, les corps constitués défilent avec cérémonie. Najiko n'aura pas plus de chance avec la fanfare des jolis militaires, puis tombe sur une procession de moines au milieu desquels elle rencontre, enfin, Otoko.
Le DVD
Photographie : capture DVD Carlotta
11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
21/05/2009
Ōshima : L'obsédé en plein jour
C'est à une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine que nous convie Nagisa Ōshima avec Hakuchu no torima (L'obsédé en plein jour) en 1966. Narrativement et visuellement, le film est ambitieux et complexe. Mais au fur et à mesure que l'on découvre l'oeuvre du cinéaste nippon, l'on en est de moins en moins surpris, simplement toujours admiratif. Ce film nécessita, nous dit-on, quelques 2000 plans, ce qui le rapproche en la matière des oeuvres d'Eiseinstein. Par comparaison, un film standard, si tant est que ce qualificatif ait un sens, en compte quatre fois moins. Ce chiffre est révélateur du travail sur le montage, Ōshima explorant cette fois d'autres voies que le plan séquence ou la théâtralité revendiquée. Montage virtuose donc, quasi expérimental, découpant les scènes en toutes petites fractions de temps, morceaux de décors, fragments de personnages. La narration enchevêtre le passé et le présent, avec une pointe d'onirisme lorsque l'institutrice Jinbo discute avec le fantôme de Genji. L'unité de l'ensemble est assurée par la photographie inspirée, en noir et blanc, d'Akira Takeda collaborateur d'Ōshima sur quatre films entre 1965 et 1967. Aux limites parfois de la surexposition, l'image multiplie les effets solaires et renforce l'aspect irréel de l'ensemble, tout comme le son qui fait ressortir violemment tel ou tel bruit comme le craquement de la corde d'un pendu.

Ces partis-pris artistiques forts et parfaitement maîtrisés nous font pénétrer en profondeur dans l'intériorité des personnages et dans leur désir, moteur de leurs actions. Hakuchu no torima prend l'aspect d'un film criminel, basé sur un livre de Tsutomu Tamura abordant un fait divers réel. « L'obsédé en plein jour » est le surnom donné à un homme qui, à la fin des années 50, agressait, violait et tuait éventuellement des jeunes femmes. Un point de départ en or pour un réalisateur qui s'est toujours passionné pour les rapports entre sexe, amour, violence et mort. Ōshima en tire une oeuvre-puzzle fascinante quelque part entre les constructions mentales d'Alain Resnais (le temps et l'espace) et les explorations formelles d'un Sergio Léone (rapports entre gros plans et plans larges, visages et paysages).
Le DVD
Photographie : capture DVD Carlotta
10:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2009
La maîtresse du professeur
00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2009
Ōshima : A propos des chansons paillardes au Japon
Et hop ! En voilà une et hop ! Hop !
Le cinémascope utilisé avec talent, hop !
Est d'une beauté incomparable, hop ! Hop !
Et hop ! En voilà deux et hop ! Hop !
Les pensées des étudiants après leurs examens, hop !
Vont à la fille de la place 469, hop ! Hop !
Et hop ! En voilà trois et hop ! Hop !
Pour baiser la femme de son professeur, hop !
Mieux vaut le faire sur son cercueil, hop ! Hop !
Et hop ! En voilà quatre et hop ! Hop !
Pour tout savoir du japon des années 60, hop !
Mieux vaut partir de ses chansons paillardes, hop ! Hop !

Et hop, c'est le postulat de départ de Nagisa Oshima pour Nihon Shunka-kô (A propos des chansons paillardes au Japon) tourné en 1967, au coeur d'une intense période créatrice. Le premier plan annonce la couleur. Quelques gouttes d'encre noire sur un rectangle rouge vif dessinent un cercle, parodie du drapeau au soleil levant. La tâche roussit puis s'enflamme. Le film sera brûlot, cocktail molotov embrasant le pays, frappant au coeur de ses symboles. Mais avec élégance. Ce qui frappe d'emblée dans le film, c'est la beauté de ses cadres. Oshima est un maître de l'écran large comme Sergio Léone, David Lean ou Jean-Luc Godard un temps. Les premières scènes suivent les déambulations de quatre étudiants à l'issue de leurs examens. Leurs corps sanglés dans leurs uniformes scolaires s'inscrivent dans les architectures grandioses et futuristes de l'université, un vaste terrain de sport, le parapet d'un pont sous la neige. Lorsqu'ils croisent une procession (Celle du « jour de la fondation de l'Empire », il faut le savoir), la foule vêtue de sombre, portant des oriflammes noirs et blancs arrive à angle droit avec une file d'écoliers en imperméables jaunes.
Le choc des générations est celui des couleurs et des lignes. Comme dans Lawrence of Arabia (1962), le film de David Lean qui revient comme un leitmotiv ironique tout au long du film, il n'y a pas de plan anodin dans Nihon Shunka-ko. Le chef-opérateur Akira Takada n'a qu'une courte carrière mais il s'y entend ici pour jouer des ambiances et de la profondeur du champ large. Plus tard, après avoir couché avec la maîtresse de son professeur devant son cercueil, Nakamura, l'un des étudiants, se promène longuement avec la jeune femme en surplombant la ville au crépuscule. Oshima sait rendre l'étrange beauté de ce japon urbanisé, moderne et tourmenté, comme Yasujirō Ozu se plaisait aux dessins des lignes électriques sur le ciel.
Le DVD
Photographie : capture DVD Carlotta
11:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nagisa Ōshima | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
























