« lun. 27 avril - dim. 03 mai | Page d'accueil
| lun. 11 mai - dim. 17 mai »
10/05/2009
Welcome, un film de Philippe Lioret
Dans les discussions qui reviennent périodiquement sur le cinéma français, mes lecteurs savent que j'ai une admiration particulière pour les films de Philippe Lioret. Welcome m'a tout particulièrement réjouis parce que je le vois comme son œuvre la plus aboutie, confessant au passage que je n'avais pas été complètement conquis par la belle mécanique de Je vais bien, ne t'en fais pas (2006). Welcome réussit à allier les qualités de romanesque de Mademoiselle (2001) et de L'équipier (2004) à une plus grande réussite formelle. Il réussit aussi à s'ancrer dans son époque, à saisir et rendre compte d'une atmosphère sans tomber dans l'anecdotique ni les pièges souriants du film à thèse, de ce cinéma engagé qui hérisse bien des cinéphiles. Pour être franc et ne pas m'appesantir sur le sujet, j'ai savouré à sa juste mesure la réaction outrée du Besson sous-ministre, s'indignant des similitudes soulignées par Lioret entre les ambiances de 1943 autour de la traque des juifs en France et la situation contemporaine autour de celle des clandestins. On se souviendra, à toutes fins utiles, du No pasaran, album souvenir (2003) de Henri François Imbert qui, à partir de quelques cartes postales des camps de réfugiés républicains espagnols en 1939, en France, racontait une histoire de l'Europe à travers ses camps et s'achevait... à Sangatte le fameux « centre d'accueil » de Calais aujourd'hui fermé. Mais il ne s'agit là que d'une réaction de royaliste rancunier et cela n'a rien à voir, ou si peu, avec le film, justement et tant mieux.

Cette réaction sous-ministérielle permet pourtant de dire ce que le film n'est pas (un film de propagande pour embêter monsieur Besson) et ce qu'il réussit à être en profondeur. Welcome est une histoire d'amour triple. De cet amour redoutable et redouté de tous les pouvoirs, l'amour des surréalistes, théorisé par Ado Kyrou et illustré par Luis Bunuel, celui qui brise les chaînes des contraintes sociales, qui, tout à lui-même, n'accepte aucun obstacle, aucune restriction à son accomplissement. C'est littéralement ce qui anime Bilal, jeune réfugié Kurde venu d'Irak, qui a traversé plusieurs pays et nombre de souffrances pour échouer à Calais. Il cherche à rejoindre Mina. Mina est à Londres, au-delà de la Manche, et son père a décidé de la marier à un riche ami. Le temps presse. Bilal croise la route de Simon, maître nageur et ex-champion olympique en plein divorce, joli personnage sur le retour façon Bogart dans Casablanca (1943), Lioret connait ses classiques. C'est la rencontre entre une histoire qui n'arrive pas à se terminer (car comme au premier jour, il est amoureux de sa femme) et une histoire qui n'arrive pas à commencer. D'où naissance d'une troisième histoire, celle de l'amitié entre les deux hommes, substitut d'une relation père-fils dans laquelle Simon peut voir l'enfant que son couple désagrégé n'a pas eu, et moi l'une de ces histoires de transmission (ici via la natation) façon Clint Eastwood récente manière.
Il y aurait à creuser sur les similitudes entre Lioret et le cinéaste américain. L'ouverture de L'équipier devait beaucoup à celle de Bridges of Madison Country (Sur la route de Madison – 1995). Ils ont un goût commun pour la mélancolie du temps passé, les gros plans travaillés qui envisagent les visages comme des paysages, les ambiances nocturnes, le travail discret sur la musique (ici c'est de nouveau Nicola Piovani qui s'y colle avec l'aide de Wojciech Kilar et Armand Amar) et la pratique d'une mise en scène élégante mais subordonnée à l'action, d'un certain classicisme, travaillant par touches subtiles plutôt que flamboyantes. Je note également la même pudeur dans la description des relations amoureuses et l'utilisation symbolique d'objets chargés de sens émotionnel comme la montre dans L'équipier qui cristallise le désir entre les personnages de Bonnaire et Gamblin, ou ici la bague qui finit par devenir le symbole des échecs de Simon.
La réussite de Welcome, c'est selon moi d'être resté avec rigueur sur sa ligne romanesque. De ne pas avoir cédé, avec son arrière-plan, à la tentation du film engagé qui ne convainc finalement que les convertis, bonne vieille quadrature du cercle du cinéma politique. Têtu comme une bourrique, Simon saisit au départ la rencontre avec Bilal comme un moyen de reconquérir sa bientôt ex-femme, Marion (Audrey Dana, très belle), qui elle soutient les réfugiés au quotidien au sein d'une association. Et le film, sans mollir, ne montrera pas l'éveil d'une conscience politique, mais le réveil d'une humanité. Et il s'attache aux conséquences sociales de l'amitié vraie et de l'amour contrarié. En se plaçant sur le plan humain, Lioret élargit son propos à la dimension universelle de la lutte de l'individu contre les forces répressives de la société (tu m'auras pas). J'ai l'air de plaisanter comme ça, mais c'est très bien vu. Les forces répressives ne sont pas seulement la police (français,e anglaise, privée avec le vigile), mais celles de la misère avec les conflits internes aux réfugiés, celles de la famille et de la tradition avec le personnage du père de Mina, celles du conservatisme et de la peur avec les épisodes du magasin et du voisin. Ce voisin, au passage, on peut le rapprocher de la famille de la boxeuse de Million dollar baby (2005), portrait assez gratiné, mais si vous connaissiez le mien (de voisin) ça ne vous semblerait pas si caricatural. Welcome montre un univers redoutable dans lequel tout le monde « a ses raisons », y compris l'étonnant commissaire campé par Olivier Rabourdin dont Lioret travaille l'étrangeté et en fait, non sans paradoxe, celui qui comprend le mieux les mouvements chaotiques de l'âme de Simon.

Cet aspect associé à la dimension tragique du récit rapproche Lioret d'un autre grand cinéaste de notre époque, Robert Guédiguian. Les personnages du marseillais ont certes une forte dimension politique. Ils portent, ou plutôt ont porté un idéal. Avec les années, cet idéal s'est émoussé et ce sont les relations affectives qui ont pris le relais et deviennent le moteur de fictions. Amour mère-fille dans La ville est tranquille (2000), Amour de jeunesse encore vivace dans Mon père est ingénieur ( 2004) et Lady Jane (2008). C'est cet amour qui permet de revenir à l'acte politique débarrassé de l'idéologie, comme il y mène Simon.
On retrouve aussi chez les deux hommes une certaine approche formelle. Ils ont la faculté de filmer avec beauté des paysages industriels tout sauf excitants à priori. Loin de la fascination poétique pour la poutrelle rouillée, le Calais de Lioret est représenté comme un pays terrifiant de conte de fée. Parfois aux limites de l'abstraction comme avec ces larges plans d'échangeurs d'autoroute avec le ballet nocturne des feux de camions, le passage de la douane et ses portes de lumière, l'immense plage battue par les vagues grises et puis, comme dans tout conte qui se respecte, la sombre forêt, la « jungle » comme la nomment les clandestins qui y campent. La ville elle-même garde un côté étrange, un peu comme la ville de Tystnaden (Le silence – 1963) d'Igmar Bergman. Territoire familier mais décalé sur lequel plane une sourde menace. Et puis il y a la mer. Après L'équipier, je n'hésite pas à écrire qu'avec Hayao Miyazaki, Lioret filme la mer comme personne. Aidé par la photographie de Laurent Dailland, chef opérateur classieux d'Est-Ouest (1999 ) et du Goût des autres (2000 ), il rend la puissance et la fascination de son immensité, transformant l'écran est un immense toile mouvante et redoutable.
En détachant souvent Simon du fond par des effets de mise au point et de focale, Lioret accentue ce sentiment d'absence du personnage au monde qui l'entoure avant de le rattacher quand il rencontre Bilal qui entre en quelque sorte « dans sa zone de netteté ». En resserrant les cadres autour d'intérieurs étroits (Le camion des passeurs, l'appartement de Simon, les vestiaires de la piscine), Lioret cerne ses personnages et réduit visuellement leur champ d'action. Et quand ils se retrouvent dans un vaste extérieur, la plage ou l'océan, ils sont tout à coup perdus. L'espace extérieur est un piège. La Manche se révèle un étroit passage traversé de patrouilles maritimes, la « jungle » n'est qu'un faux refuge et dans les rues, il y toujours quelqu'un pour vous voir. Rien ne se perd, tout se retrouve, les médailles volées et les bagues offertes. Nul endroit pour se cacher, ni pour respirer. Les longs gros plans expriment finalement que l'ultime frontière est notre propre corps. Ultime forteresse que l'on cherche à perçer à coups de regards. Un dernier espace de résistance.
Ce sentiment d'oppression dégagé par Welcome ainsi que sa fin assez sombre me semblent donner un portrait assez juste de ce début de siècle plutôt nauséeux. Depuis les attentats de septembre 2001, un mouvent d'ensemble s'est accéléré, un mouvement que rien ne semble pouvoir entraver, et qui tend à établir une version modernisée du village du prisonnier, la fameuse série des années 60. Les incroyables évolutions techniques des dernières décennies sont mises au service de la surveillance généralisée et du contrôle. Vidéo, Internet, biométrie, culture du risque zéro, règne de la norme, censure et autocensure des esprits. Qu'il ne dépasse pas une tête. Deux films essentiels ces dernières années ont su mettre des images justes et claires sur cette angoisse diffuse : Minority report (2004) de Steven Spielberg et aujourd'hui Welcome, un film de Philippe Lioret.

Photographies source Allociné copyright Guy Ferrandis
00:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : philippe lioret | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2009
Django autour du feu
J'ai sauté mon tour le mois dernier, pourtant, il s'agissait du film de Henry King The gunfighter (La cible humaine - 1950) que je n'ai, hélas, toujours pas vu. Bon, ce mois-ci, c'est tout autre chose. La discussion au forum western movies autour du feu est consacrée à Django, Franco Nero et son cercueil, sa mitrailleuse, ses yeux bleus, sa main leste (au révolver), son manteau noir et toutes ces sortes de choses. Django, c'est l'une des oeuvres maîtresses de Sergio Corbucci que plus je vois de ses films, plus je l'aime cet homme là. La discussion est partie sur les chapeaux de roues, alors si le coeur vous en dit, on a même réussi à glisser là-dedans une photographie d'Edwige Fenech.

Photographie : capture DVD Wild Side
23:30 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergio corbucci | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
04/05/2009
Le comique en contrebande
Depuis le 17 avril et jusqu'à la fin du joli mois de mai, le Centre Pompidou accueille Luc Moullet, ses oeuvres et ses amis. Si j'étais à Paris, je saurais quoi faire pendant ces belles journées de printemps. En attendant, pour fêter cela, les éditions Capricci ont édité deux livres, Notre alpin quotidien et Piges Choisies. Le premier est un livre d'entretiens avec Emmanuel Burdeau et Jean Narboni. Le second une sélection de textes critiques, depuis ses premiers pas vers 12 ans jusqu'à sa toute récente collaboration avec Positif, lui qui fut un pilier des Cahier du Cinéma. Il y a également une jolie bande annonce.
En bons zélateurs que nous sommes, le Docteur Orlof et votre serviteur ont planché sur les deux livres, deux chroniques à paraître rapidement sur Kinok qui organise au concours sur le sujet. Et pour que la fête soit complète, quelques extraits :
Les balances s'expriment fort bien par le comique : Keaton, Tati, McCarey, Groucho Marx, sont tous nés entre le 2 et le 8 octobre : le deuxième décan. J'en veux beaucoup à ma mère : si au lieu d'accoucher le 14 octobre, elle s'était pressée un peu, je serais du deuxième décan et j'aurais fait des films bien plus drôles. (Les douze façons d'être cinéaste – Cahiers du Cinéma – 1993)
Pourquoi critiquer P.P. (Powell-Pressburger) alors que je défends Une question de vie ou de mort ? On risque de me reprocher cette contradiction. C'est tout simplement que, quand on fait cinquante films dans sa vie, c'est bien le diable si on arrive pas à en réussir un. (Michael Powell n'existe pas – La lettre du cinéma – 1995)
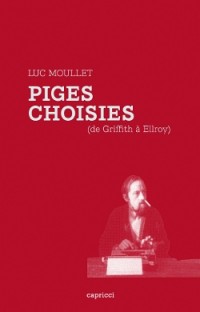
Les espagnols devaient bien se douter qu'ils misaient sur le mauvais cheval en l'allant chercher dans la Mancha, où, c'est logique, ils ne pouvaient tomber que sur une piètre rossinante... (Pédro Almodovar, rien sur ma mère – inédit)
Lorsque Lelouch emprunte le langage de Godard en recopiant les idées stylistiques de Godard, il échoue forcément parce que l'expression stylistique de Godard dépend du fait que Godard est suisse et protestant et qu'il est Godard. Lelouch n'est rien de tout cela, il exprime des thèmes personnels différents de ceux de Godard, ou, le plus souvent, il n'exprime pas de thèmes. (De la nocivité du langage cinématographique, de son inutilité, ainsi que des moyens de lutter contre lui – Table ronde - 1966)
La puissance de Ford réside d'abord dans une dialectique entre la présentation des mythologies et la familiarité, l'absolu et le relatif, le pensé et le vécu, la morale et la truculence, les nuages lourds du destin et la main au cul. (John Ford, le coulé de l'amiral – Cahier du Cinéma spécial Ford - 1990)
22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc moullet | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |























